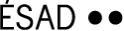Organisation pédagogique et catalogue des cours de l'option art à l'ÉSAD Grenoble
Premier cycle - option art
Par nature, l’option Art a vocation à former des artistes – ou du moins à en favoriser l’émergence. Tenant le plus grand compte de la personnalité de chacun, elle s’attache à donner à l’étudiant les moyens d’assumer une position d’artiste, tant dans la maturation d’une œuvre personnelle que dans la capacité à se situer dans le contexte historique, social et économique de l’art contemporain. L’option Art fédère des formes d’expression multiples et variées.
Procédant par approches successives, l’étudiant doit autant développer un regard global sur le monde que savoir produire des réalisations singulières. S’engageant dans ce parcours difficile, il questionnera régulièrement ses certitudes et ses savoirs, les enjeux théoriques et pratiques de l’art historique et actuel, et il devra non seulement expérimenter la diversité des médiums contemporains, mais aussi maîtriser des outils techniques, technologiques et conceptuels.
L’option Art constitue donc de facto une formation de haut niveau, aussi bien aux outils et aux modes de pensée utilisés dans le champ de l’art, des plus traditionnels aux plus contemporains, qu’aux diverses professions du monde de l’art, qu’aux métiers de l’enseignement artistique, de la production et de la médiation culturelle.
L’art contemporain réclame de ses acteurs beaucoup de qualités, de responsabilités, d’esprit d’initiative, de professionnalisme et d’engagement dans la création. Une option Art, parce qu’elle est le lieu de la recherche, de l’expérimentation et de l’hétéronomie généreuse, est donc le terrain même où se cultivent avec exigence les revendications de cet art contemporain. C’est pourquoi l’option Art de l’ÉSAD •• a fait le choix d’une formation pluridisciplinaire, marquée par la diversité et la polyvalence, d’une formation à la fois généraliste et personnalisée, mais toujours professionnalisante.
ANNÉE 1
Liste des unités d'enseignements
Semestre 1
UE1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – 18 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 10 ECTS
UE3 : Bilan du travail plastique et théorique – 2 ECTS
Semestre 2
UE1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques – 16 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 10 ECTS
UE3 : Bilan du travail plastique et théorique – 4 ECTS
Grille d'évaluations année 1 - semestre 1
UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
Atelier Recherche et Création - Documenter le monde (F.N.)
Atelier Recherche et Création - Playlist Remix (M.T.)
Méthode d’enseignement :
Recherches individuelles et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, séances d’écoutes, séances de lectures, production d’objets rendant compte de la recherche, exercices de courte et de longue durée, présentation publique.
Avec également :
Une résidence de recherche de 6 jours avec 6 étudiant·es de l’ARC à Centrale Fies – Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, avec un workshop animé par l’artiste Publik Universal Frxnd (octobre 2025)
Un workshop de transmission à l’ARC par les étudiant·es ayant participé à la résidence
Un workshop de drag imaginé avec les étudiant·es Emmanuel·le Garin et Faustine Stricanne
Un·e ou deux invité·es pour un ou deux workshops
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Démystifier la performance
Produire ou interpréter des formes, gestes, textes, chansons, etc.
Travailler des formats de collaboration et/ou en collectif
Contenu du cours :
En partant de la place que la musique occupe dans nos mémoires et de la manière dont elle structure nos souvenirs, l’ARC Playlist Remix 2 s’inscrit dans le cadre du programme de recherche What’s love got to do with it?, qui explore comment nos émotions nous informent sur le monde et comment, en tant qu’artistes, nous pouvons apprendre de la façon dont ces émotions génèrent des récits. Avec les intervenant·es invité·es, nous nous pencherons également sur les pratiques musicales ou performatives, ainsi que sur les notions de spectacle et de fête.
*Sur la résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies(https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture du parcours Performance, du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025.
L’objectif est de vivre une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel situé dans une ancienne centrale hydroélectrique, près de Trente, en Italie (https://www.centralefies.it/building/). Ce lieu accueille un festival de performance depuis plus de 45 ans et collabore avec des écoles telles que le Dutch Art Institute (Amsterdam/Arnhem) et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence permettra notamment :
- Une formation aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) avec un technicien de Centrale Fies
- Un workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), basé·e à Amsterdam, dont la pratique queer articule performance et musique
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, régularité de la participation, qualité des recherches et soin dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dynamique collective de l’atelier.
L’évaluation portera également sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Atelier Recherche et Création - Confluence (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique sur sites.
Exposition dans la galerie de l’école.
Objectifs du cours :
Eau qui médite, enclos du temps.
Paupière close. Un silence qui écoute.
Eric Hurtado
Questionner par la photographie et la vidéo le territoire d’une rivière, son bassin, son déploiement, sa confluence avec l’activité humaine. Nous questionnerons également notre conscience de celle-ci, confluence elle-même de l’existence de la rivière avec notre regard. La question du réel, toujours, rivière qui coule et semble fixe.
« L’image est au confluent de la lumière venue de l’objet et de celle qui vient du regard. » PLATON
Contenu de cours :
L’Arc débutera par la projection de Stalker, d’Andreï Tarkovski, film questionnant la réalité d’un territoire et la conscience des inventeurs de celui-ci (au sens réunissant découverte et invention, justement arcane fondamental de la quête photographique.)
Suivront deux journées de rencontre et d’atelier photographique avec le photographe Jean- Marc Blache, qui a photographié l’eau sous toutes ses formes, de la glace à l’exploration sous-marine dans de nombreux pays. Il nous accompagnera lors d’une séance de prises de vues sur le territoire du Drac, au sud de Pont-de-Claix et pour la restitution des travaux.
Chaque quinzaine, en semaine B, une des deux journées de travail de l’Arc sera consacrée à une sortie de prises de vues en extérieur sur le thème de l’eau.
Un voyage pédagogique est également prévu dans le Vercors à la grotte de Choranche.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à l’issue de l’Arc dans la galerie de l’École.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Films :
Andreï Tarkovski, Stalker
Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu
Michelangelo Antonioni, Gente del Po
Désert Rouge
Jean-Luc Godard, Opération Béton
Jean Giono, L’eau vive
Livres :
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Raymond Depardon, Errance. Points/Seuil
Roland Recht, La lettre de Humboldt, Christian Bourgois
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Atelier Recherche et Création - Sphère (B.J.)
Méthode d’enseignement :
La sphère est un concept formel. Cet ARC est donc une proposition pour investir une forme dont la dynamique globale, sur le artistique, est abstraite. Mais l’idée de sphère est susceptible de s’imprégner d’éléments variés, comme celui de l’écologie par exemple (la terre est un écosystème sphérique), ou par des investigations fictionnelles (Sphère est le titre d’un film de science-fiction).
L’idée de sphère peut être investie de façon diverses : sur des supports digitaux (film, 3D), ou matériel (peinture, installation, photographie, performance). L’IA peut également être utilisée.
Objectifs du cours :
Cet ARC vous invite à plonger dans l’univers de la sphère, une forme universelle qui traverse l’art, la science, la philosophie et la nature. Symbole d’harmonie, de perfection et d’unité, la sphère est aussi une métaphore puissante pour réfléchir à la fragilité de notre planète Terre, un écosystème menacé par les activités humaines. À travers cet ARC, vous explorerez les dimensions formelles, symboliques et écologiques de la sphère à travers une œuvre ou plusieurs dans le médium de votre choix : dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, performance, multimédia, vidéo, 3D. Cet exercice est une occasion de conjuguer réflexion conceptuelle et engagement environnemental.
Contenu du cours :
Objectifs pédagogiques
- Explorer les caractéristiques formelles et esthétiques de la sphère.
- Intégrer une réflexion écologique en lien avec la Terre, sphère fragile et écosystème précieux.
Thèmes d’exploration autour de la sphère
La sphère, par sa simplicité et sa perfection, offre une multitude de pistes à explorer dont voici quelques exemples : :
- Forme et esthétique : géométriquement, la sphère est la forme la plus équilibrée, où chaque point de sa surface est équidistant de son centre. Dans l’histoire de l’art, elle inspire des œuvres architecturales (comme les dômes de Brunelleschi) ou sculpturales (les sphères polies d’Anish Kapoor). Comment pouvez-vous jouer avec la tridimensionnalité, les reflets, les ombres ou les illusions optiques pour réinterpréter la sphère ? Considérez les jeux de lumière, de texture ou de transparence dans votre travail.
- Symbolisme et philosophie : La sphère a longtemps incarné l’idée de perfection et d’infini. Pour les anciens Grecs, elle représentait le cosmos, une harmonie universelle. Dans l’art contemporain, elle peut évoquer l’unité, l’isolement ou la cyclicité du temps. Pensez aux installations immersives de Yayoi Kusama, où les sphères répétées créent un sentiment d’infini.
- Écologie et fragilité planétaire : La Terre est un écosystème complexe et vulnérable, confronté à des défis comme le changement climatique, la déforestation et la pollution. En tant qu’artistes, vous pouvez utiliser la sphère comme une métaphore pour alerter sur ces enjeux. Pensez à des matériaux de récupération ou à des installations qui évoquent la fragilité de notre environnement.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Format : Œuvre physique ou numérique.
- Recherche préparatoire : Au début de l’ARC, un moment d’échange qui s’appuiera sur une présentation visuelle d’images vous proposera des pistes de travail à travers la présentation d’un certain nombre d’exemples. Le domaine de l’art est privilégié mais il sera aussi question d’architecture, selon un choix lié à la forme sphérique. Lors de cette phase préparatoire, vous ressemblerez des références visuelles, textuelles ou conceptuelles dans un carnet de recherche pour trouver votre ou vos idées. Nous discuterons ensemble de ces projets et vous passerez ensuite à la réalisation.
- Production : vous aurez tout le premier semestre pour mettre au point votre réalisation. Vous produirez une œuvre dans le médium de votre choix. Il sera possible d’effectuer plusieurs travaux ou un seul s’il est suffisamment complexe pour justifier cette durée dans le temps.
- Dimension écologique : Intégrez une réflexion sur l’environnement, que ce soit par le choix de matériaux durables, un message visuel sur la crise climatique ou une œuvre qui incite à repenser notre relation à la Terre.
- Rythme des échanges : Je serai présent les lundi et mardi selon l’emploi du temps auquel vous devrez vous référer pour être présents à chaque fois. Les rencontres se feront de préférence de façon collective mais auront lieu également à travers des entretiens individuels.
- Présentation / évaluation : Fin janvier, vos œuvres seront accrochées lors du bilan à travers un accrochage collectif dans notre salle allouée à l’ARC et donneront lieu à un échange de points de vues et d’analyses.
METHODOLOGIE :
- Dessin/peinture : vous expérimenterez la forme de la sphère selon vos aspirations formelles. Les supports meuvent varier, pensez à expérimenter d’autres surfaces que le papier ou la toile.
- Sculpture/installation : vous utiliserez des matériaux disponibles à l’atelier de l’école ou des matériaux de recyclage que vous aurez glané (plastique, métal, bois) ou éphémères (terre, papier) pour construire une sphère ou une composition sphérique. Vous pourrez intégrer des projections, des sons ou des animations pour créer une expérience immersive autour du thème. Dans ce sens, pensez également à solliciter le matériel disponible dans le domaine de la lumière dont dispose l’école.
- Photographie/vidéo : jouez sur des paramètres de cadre, de lumière, pour construire des images dont la structure principale est sphérique. Le montage de films pourra se faire sur Final cut Pro ou Da Vinci Resolve.
- Performance : Les scénarios sont ouverts : mouvements circulaires, répétition, etc. (voir Abramovic et Ulay).
Repères bibliographiques / références art et architecture :
ART :
- Anish Kapoor : Ses sculptures sphériques, comme Cloud Gate, jouent avec les reflets et la monumentalité pour transformer l’espace et la perception. Sa série Sky Mirror présente également des surfaces paraboliques et circulaires.
- Tara Donovan : Une artiste américaine qui utilise des matériaux du quotidien (gobelets, pailles…) pour créer des installations organiques évoquant des formes sphériques ou cellulaires.
- Michelangelo Pistoletto : sa performance Newspaper Sphere interroge l’accumulation et la boulimie d’information à travers un processus d’accumulation performative.
- Marina Abramovic / Ulay : Relation dans le mouvement – une performance historique entre le mythe de Sisyphe (Camus) et celui de l’Eternel Retour (Nietzsche).
- Yayoi Kusama : connue pour ses motifs à pois omniprésents, elle utilise la forme ronde dans ses peintures, sculptures et installations immersives, créant des expériences infinies et psychédéliques.
- Olafur Eliasson : artiste danois-islandais qui explore souvent les formes géométriques, y compris la sphère, dans des installations qui jouent avec la lumière, la perception et les phénomènes naturels. Son œuvre The Weather Project avec son immense soleil artificiel sphérique en est un exemple marquant.
- Richard Long : associé au Land Art, il utilise souvent des formes géométriques simples trouvées dans la nature, comme des cercles de pierres.
- Michel Verjux : Un artiste visuo-spatial contemporain, poète et théoricien de l’art, mentionné ici pour ses sculptures de lumière utilisant des projections minimalistes rondes pour des expériences physiques utilisant l’espace et l’architecture comme support.
- Les artistes de l’Op Art (comme Victor Vasarely) : Bien qu’ils aient exploré diverses formes géométriques, le cercle et les formes rondes étaient essentiels pour créer des illusions d’optique de mouvement et de profondeur.
- Xavier Veilhan : artiste français aux registres étendus mentionné ici essentiellement pour ses mobiles inspirés de Calder, entre équilibre et déséquilibre, dont la finalité se situe peut-être dans un processus de déstabilisation de la sculpture.
- Karina Smigla Bobinsky, artiste germano-polonaise, mentionnée ici pour son installation interactive de 2018 présentant une sphère dans une pièce vide manipulable par les visiteurs.
ARCHITECTURE :
- Antti Lovag : l’architecte des maisons bulles, précurseur de la blob architecture et de l’architecture organique.
- Cabinet d’architecture Populous Severud Associates : La sphère de Las Vegas et son ingénierie de science-fiction.
- La Blob architecture : un terme donné à un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.
Artistes dans l’Histoire :
- Sandro Botticelli : Dans sa peinture La Madone du Magnificat, la forme circulaire (du tondo, support rond) encadre la Vierge et les anges, une forme courante à la Renaissance pour les sujets religieux.
- Jérôme Bosh : La création du monde.
- Ingres : Le bain turc, autre référence célèbre de peinture peint sur un tondeauen tant que peinture ronde, en écho aux rondeurs des corps.
- Fernand Léger : Au début du 20e siècle, il a intégré des formes cylindriques et circulaires dans son travail, décomposant les objets en éléments géométriques. Son tableau Les Disques dans la ville en est un exemple.
- Robert Delaunay et Sonia Delaunay : Pionniers de l’Orphisme, un dérivé du cubisme, ils ont utilisé des disques de couleurs et des formes circulaires pour explorer la lumière et le mouvement.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres artistes seront présentés comme sources d’investigation et d’inspiration lors du commencement du workshop à la rentrée.
Annexe : La Sphère comme exploration artistique : une lecture à travers Peter Sloterdijk
Dans sa trilogie Sphères, le philosophe Peter Sloterdijk propose une réflexion profonde sur cette forme, non seulement comme objet géométrique, mais comme métaphore de l’existence humaine, de l’espace et des relations. Ses idées offrent un cadre conceptuel riche pour explorer la sphère en tant que motif, symbole et espace de création.
Sloterdijk décrit la sphère comme une structure fondamentale de l’être-ensemble : L’homme est l’animal qui vit dans des sphères qu’il produit lui-même (Bulles, 1998). Cette idée invite les artistes à envisager la sphère non pas comme un simple volume, mais comme un espace de vie, un contenant intime où se tissent des relations. Dans ce sens, vous pourrez explorer des installations sphériques, jouant avec des matériaux transparents ou opaques pour exprimer cette tension entre intériorité et extériorité.
Les sphères sont des globalisations réussies, des mondes en miniature (Globes, 1999). Cette citation peut inspirer des œuvres qui questionnent l’idée de globalité : une sphère peut-elle contenir le monde ? Les étudiants peuvent créer des microcosmes sphériques, intégrant des fragments d’images, de sons ou d’objets, pour réfléchir à l’ambition de l’art de représenter l’universel à travers une forme finie.
Enfin, dans Écumes, Sloterdijk introduit la notion de sphères multiples et interconnectées : Nous vivons dans des écumes, des agrégats de sphères qui se touchent sans se fondre (Écumes, 2004). Cette image d’écumes, où chaque sphère est à la fois autonome et liée aux autres, pourrait guider des projets collectifs. Cette idée peut également s’envisager sous une forme plastique en deux dimensions, peinture, dessin…
En somme, la sphère, chez Sloterdijk, est bien plus qu’une forme : elle est un espace philosophique, poétique et relationnel. En s’appuyant sur ces concepts, vous pourrez explorer des médiums variés (sculpture, performance, installations immersives) pour interroger la sphère comme lieu de protection, de rêve ou de tension.
Atelier Recherche et Création - Art and the city (S.S.)
Atelier Recherche et Création - Le Banquet (P.R. & C.B. & A.O.)
Méthode d’enseignement :
Proposer des situations autour du repas lors desquelles les étudiant·es sont invité·es à répondre systématiquement. Mise en place d’exercices réguliers et création de protocoles autour de la cuisine. Les temps de cuisson, le dressage de la table, l’assaisonnement d’un plat seront des moments pédagogiques parmi d’autres.
Objectifs du cours :
Tous les mardis, développer collectivement des temps de recherche, de discussion et de création dans le cadre d’un repas. Faire la cuisine, manger ensemble, la digestion comme expérience simultanée, la vaisselle et le rangement seront les principaux objectifs de l’ARC. Mettre en œuvre le Symposium de fin de semestre en tant que forme artistique collective.
Contenu du cours :
Tous les mardis s’organiseront autour des repas de midi, depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Les déjeuners du mardi midi feront partie de l’ARC, chacun·e ramènera des ingrédients. Nous élaborerons des repas thématiques en questionnant l’économie d’un repas, les manières de faire, l’hospitalité. Nous pratiquerons l’art de la conversation, réfléchirons au vocabulaire de la cuisine dans sa polysémie, nous pratiquerons le “toast” comme forme poétique etc. Quelle différence entre faire la cuisine dans un restaurant, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine dans une école d’art? Quelle différence entre manger au restaurant, manger chez soi, manger dans une école d’art?
Chaque séance permettra de proposer des formes et préparera la séance suivante.
L’ARC sera aussi le laboratoire de préparation du Symposium qui se tiendra dans la Grande Galerie de l’ESAD le 13 janvier. Nous adresserons des invitations à des personnes choisies, élaborerons un menu et un programme de formes, de gestes et de prises de parole.
Modalités et critères de l’évaluation :
Participation à l’ensemble des temps de l’ARC sans exception et à l’organisation du Symposium du 13 janvier.
Repères bibliographiques / références :
-Karen Blixen, Le dîner de Babette, 1961 (1ere ed. danois 1958).
-Ludovic Burel, Le laboratoire de fermentation, it: éditions, 2025.
-Sally De Kunst et al., This Book is yours. Recipes for artistic collaboration/Recettes pour la collaboration artistique, Art&Fiction publications – Vexer Verlag, 2019.
-Thien Uyen Do, Fermentation rébellion, édition des Equateurs, 2024.
-Marguerite Duras, La cuisine de Marguerite, B. Jacob, 1999.
-Claire Gausse, Louise Drulhe, Cantines de quartier : la recette du lien, éditions 369, coll. Manuels, 2018.
-Emmanuel Guillemain d’Echon, Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis. Routes, recettes et tours de main, Keribus Éditions, 2024.
-Dorothy Ianonne, A CookBook, (edition anglaise), Presses du Réel, 2019.
– Lauren Malka, Mangeuses : histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, ed. les Pérégrines, 2023.
-Gaëlle Ronsin, Ajouter un couvert pour l’anthropologue, Les éditions de l’épure, 2024.
– Niki Segnit, Le répertoire des saveurs, Marabout, 2012.
-Yoann Thommerel, Manger low cost, édition Nous, coll. Disparate, 2025.
-Alice B. Toklas, Le livre de cuisine d’Alice Toklas, (Traduction de : The Alice B. Toklas cook book), les Éd. de Minuit, 1999.
-Gabriel Axel, Le festin de Babette, 1987 (film).
-Luc Moullet, Genèse d’un repas, 1978 (film).
Atelier Recherche et Création - Bifurcations et chants-photosynthèses (E.D.F.)
Intitulé du cours : ARC : Bifurcations et chants-photosynthèses
À la suite de l’Arc « Ré-ouvrir les futurs » et « Terre-strates-récits », troisième chapitre d’un cycle d’enseignement intitulé “DES CHEMINS HYBRIDES”, Imaginer en 2050 êtres et territoires, entre Trièves et Grenoble.
Intervenant.e.s : Stéphanie Sagot et Pascal Aspe (Ferme des MillePousses). Lisa Panico et Thomas Klein, chargé.e.s de la réouverture au public du Centre horticole de Grenoble.
Méthode d’enseignement :
Dans une approche transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation dans le Trièves et le Massif du Vercors avec un travail dans les ateliers de l’ÉSAD. Nous bénéficierons d’expériences d’apprentissage et de chantier participatif avec le nouveau projet d’agriculture urbaine de Mille Pousses Grenoble, dirigé par Pascal Aspe. Nous nous rendrons dans le Trièves pour apprendre de la ferme collective Sainte-Luce et puis dans le Vercors pour un arpentage-lecture de paysage et botanique.
Nous continuerons nos échanges et séances d’apprentissage avec le Centre Horticole de la ville de Grenoble, avec lequel est un partenariat est noué.
Un atelier est également prévu avec Stéphanie Sagot, artiste qui explore depuis vingt ans les liens entre environnement, agriculture et alimentation. Chaque étudiant.e travaillera à partir d’un projet personnel. Nous rencontrerons au début de l’anéée l’artiste baniwa et brésilien Denilson Baniwa, qui nous présentera certains de ses travaux en lien avec le végétal.
Durant le semestre, des journées de réflexion et d’échanges seront également co-organisées avec les ARC et les IR de la mention Territoire et Société. Ainsi une rencontre et un temps d’échange est prévue avec l’ARC de Slimane Raïs intitulé « L’Air de rien… ».
Objectifs / contenu du cours :
En menant des recherches sur les spécificités historiques, environnementales et sociales du territoire entre le Trièves et la métropole Grenobloise articulant espaces urbains, ruraux et montagneux, il s’agira d’imaginer à travers objets et fictions futuristes, les liens pouvant se développer entre sculpture, installation, outil agricole et leurs lieux d’activation : l’exposition, le champ et les espaces de collectes et récoltes.
Pour la troisième édition de cet ARC, nous plongerons, en compagnie des intervenant.e.s et partenaires de ce cycles, dans des visions futuristes de possibles hybridations entre plantes et humains. Partant des écrits de Lynn Margulis et Dorion Sagan au sujet de l’apparition de l’Homo photosyntheticus, nous réfléchirons aux multiples scénarios extraordinaires que l’évolution des espèces permet.
Ces recherches nous demanderont une attention aux différentes échelles composant nos mondes. Comment appréhender les points de vue d’un insecte, d’une plante, d’un micro-organisme, d’un oiseau, d’un humain, d’une forêt, d’une montagne, ou d’une bio-région, et quelles manières peut-on hybrider, mettre en commun, et mettre en scène ces différentes corporéités ?
À partir d’une sensibilisation à ces différentes échelles, de quelle manière pouvons-nous penser et raconter les mouvements, les interactions et les migrations des êtres humains et végétaux à des horizons futurs ? Dans le contexte du Trièves et de la métropole de Grenoble, quelles alliances, quels récits, quelles hybridités possibles ?
Ainsi, en apprenant de la botanique et de l’ethnobotanique, en s’inspirant des recherches scientifiques sur l’évolution futur du climat et de l’environnement, sur l’évolution des sciences du vivant, en apprenant de la littérature des imaginaires (ou « science-fiction ») et des multiples formes de l’agriculture et de production de nourriture, nous imaginerons de possibles hybridations entre formes artistiques, agricoles et écologiques.
Dans une conjoncture, où le présentisme, les visions progressistes, spéculatives, ségrégationnistes et productivistes fragilisent fortement des modes de vies à l’échelle locale comme planétaire, il est crucial de ré-ouvrir les futurs et envisager une multitude de possibilités pour un avenir durable et symbiotique, construit d’interactions multiples, d’échanges entre différences, et d’espace de communs.
À l’horizon 2050, quels objets et quelles formes, quelles transformations du territoire, quelles représentations ou expressions peuvent engendrer de telles collaborations ?
À partir de méthodes transdisciplinaire, et à travers ce dialogue entre arts, agricultures et sciences, comment imaginer dans ces futurs des interactions entre un lieu et un territoire (un éco-système, un jardin, un champ, un quartier, une rivière, une intervention artistique in-situ), des objets (œuvres, outil et instrument) et des représentations (récit, narration, mise en scène) ?
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre, capacité à présenter et échanger à l’oral. Présence, assiduité et participation, assiduité, dialogue.
Repères bibliographiques / références :
L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021.
Karen Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, 2023
Emma Bigé, Clovis Maillet, Écotransféminismes, Pour des écologies transféministes, 2025
Octavia Butler, Parabole du Semeur, 1993.
Terres et liberté : Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, 2025
Patrick Chamoiseau, Les Neuf consciences du Malfini, 2009
Julie Crenn et Lauriane Gricourt, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024
Tj Demos, Radical Futurisms -Ecologies of Collapse/Chronopolitics/Justice to Come, 2023.
Donna J. Haraway Camille Stories, dans Vivre avec le Trouble, 2016.
Lynn Margulis, Dorion Sagan, L’univers bactériel, 1986
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées, 2013.
Ursula K. Le Guin, La Vallée de l’éternel retour, 1985.
Sébastien Marot, Taking the country’s side. Agriculture and architecture, 2019
William Morris, Nouvelles de Nulle Part, 1890.
Vandana Shiva, Jacques Caplat et André Leu, Une agriculture qui répare la planète, Les promesses de l’agriculture biologique régénérative, Actes Sud, 2021.
Œuvres et travail de : Atelier Paysan, Inland, Agence Coloco & Gilles Clément, FutureFarmers, Asunción Molinos Gordo, William Morris, Marjetica Potrc, Elisa Strinna, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Åsa Sonjasdotter, Otolith Group, Natsuko Uchino.
Atelier Recherche et Création - L'air de rien (S.R.)
Objectifs du cours :
Dans cet ARC nous nous intéresserons aux éléments naturels et leurs interactions avec la création artistique. Comment depuis des siècles les artistes exploitent dans leurs œuvres les éléments naturels, non seulement comme sujet ou motif, mais aussi, comme matériaux, outils ou comme espace dans lequel s’articulent des formes.
Il est également question de l’air et de l’art. Le premier est l’incarnation de l’invisible, le second, le sacro-saint du regard. Ceci pourrait sembler paradoxal et pourtant ! Bien qu’il puise son langage dans le visible et le tangible, dans un monde où la visibilité est devenu un enjeu majeur de l’existence, la fonction essentielle de l’art ne serait-elle pas de figurer l’invisible ?
De Botticelli a Otoniel, passant par Duchamp, Morris, Barry ou encore Messager, l’art prend parfois de bonnes inspirations pour donner a voir « cela qui ne peut être peint »*.
Plusieurs intervenants, théoriciens et plasticiens, viendront partager leurs expériences et réflexions sur ces questions. Ainsi, nous accueillerons Thierry Davila, historien de l’art, conservateur de musée et commissaire d’expositions, pour une conférence d’ouverture intitulée De l’air.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu
. Exposition des travaux en fin d’ARC (lieu encore à définir)
. Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
. Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)
. Présentation des travaux, mise en espace.
. Qualité des réalisations.
. Relation de travail, présence en cours, engagement.
. Entretien 20 minutes avec l’étudiant lors du bilan. Notation /20
Repères bibliographiques / références :
- De l’inframince – Brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Thierry Davila. Editions du Regard. 2019
- Littératures et arts du vide, Sous la direction de Jérôme Duwa et Pierre Taminiaux Édition : Hermann. 2018
- La puissance créatrice du souffle, Maurice Fréchuret Edition: Les presses du réel. 2024
- Inclusions, esthétique du captitalocène, Nicolas BourriaudEdition : Puf, Perspectives critiques. 2021
- L’art a l’état gazeux, Yves Michaux Edition : Stock. 2003
La vérité picturale (S.S.)
Atelier vidéographie (Y.F)
Atelier volume - Corps et mutations (J.S.P.)
Méthode d’enseignement :
En demi-groupes, aux Ateliers tous publics.
Objectifs du cours :
Découvrir et se familiariser avec diverses techniques liées à la reproduction du corps ou certaines parties anatomiques, extrapolez ensuite vers une production innovante : transformation, mutation, hybridation, etc. La réalisation de chaque projet amènera une réflexion plus particulière sur le regard que chacun peut porter sur le corps humain, sur ses libertés, sur ses limites, sur l’utilisation ou le détournement. Quel regard portons-nous sur l’identité ?
Contenu du cours :
Parties pratiques : Découverte et expérimentation de pratique de l’argile (modelage), du plâtre, de l’alginate, du silicone, etc. (Moulage).
Partie théorique : Recherche d’artistes et de courants artistiques qui ont eu comme préoccupation première la représentation du corps, son utilisation, sa diffusion, sa transformation en fonction de votre projet.
Modalités et critères de l’évaluation :
Chaque étudiant-e sera évalué-e sur son assiduité aux cours, sur ses recherches, sur son questionnement, sur la pratique et l’utilisation de matériaux adaptés à son projet final et sur la pertinence de son travail.
Repères bibliographiques / références :
Yves Klein, Orlan, Hermann Nitsztche, Marina Abramovic, Rebecca Horn, Ron Mueck, Pina Bausch, Gunther Von Hagens, Gilbert et George…
Workshop vidéo (A.O. & D.H.)
Travaux d'initiatives personnelles (A.O.)
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Toute l'histoire de l'art ou presque (P.R. & K.S.)
Méthode d’enseignement :
Cours uniquement en anglais en demi-groupe et sous-groupes
Tous les documents et mails d’information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.
Les cours reposent sur une méthode communicative et une approche actionnelle, favorisant l’interaction orale et l’usage de la langue dans des situations concrètes.
Les activités proposées visent à développer l’autonomie langagière des étudiants à travers des projets, des jeux de rôles, des présentations orales, et des échanges en petits groupes. L’objectif est d’encourager une prise de parole régulière en anglais, en lien avec les projets actuels des étudiants et leur éventuel futur domaine professionnel.
L’enseignement s’appuie sur des supports authentiques et visuels (vidéos, extraits d’interviews d’artistes, portfolio, documents d’exposition) emmené par les étudiant.e.s pour favoriser l’expression et la compréhension. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à décrire leur travail artistique, présenter un·e artiste de référence, ou commenter une œuvre, afin de renforcer leur vocabulaire spécifique et leur aisance à l’oral. Une place importante est donnée aux productions personnelles et aux échanges sur la pratique artistique.
Les séances sont conçues selon une pédagogie différenciée, afin de s’adapter à la diversité des niveaux d’anglais. Des activités en binômes ou en petits groupes permettent un apprentissage collaboratif, où les étudiants s’entraident et progressent ensemble pour progresser vers une dynamique de groupe bienveillante et participative.
L’accent est mis sur la communication orale (compréhension et expression), professionnel Des activités de reformulation, de jeu de rôle, et de présentation orale sont régulièrement mises en place pour permettre aux étudiants de gagner en fluidité et en confiance à l’oral.
Objectifs pédagogiques et contenu :
- Approfondir leur compréhension des réalités professionnelles des artistes et des designers graphiques à l’échelle internationale.
- Consolider leur niveau d’anglais, quel que soit leur niveau d’entrée, afin d’entamer la deuxième année avec les outils linguistiques nécessaires pour parler de leur travail, interagir en contexte professionnel et aborder les grands courants de l’art et du design, contemporains.
- Acquérir un vocabulaire technique et spécialisé lié à leur domaine de pratique.
- Maîtriser les fondamentaux de la communication orale en anglais : poser des questions, y répondre, interagir dans des échanges variés.
- Participer à, ou animer, un entretien professionnel, une table ronde ou une conférence.
- Analyser, commenter et situer des œuvres, des expositions ou des événements artistiques, et relier ces éléments à leur propre démarche.
- Présenter leur travail personnel de façon structurée et pertinente.
- Comprendre et mettre en œuvre les principes d’organisation et de présentation d’une exposition.
Modalités et critères de l’évaluation :
Assiduité – Présence
Participation – Progrès à l’oral en fonction du niveau propre à l’étudiant·e en début d’année
Rendus en fin de semestre – Réalisation d’un vidéo tuto
Repères bibliographiques / références :
Podcasts
The Art Angle – Artnet News
Design Matters – Debbie Millman
99% Invisible – Roman Mars
The Great Women Artists – Katy Hessel
The Black Art Podcast – Darin B.
Newsletters
The Art Newspaper
Contemporary Art
Daily
Hyperallergic
Artsy
Dezeen
Artnet News
Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : Il n'y a pas de savoir innocent (S.F.)
Méthode d’enseignement :
L’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux, accompagnés par des séance de lectures de textes et commentaires d’œuvres. Le moment du cours magistral nous permettra d’établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d’interprétation des textes et des œuvres.
Objectifs du cours :
Produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
dessiner les contours d’une esthétique contemporaine qui dépasse l’approche classique à l’objet artistique et qui s’élargit à des questions anthropologiques, sociales et politiques ;
mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la frontière entre la théorie de l’art et sa pratique technique ;
affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création contemporaine et les sciences sociales;
favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l’actualité artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements actuels et passés ;
affronter la question de l’image et de son efficace à la lumière des réflexions sur le genre, la sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l’image reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogie de la réflexion iconologique ;
comprendre la portée philosophique de la question de l’image, sa contribution à la définition de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la culture post-digitale et les subjectivités numériques.
Contenu du cours :
Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l’abstraction et par une complexité sociale inédite, le recours aux catégories de authenticité, d’organicité ou l’appel à un « retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du point de vu de leur effectivité à l’échelle globale.
Ce cours est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogies, à leur courantes et à leur enjeux: rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l‘art contemporain et l’esthétique contemporaine; théories philosophiques de la forme, de l’espace et de l’objet; enjeux de l’esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et post-structuraliste françaises; philosophie de l’art américaine de matrice analytique; théories de l’image et des logiques imaginales; théories du visuel; théories du virtuel et des subjectivités numériques post-digitales. Le cours explore en particulier les relations entre ces domaines de recherche et les théories critiques de la technologique et du virtuel, en les contextualisant dans le champ élargi de la pensée critique contemporaine (en particulier méthodologies d’analyse féministes intersectionnelles et décoloniales, théories queer, théories critiques de la race et pensée anti-raciste, études post-coloniales et transnationales). Dans ce cours, l’interprétation de l’esthétique déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d’influences artistiques qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d’influences théoriques qui vont du Postmodernisme à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines et de l’activisme.
L’enseignement vise à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances des principes de l’esthétique, de la théorie de l’art, de la philosophie politique et de la philosophie critique. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une méthode de travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, examen oral, rendu écrit
L’évaluation se fera sur la base de la participation aux cours magistraux et sur la base de l’engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l’enseignement est fortement encouragée.
Repères bibliographiques / références :
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard
- Haraway, “Savoir situées” dans Manifeste cyborg et autres essais: Sciences – Fictions – Féminismes, Exils, 2007 Paris;
- Braidotti, La philosophie là ou on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009 (chapitres choisis)
- Braidotti, “Nomadism: Against Methodological Nationalism” dans Policy Futures in Education, Volume 8, Numbers 3 & 4 2010;
- Mignolo, “Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique” dans Mouvements 2013/1 (n° 73), pp. 181-190;
- B. Preciado, « Savoirs_Vampires@War », Multitudes 2005/1 (no 20), p. 147-147;
- B. Preciado, « Multitudes queer. Notes pour une politiques des « anormaux » », Multitudes 2003/2 (no 12), p. 17-25.
- Ahmed, “A phenomenology of whiteness” in Feminist Theory, 2007, 8: 149.
- Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie), Les Presses du réel, Paris 2018;
Penser à l’hauteur de la complexité du présent: de la post-modernité à la contemporanéité dans les seuils du capitalisme avancé
- Braidotti, Cyberfeminism with a difference, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source: FRAC Lorraine);
- Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
- Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris 2010 ;
- B. Preciado, « Biopolitique à l’ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères 2010/3 (N° 74), p. 241-257
- B Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Editions Grasset et Fasquelle, Paris 2008;
Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques
- Haraway, “Manifeste Cyborg” dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Exils, Paris 2007;
Laboria Cuboniks, Xenofeminism: A Politics for Alienation, laboriacuboniks.net;
- Haraway, Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, e-flux journal #75, September 2016;
- VV., « Subjectivités numériques », Revue Multitudes 2016/1(N. 61) (essais choisi)
Théorie de l’image et icolonogie contemporaines à l’épreuve de la pensée critique
- Mirzoeff (ed. by), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998;
- Alloa (sous la direction de), Penser l’image, Les Presses du Réel, Dijon 2010 (Essais choisis: contributions de Gottfried Boehm, Jean-Luc Nancy, W.J.T. Mitchell, Jacques Rancière, Georges Didi-Hubermann);
- Alloa (sous la direction de), Penser l’image Volume II. Anthropologie du visuel, Les Presses du Réel, Dijon 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém Flusser, Hans Jonas, Philippe Descola, Bruno Latour, Jan Assmann, James Elkins);
Musée, Expositions (P.R.)
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B.V.)
Méthode d’enseignement
Deux groupes de niveau :
A2-B1 : impliquant un renfort grammatical et lexical.
B2-C1 : visant à une pratique avancée.
Objectifs du cours
- Acquisition de culture artistique anglophone
- Asseoir ses compétences à l’écrit et à l’oral afin de présenter ses propres productions et celles d’autres artistes.
Contenu du cours
Approche de mouvements artistiques, ex : Arts and Crafts, St Ives School, Art in the Punk Years and the Young British Artists.
Présentation de productions artistiques.
Egalement, au semestre 2 :
Rédaction d’un bilan de l’année (‘first-year review’), en imaginant une forme créative (interview, manifeste, bd, poème, lettre…). Le support peut être papier, sonore, audiovisuel… Cette “review” est insérer dans le document de synthèse demandé en fin d’année universitaire.
Modalités et critères de l’évaluation
Contrôle continu, assiduité et participation requises. Expression écrite, expression orale, production écrite, production orale. Pour en savoir plus sur les différents types d’exercices à l’oral, se référer à la fiche générale intitulée « Communication orale – 1A à 5A »
Repères bibliographiques / références
outils en ligne, support papier :
- sites internet, réseaux sociaux : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
Carnet de recherche (P.R. & A.P.T.)
UE3 Bilan du travail plastique et théorique
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
Grille d'évaluations année 1 - semestre 2
UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
Workshop avec Ivana Müller CDCN (C.T.)
Méthode d’enseignement :
Les formations se fond par la pratique en atelier.
Contenu et objectifs du cours :
Formation des bases des pratiques informatiques sur l’image, la vidéo et le son pour que les étudiant aient une certaine autonomie dans leurs productions.
Anatomie d’un ordinateur : comprendre le fonctionnement d’un ordinateur
Présentation du fonctionnement du OS du machine Apple : C’est une mise à niveau pour ceux qui ont une pratique sur le OS Window.
Formation sur les différents formats image et leur utilisation en fonction des médias (RAW,JPEG,TIFF,PNG,GIF,EPS)
Prise de vue photo au format RAW et initiation à l’étalonnage photo
Initiation des bases du logiciel Photoshop CC et de GIMP
Initiation à l’écriture filmique
Initiation à la manipulation caméra (petite et les semi pro)
Initiation à la prise de vue
Formation sur le logiciel de montage Final Cut Pro X
Formation sur le logiciel de montage gratuit DaVincy Resolve
Formation sur Illustrator
Modalités et critères de l’évaluation :
Les évaluations se font en continue où chaque étape est pointée pour évaluer la maitrise de l’étudiant en sa présence pour qu’il puisse renforcer ses points faibles. La participation, l’assiduité et l’investissement de l’étudiant fait aussi parti de l’évaluation.
Workshop Poésie sonore (A.O. & A.J.R.)
Workshop Trois regards (C.T. & B.V.)
Workshop Un point c'est tout (S.R.)
Workshop Ecriture (C.B.)
Workshop (B.J.)
Workshop Modèles Vivantes (S.S.)
Atelier volume Du multiple à l'unique (J.S.P.)
Initiation InDesign (E.R.)
Méthode d’enseignement :
Dans un premier temps, visionnage et réflexion collective autour de mise en page et de livre existant. Mettre en évidence la relation entre la nature d’un contenu et son agencement sur la page. Transposer les éléments et réflexions des productions plastiques en choix graphique et éditoriaux.
Présentation des logiciels de mise en page et apprentissage des bases : créer d’un document, la page, les marges, les styles de paragraphes, le rapport texte / image, hiérarchie des différents contenus, la typographie,…
Contextualisation des documents de synthèse et prise en compte des besoins de chacun-e.
Lors de rendez-vous individuel ou d’exercices collectifs, définition des priorités et des objectifs personnels de l’étudiant·e.
Réalisation des gabarits de textes et d’images sur quelques pages pour que l’étudiant-e puisse par la suite travailler en toute autonomie.
Approfondissement des compositions et des choix graphiques. Réflexion sur l’objet imprimé, choix du format, du type de reliure, du papier,…
Dans un second temps, visionnage des fichiers numériques et vérification ou rectification des documents au vu d’une impression papier. Réalisation d’une première maquette papier suivie de l’impression finale des documents de synthèse.
Objectifs du cours :
Utiliser les outils et les logiciels qui permettent de produire des mises en page efficaces et cohérentes, des compositions qui mettent en valeur le contenu en relation avec son support, qu’il s’agisse d’un pdf, d’un livre, d’une affiche ou tout autre support adapté.
Penser et réaliser un projet imprimé à partir d’un contenu textuel et pictural existant issu des carnets de recherche du semestre 1 et du document de synthèse à faire au semestre 2.
Contenu du cours :
Apprentissage des logiciels de mise en page et sensibilisation aux compositions et choix graphiques, de la création d’un document numérique à l’impression papier. Alternance entre temps de travail collectif et travail en autonomie, l’étudiant·e élaborera et mettra en forme le document de synthèse.
Modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant·e à transposer ses réflexions et les éléments importants de sa production plastique en choix graphiques. Sa capacité à penser un objet imprimé dans son ensemble et à réaliser une mise en page lisible et adéquate au contenu en se saisissant des outils proposés.
Repères bibliographiques / références :
Des repères biblio-sitoragraphiques seront donnés en séances collectives et lors de rendez-vous individuels.
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Toute l'histoire de l'art ou presque (P.R. & K.S.)
Objectifs pédagogiques :
Découvrir l’histoire de l’art du XXe à aujourd’hui, de manière transnationale, au prisme des relations et des influences réciproques entre l’art et les problématiques politiques et sociales.
Méthode d’enseignement et contenu :
Loin d’être un champ isolé et préservé, l’art est constamment traversé et influencé par les questions politiques et sociales qui agitent le monde contemporain. Nous nous intéresserons aux formes d’engagement artistiques et à l’intrication de l’art et du politique à travers l’histoire de l’art du XXe et du XXIe siècles. Nous explorerons comment l’art se saisit de problématiques fondamentales comme celles des inégalités sociales, des oppressions, des conflits armés, des crises écologiques, économiques et sociales, ou encore de la résistance aux idéologies et aux régimes politiques autoritaires. En tant qu’espace de réflexion, de subversion, de résistance et d’opposition, nous verrons comment l’art peut constituer une forme d’action et de transformation.
Modalités et critères de l’évaluation :
Un examen écrit au S1 et une proposition artistique accompagnée d’une note d’intention au S2.
Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : Il n'y a pas de savoir innocent (S.F.)
Méthode d’enseignement :
L’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux, accompagnés par des séance de lectures de textes et commentaires d’œuvres. Le moment du cours magistral nous permettra d’établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes d’interprétation des textes et des œuvres.
Objectifs du cours :
Produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
dessiner les contours d’une esthétique contemporaine qui dépasse l’approche classique à l’objet artistique et qui s’élargit à des questions anthropologiques, sociales et politiques ;
mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la frontière entre la théorie de l’art et sa pratique technique ;
affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création contemporaine et les sciences sociales;
favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l’actualité artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements actuels et passés ;
affronter la question de l’image et de son efficace à la lumière des réflexions sur le genre, la sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l’image reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogie de la réflexion iconologique ;
comprendre la portée philosophique de la question de l’image, sa contribution à la définition de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la culture post-digitale et les subjectivités numériques.
Contenu du cours :
Dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l’abstraction et par une complexité sociale inédite, le recours aux catégories de authenticité, d’organicité ou l’appel à un « retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du point de vu de leur effectivité à l’échelle globale.
Ce cours est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogies, à leur courantes et à leur enjeux: rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l‘art contemporain et l’esthétique contemporaine; théories philosophiques de la forme, de l’espace et de l’objet; enjeux de l’esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et post-structuraliste françaises; philosophie de l’art américaine de matrice analytique; théories de l’image et des logiques imaginales; théories du visuel; théories du virtuel et des subjectivités numériques post-digitales. Le cours explore en particulier les relations entre ces domaines de recherche et les théories critiques de la technologique et du virtuel, en les contextualisant dans le champ élargi de la pensée critique contemporaine (en particulier méthodologies d’analyse féministes intersectionnelles et décoloniales, théories queer, théories critiques de la race et pensée anti-raciste, études post-coloniales et transnationales). Dans ce cours, l’interprétation de l’esthétique déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d’influences artistiques qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d’influences théoriques qui vont du Postmodernisme à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines et de l’activisme.
L’enseignement vise à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail et de raisonnement autant que des connaissances des principes de l’esthétique, de la théorie de l’art, de la philosophie politique et de la philosophie critique. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une méthode de travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, examen oral, rendu écrit
L’évaluation se fera sur la base de la participation aux cours magistraux et sur la base de l’engagement dans les modules de lecture et discussion. Une participation active et assidue à tous les moments de l’enseignement est fortement encouragée.
Repères bibliographiques / références :
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard
- Haraway, “Savoir situées” dans Manifeste cyborg et autres essais: Sciences – Fictions – Féminismes, Exils, 2007 Paris;
- Braidotti, La philosophie là ou on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009 (chapitres choisis)
- Braidotti, “Nomadism: Against Methodological Nationalism” dans Policy Futures in Education, Volume 8, Numbers 3 & 4 2010;
- Mignolo, “Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique” dans Mouvements 2013/1 (n° 73), pp. 181-190;
- B. Preciado, « Savoirs_Vampires@War », Multitudes 2005/1 (no 20), p. 147-147;
- B. Preciado, « Multitudes queer. Notes pour une politiques des « anormaux » », Multitudes 2003/2 (no 12), p. 17-25.
- Ahmed, “A phenomenology of whiteness” in Feminist Theory, 2007, 8: 149.
- Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature, philosophie), Les Presses du réel, Paris 2018;
Penser à l’hauteur de la complexité du présent: de la post-modernité à la contemporanéité dans les seuils du capitalisme avancé
- Braidotti, Cyberfeminism with a difference, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne Smolar (source: FRAC Lorraine);
- Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
- Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris 2010 ;
- B. Preciado, « Biopolitique à l’ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères 2010/3 (N° 74), p. 241-257
- B Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Editions Grasset et Fasquelle, Paris 2008;
Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques
- Haraway, “Manifeste Cyborg” dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes, Exils, Paris 2007;
Laboria Cuboniks, Xenofeminism: A Politics for Alienation, laboriacuboniks.net;
- Haraway, Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, e-flux journal #75, September 2016;
- VV., « Subjectivités numériques », Revue Multitudes 2016/1(N. 61) (essais choisi)
Théorie de l’image et icolonogie contemporaines à l’épreuve de la pensée critique
- Mirzoeff (ed. by), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998;
- Alloa (sous la direction de), Penser l’image, Les Presses du Réel, Dijon 2010 (Essais choisis: contributions de Gottfried Boehm, Jean-Luc Nancy, W.J.T. Mitchell, Jacques Rancière, Georges Didi-Hubermann);
- Alloa (sous la direction de), Penser l’image Volume II. Anthropologie du visuel, Les Presses du Réel, Dijon 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém Flusser, Hans Jonas, Philippe Descola, Bruno Latour, Jan Assmann, James Elkins);
Anglais - Théorie des Arts et Communication orale (B.V.)
Méthode d’enseignement
Deux groupes de niveau :
A2-B1 : impliquant un renfort grammatical et lexical.
B2-C1 : visant à une pratique avancée.
Objectifs du cours
- Acquisition de culture artistique anglophone
- Asseoir ses compétences à l’écrit et à l’oral afin de présenter ses propres productions et celles d’autres artistes.
Contenu du cours
Approche de mouvements artistiques, ex : Arts and Crafts, St Ives School, Art in the Punk Years and the Young British Artists.
Présentation de productions artistiques.
Egalement, au semestre 2 :
Rédaction d’un bilan de l’année (‘first-year review’), en imaginant une forme créative (interview, manifeste, bd, poème, lettre…). Le support peut être papier, sonore, audiovisuel… Cette “review” est insérer dans le document de synthèse demandé en fin d’année universitaire.
Modalités et critères de l’évaluation
Contrôle continu, assiduité et participation requises. Expression écrite, expression orale, production écrite, production orale. Pour en savoir plus sur les différents types d’exercices à l’oral, se référer à la fiche générale intitulée « Communication orale – 1A à 5A »
Repères bibliographiques / références
outils en ligne, support papier :
- sites internet, réseaux sociaux : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
Exposition, concept, sensation (P.R.)
UE3 Bilan du travail plastique et théorique
Document de synthèse (direction partagée)
Méthode d’enseignement :
Une première séance collective en début de second semestre (en suivi d’année) est destinée à présenter les objectifs, les finalités, les possibles, à partir d’exemples choisis dans les productions antérieures et de travaux éditoriaux.
Un deuxième temps, lors d’un rendez-vous individuel avec lea directeur·ice de recherches, est consacré à l’accompagnement à la recherche d’information (sources et bibliographies), à la rédaction (vocabulaire spécifique, identification des « parentés » artistiques et intellectuelles) et à la mise en forme.
NB : les rendez-vous avec l’enseignant·e directeur·ice de recherches seront pris par l’étudiant·e, de sa propre initiative.
Objectifs du cours :
Le document de synthèse est la restitution d’une analyse du travail réalisé tout au long de l’année. Il nécessite une prise de recul et une mise à distance des projets afin de mieux pouvoir se projeter dans la deuxième année. Ce travail réflexif a pour but de mettre en relief les expériences les plus significatives du parcours, à travers un document alliant des images ou des formes à un texte personnel élaboré en lien avec des auteur·es et des artistes rencontré·es lors des recherches (lectures, écoutes, visites d’expositions, etc.).
Le document de synthèse comportera un texte rédigé de 20 000 signes (± 10%). Les notes, légendes d’images, sommaire et biblio-sitographie étant en plus de ce contenu.
Contenu du cours :
Lors de temps en suivi d’année, en bibliothèque, mais surtout lors de temps dédiés au travail en autonomie, l’étudiant·e élaborera, rédigera et mettra en forme le document de synthèse, suivi par un·e enseignant·e lors de rendez-vous individuels à l’initiative de l’étudiant·e.
Le document sera présenté en fin d’année à un·e directeur·ice de recherches issu·e de l’équipe pédagogique.
Le document de synthèse sera également montré et présenté lors de l’accrochage du bilan d’année, fin mai.
Modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant·e à amorcer une réflexion sur son travail et ses enjeux et à l’articuler avec des références artistiques, littéraires, philosophiques, etc. Seront également évaluées les qualités d’écriture et de mise en forme. Le document de synthèse sera pris en compte dans sa forme aboutie dans le cadre du bilan général du second semestre.
Repères bibliographiques / références :
Des repères biblio-sitoragraphiques seront donnés en séances collectives et lors de rendez-vous individuels.
Bilan : accrochage et présentation orale
ANNÉE 2 - Option Art
L’organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d’une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d’expositions.
Tous les cours et ateliers sont obligatoires. Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules. Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l’étudiant·e de penser sa pratique au-delà d’un medium spécifique. Les enseignements pratiques d’ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l’on pense en médium comme l’on fabrique avec la pensée, la culture et l’histoire. De même, l’on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire… Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d’espaces d’échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d’interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant·es. Ces enseignements croisés n’en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant·es. L’évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant·e travaille sur les projets proposés par des enseignant·es en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant·es. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant·es assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l’étudiant·e présentera l’évolution de ses travaux.
L’étudiant de l’année 2 doit commencer à faire des stages, afin de les continuer au semestre 5 et les valider au semestre 6.
Liste des unités d'enseignements
Semestres 3
UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 16 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS
UE3 : Recherches et Expérimentations – 2 ECTS
UE4 : Bilan – 4 ECTS
Semestre 4
UE1 : Méthodologie, techniques et mises en oeuvre – 14 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS
UE3 : Recherches et expérimentations – 4 ECTS
UE4 : Bilan – 4 ECTS
Grille d'évaluations Art 2 - Semestre 3 :
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Atelier de Recherche et Création - Documenter le Monde (F.N.)
Atelier de Recherche et Création - Playlist Remix (M.T.)
Méthode d’enseignement :
Recherches individuelles et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, séances d’écoutes, séances de lectures, production d’objets rendant compte de la recherche, exercices de courte et de longue durée, présentation publique.
Avec également :
Une résidence de recherche de 6 jours avec 6 étudiant·es de l’ARC à Centrale Fies – Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, avec un workshop animé par l’artiste Publik Universal Frxnd (octobre 2025)
Un workshop de transmission à l’ARC par les étudiant·es ayant participé à la résidence
Un workshop de drag imaginé avec les étudiant·es Emmanuel·le Garin et Faustine Stricanne
Un·e ou deux invité·es pour un ou deux workshops
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Démystifier la performance
Produire ou interpréter des formes, gestes, textes, chansons, etc.
Travailler des formats de collaboration et/ou en collectif
Contenu du cours :
En partant de la place que la musique occupe dans nos mémoires et de la manière dont elle structure nos souvenirs, l’ARC Playlist Remix 2 s’inscrit dans le cadre du programme de recherche What’s love got to do with it?, qui explore comment nos émotions nous informent sur le monde et comment, en tant qu’artistes, nous pouvons apprendre de la façon dont ces émotions génèrent des récits. Avec les intervenant·es invité·es, nous nous pencherons également sur les pratiques musicales ou performatives, ainsi que sur les notions de spectacle et de fête.
*Sur la résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies(https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture du parcours Performance, du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025.
L’objectif est de vivre une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel situé dans une ancienne centrale hydroélectrique, près de Trente, en Italie (https://www.centralefies.it/building/). Ce lieu accueille un festival de performance depuis plus de 45 ans et collabore avec des écoles telles que le Dutch Art Institute (Amsterdam/Arnhem) et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence permettra notamment :
- Une formation aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) avec un technicien de Centrale Fies
- Un workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), basé·e à Amsterdam, dont la pratique queer articule performance et musique
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, régularité de la participation, qualité des recherches et soin dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dynamique collective de l’atelier.
L’évaluation portera également sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Atelier de Recherche et Création - Confluence (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique sur sites.
Exposition dans la galerie de l’école.
Objectifs du cours :
Eau qui médite, enclos du temps.
Paupière close. Un silence qui écoute.
Eric Hurtado
Questionner par la photographie et la vidéo le territoire d’une rivière, son bassin, son déploiement, sa confluence avec l’activité humaine. Nous questionnerons également notre conscience de celle-ci, confluence elle-même de l’existence de la rivière avec notre regard. La question du réel, toujours, rivière qui coule et semble fixe.
« L’image est au confluent de la lumière venue de l’objet et de celle qui vient du regard. » PLATON
Contenu de cours :
L’Arc débutera par la projection de Stalker, d’Andreï Tarkovski, film questionnant la réalité d’un territoire et la conscience des inventeurs de celui-ci (au sens réunissant découverte et invention, justement arcane fondamental de la quête photographique.)
Suivront deux journées de rencontre et d’atelier photographique avec le photographe Jean- Marc Blache, qui a photographié l’eau sous toutes ses formes, de la glace à l’exploration sous-marine dans de nombreux pays. Il nous accompagnera lors d’une séance de prises de vues sur le territoire du Drac, au sud de Pont-de-Claix et pour la restitution des travaux.
Chaque quinzaine, en semaine B, une des deux journées de travail de l’Arc sera consacrée à une sortie de prises de vues en extérieur sur le thème de l’eau.
Un voyage pédagogique est également prévu dans le Vercors à la grotte de Choranche.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à l’issue de l’Arc dans la galerie de l’École.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Films :
Andreï Tarkovski, Stalker
Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu
Michelangelo Antonioni, Gente del Po
Désert Rouge
Jean-Luc Godard, Opération Béton
Jean Giono, L’eau vive
Livres :
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Raymond Depardon, Errance. Points/Seuil
Roland Recht, La lettre de Humboldt, Christian Bourgois
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Atelier de Recherche et Création - Sphère (B.J.)
Méthode d’enseignement :
La sphère est un concept formel. Cet ARC est donc une proposition pour investir une forme dont la dynamique globale, sur le artistique, est abstraite. Mais l’idée de sphère est susceptible de s’imprégner d’éléments variés, comme celui de l’écologie par exemple (la terre est un écosystème sphérique), ou par des investigations fictionnelles (Sphère est le titre d’un film de science-fiction).
L’idée de sphère peut être investie de façon diverses : sur des supports digitaux (film, 3D), ou matériel (peinture, installation, photographie, performance). L’IA peut également être utilisée.
Objectifs du cours :
Cet ARC vous invite à plonger dans l’univers de la sphère, une forme universelle qui traverse l’art, la science, la philosophie et la nature. Symbole d’harmonie, de perfection et d’unité, la sphère est aussi une métaphore puissante pour réfléchir à la fragilité de notre planète Terre, un écosystème menacé par les activités humaines. À travers cet ARC, vous explorerez les dimensions formelles, symboliques et écologiques de la sphère à travers une œuvre ou plusieurs dans le médium de votre choix : dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, performance, multimédia, vidéo, 3D. Cet exercice est une occasion de conjuguer réflexion conceptuelle et engagement environnemental.
Contenu du cours :
Objectifs pédagogiques
- Explorer les caractéristiques formelles et esthétiques de la sphère.
- Intégrer une réflexion écologique en lien avec la Terre, sphère fragile et écosystème précieux.
Thèmes d’exploration autour de la sphère
La sphère, par sa simplicité et sa perfection, offre une multitude de pistes à explorer dont voici quelques exemples : :
- Forme et esthétique : géométriquement, la sphère est la forme la plus équilibrée, où chaque point de sa surface est équidistant de son centre. Dans l’histoire de l’art, elle inspire des œuvres architecturales (comme les dômes de Brunelleschi) ou sculpturales (les sphères polies d’Anish Kapoor). Comment pouvez-vous jouer avec la tridimensionnalité, les reflets, les ombres ou les illusions optiques pour réinterpréter la sphère ? Considérez les jeux de lumière, de texture ou de transparence dans votre travail.
- Symbolisme et philosophie : La sphère a longtemps incarné l’idée de perfection et d’infini. Pour les anciens Grecs, elle représentait le cosmos, une harmonie universelle. Dans l’art contemporain, elle peut évoquer l’unité, l’isolement ou la cyclicité du temps. Pensez aux installations immersives de Yayoi Kusama, où les sphères répétées créent un sentiment d’infini.
- Écologie et fragilité planétaire : La Terre est un écosystème complexe et vulnérable, confronté à des défis comme le changement climatique, la déforestation et la pollution. En tant qu’artistes, vous pouvez utiliser la sphère comme une métaphore pour alerter sur ces enjeux. Pensez à des matériaux de récupération ou à des installations qui évoquent la fragilité de notre environnement.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Format : Œuvre physique ou numérique.
- Recherche préparatoire : Au début de l’ARC, un moment d’échange qui s’appuiera sur une présentation visuelle d’images vous proposera des pistes de travail à travers la présentation d’un certain nombre d’exemples. Le domaine de l’art est privilégié mais il sera aussi question d’architecture, selon un choix lié à la forme sphérique. Lors de cette phase préparatoire, vous ressemblerez des références visuelles, textuelles ou conceptuelles dans un carnet de recherche pour trouver votre ou vos idées. Nous discuterons ensemble de ces projets et vous passerez ensuite à la réalisation.
- Production : vous aurez tout le premier semestre pour mettre au point votre réalisation. Vous produirez une œuvre dans le médium de votre choix. Il sera possible d’effectuer plusieurs travaux ou un seul s’il est suffisamment complexe pour justifier cette durée dans le temps.
- Dimension écologique : Intégrez une réflexion sur l’environnement, que ce soit par le choix de matériaux durables, un message visuel sur la crise climatique ou une œuvre qui incite à repenser notre relation à la Terre.
- Rythme des échanges : Je serai présent les lundi et mardi selon l’emploi du temps auquel vous devrez vous référer pour être présents à chaque fois. Les rencontres se feront de préférence de façon collective mais auront lieu également à travers des entretiens individuels.
- Présentation / évaluation : Fin janvier, vos œuvres seront accrochées lors du bilan à travers un accrochage collectif dans notre salle allouée à l’ARC et donneront lieu à un échange de points de vues et d’analyses.
METHODOLOGIE :
- Dessin/peinture : vous expérimenterez la forme de la sphère selon vos aspirations formelles. Les supports meuvent varier, pensez à expérimenter d’autres surfaces que le papier ou la toile.
- Sculpture/installation : vous utiliserez des matériaux disponibles à l’atelier de l’école ou des matériaux de recyclage que vous aurez glané (plastique, métal, bois) ou éphémères (terre, papier) pour construire une sphère ou une composition sphérique. Vous pourrez intégrer des projections, des sons ou des animations pour créer une expérience immersive autour du thème. Dans ce sens, pensez également à solliciter le matériel disponible dans le domaine de la lumière dont dispose l’école.
- Photographie/vidéo : jouez sur des paramètres de cadre, de lumière, pour construire des images dont la structure principale est sphérique. Le montage de films pourra se faire sur Final cut Pro ou Da Vinci Resolve.
- Performance : Les scénarios sont ouverts : mouvements circulaires, répétition, etc. (voir Abramovic et Ulay).
Repères bibliographiques / références art et architecture :
ART :
- Anish Kapoor : Ses sculptures sphériques, comme Cloud Gate, jouent avec les reflets et la monumentalité pour transformer l’espace et la perception. Sa série Sky Mirror présente également des surfaces paraboliques et circulaires.
- Tara Donovan : Une artiste américaine qui utilise des matériaux du quotidien (gobelets, pailles…) pour créer des installations organiques évoquant des formes sphériques ou cellulaires.
- Michelangelo Pistoletto : sa performance Newspaper Sphere interroge l’accumulation et la boulimie d’information à travers un processus d’accumulation performative.
- Marina Abramovic / Ulay : Relation dans le mouvement – une performance historique entre le mythe de Sisyphe (Camus) et celui de l’Eternel Retour (Nietzsche).
- Yayoi Kusama : connue pour ses motifs à pois omniprésents, elle utilise la forme ronde dans ses peintures, sculptures et installations immersives, créant des expériences infinies et psychédéliques.
- Olafur Eliasson : artiste danois-islandais qui explore souvent les formes géométriques, y compris la sphère, dans des installations qui jouent avec la lumière, la perception et les phénomènes naturels. Son œuvre The Weather Project avec son immense soleil artificiel sphérique en est un exemple marquant.
- Richard Long : associé au Land Art, il utilise souvent des formes géométriques simples trouvées dans la nature, comme des cercles de pierres.
- Michel Verjux : Un artiste visuo-spatial contemporain, poète et théoricien de l’art, mentionné ici pour ses sculptures de lumière utilisant des projections minimalistes rondes pour des expériences physiques utilisant l’espace et l’architecture comme support.
- Les artistes de l’Op Art (comme Victor Vasarely) : Bien qu’ils aient exploré diverses formes géométriques, le cercle et les formes rondes étaient essentiels pour créer des illusions d’optique de mouvement et de profondeur.
- Xavier Veilhan : artiste français aux registres étendus mentionné ici essentiellement pour ses mobiles inspirés de Calder, entre équilibre et déséquilibre, dont la finalité se situe peut-être dans un processus de déstabilisation de la sculpture.
- Karina Smigla Bobinsky, artiste germano-polonaise, mentionnée ici pour son installation interactive de 2018 présentant une sphère dans une pièce vide manipulable par les visiteurs.
ARCHITECTURE :
- Antti Lovag : l’architecte des maisons bulles, précurseur de la blob architecture et de l’architecture organique.
- Cabinet d’architecture Populous Severud Associates : La sphère de Las Vegas et son ingénierie de science-fiction.
- La Blob architecture : un terme donné à un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.
Artistes dans l’Histoire :
- Sandro Botticelli : Dans sa peinture La Madone du Magnificat, la forme circulaire (du tondo, support rond) encadre la Vierge et les anges, une forme courante à la Renaissance pour les sujets religieux.
- Jérôme Bosh : La création du monde.
- Ingres : Le bain turc, autre référence célèbre de peinture peint sur un tondeauen tant que peinture ronde, en écho aux rondeurs des corps.
- Fernand Léger : Au début du 20e siècle, il a intégré des formes cylindriques et circulaires dans son travail, décomposant les objets en éléments géométriques. Son tableau Les Disques dans la ville en est un exemple.
- Robert Delaunay et Sonia Delaunay : Pionniers de l’Orphisme, un dérivé du cubisme, ils ont utilisé des disques de couleurs et des formes circulaires pour explorer la lumière et le mouvement.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres artistes seront présentés comme sources d’investigation et d’inspiration lors du commencement du workshop à la rentrée.
Annexe : La Sphère comme exploration artistique : une lecture à travers Peter Sloterdijk
Dans sa trilogie Sphères, le philosophe Peter Sloterdijk propose une réflexion profonde sur cette forme, non seulement comme objet géométrique, mais comme métaphore de l’existence humaine, de l’espace et des relations. Ses idées offrent un cadre conceptuel riche pour explorer la sphère en tant que motif, symbole et espace de création.
Sloterdijk décrit la sphère comme une structure fondamentale de l’être-ensemble : L’homme est l’animal qui vit dans des sphères qu’il produit lui-même (Bulles, 1998). Cette idée invite les artistes à envisager la sphère non pas comme un simple volume, mais comme un espace de vie, un contenant intime où se tissent des relations. Dans ce sens, vous pourrez explorer des installations sphériques, jouant avec des matériaux transparents ou opaques pour exprimer cette tension entre intériorité et extériorité.
Les sphères sont des globalisations réussies, des mondes en miniature (Globes, 1999). Cette citation peut inspirer des œuvres qui questionnent l’idée de globalité : une sphère peut-elle contenir le monde ? Les étudiants peuvent créer des microcosmes sphériques, intégrant des fragments d’images, de sons ou d’objets, pour réfléchir à l’ambition de l’art de représenter l’universel à travers une forme finie.
Enfin, dans Écumes, Sloterdijk introduit la notion de sphères multiples et interconnectées : Nous vivons dans des écumes, des agrégats de sphères qui se touchent sans se fondre (Écumes, 2004). Cette image d’écumes, où chaque sphère est à la fois autonome et liée aux autres, pourrait guider des projets collectifs. Cette idée peut également s’envisager sous une forme plastique en deux dimensions, peinture, dessin…
En somme, la sphère, chez Sloterdijk, est bien plus qu’une forme : elle est un espace philosophique, poétique et relationnel. En s’appuyant sur ces concepts, vous pourrez explorer des médiums variés (sculpture, performance, installations immersives) pour interroger la sphère comme lieu de protection, de rêve ou de tension.
Atelier de Recherche et Création - Art and the city (S.S.)
Atelier de Recherche et Création - Le Banquet (P.R. & C.B. & A.O.)
Méthode d’enseignement :
Proposer des situations autour du repas lors desquelles les étudiant·es sont invité·es à répondre systématiquement. Mise en place d’exercices réguliers et création de protocoles autour de la cuisine. Les temps de cuisson, le dressage de la table, l’assaisonnement d’un plat seront des moments pédagogiques parmi d’autres.
Objectifs du cours :
Tous les mardis, développer collectivement des temps de recherche, de discussion et de création dans le cadre d’un repas. Faire la cuisine, manger ensemble, la digestion comme expérience simultanée, la vaisselle et le rangement seront les principaux objectifs de l’ARC. Mettre en œuvre le Symposium de fin de semestre en tant que forme artistique collective.
Contenu du cours :
Tous les mardis s’organiseront autour des repas de midi, depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Les déjeuners du mardi midi feront partie de l’ARC, chacun·e ramènera des ingrédients. Nous élaborerons des repas thématiques en questionnant l’économie d’un repas, les manières de faire, l’hospitalité. Nous pratiquerons l’art de la conversation, réfléchirons au vocabulaire de la cuisine dans sa polysémie, nous pratiquerons le “toast” comme forme poétique etc. Quelle différence entre faire la cuisine dans un restaurant, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine dans une école d’art? Quelle différence entre manger au restaurant, manger chez soi, manger dans une école d’art?
Chaque séance permettra de proposer des formes et préparera la séance suivante.
L’ARC sera aussi le laboratoire de préparation du Symposium qui se tiendra dans la Grande Galerie de l’ESAD le 13 janvier. Nous adresserons des invitations à des personnes choisies, élaborerons un menu et un programme de formes, de gestes et de prises de parole.
Modalités et critères de l’évaluation :
Participation à l’ensemble des temps de l’ARC sans exception et à l’organisation du Symposium du 13 janvier.
Repères bibliographiques / références :
-Karen Blixen, Le dîner de Babette, 1961 (1ere ed. danois 1958).
-Ludovic Burel, Le laboratoire de fermentation, it: éditions, 2025.
-Sally De Kunst et al., This Book is yours. Recipes for artistic collaboration/Recettes pour la collaboration artistique, Art&Fiction publications – Vexer Verlag, 2019.
-Thien Uyen Do, Fermentation rébellion, édition des Equateurs, 2024.
-Marguerite Duras, La cuisine de Marguerite, B. Jacob, 1999.
-Claire Gausse, Louise Drulhe, Cantines de quartier : la recette du lien, éditions 369, coll. Manuels, 2018.
-Emmanuel Guillemain d’Echon, Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis. Routes, recettes et tours de main, Keribus Éditions, 2024.
-Dorothy Ianonne, A CookBook, (edition anglaise), Presses du Réel, 2019.
– Lauren Malka, Mangeuses : histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, ed. les Pérégrines, 2023.
-Gaëlle Ronsin, Ajouter un couvert pour l’anthropologue, Les éditions de l’épure, 2024.
– Niki Segnit, Le répertoire des saveurs, Marabout, 2012.
-Yoann Thommerel, Manger low cost, édition Nous, coll. Disparate, 2025.
-Alice B. Toklas, Le livre de cuisine d’Alice Toklas, (Traduction de : The Alice B. Toklas cook book), les Éd. de Minuit, 1999.
-Gabriel Axel, Le festin de Babette, 1987 (film).
-Luc Moullet, Genèse d’un repas, 1978 (film).
Atelier de Recherche et Création - Bifurcations et chants photosynthèses (E.D.F.)
Intitulé du cours : ARC : Bifurcations et chants-photosynthèses
À la suite de l’Arc « Ré-ouvrir les futurs » et « Terre-strates-récits », troisième chapitre d’un cycle d’enseignement intitulé “DES CHEMINS HYBRIDES”, Imaginer en 2050 êtres et territoires, entre Trièves et Grenoble.
Intervenant.e.s : Stéphanie Sagot et Pascal Aspe (Ferme des MillePousses). Lisa Panico et Thomas Klein, chargé.e.s de la réouverture au public du Centre horticole de Grenoble.
Méthode d’enseignement :
Dans une approche transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation dans le Trièves et le Massif du Vercors avec un travail dans les ateliers de l’ÉSAD. Nous bénéficierons d’expériences d’apprentissage et de chantier participatif avec le nouveau projet d’agriculture urbaine de Mille Pousses Grenoble, dirigé par Pascal Aspe. Nous nous rendrons dans le Trièves pour apprendre de la ferme collective Sainte-Luce et puis dans le Vercors pour un arpentage-lecture de paysage et botanique.
Nous continuerons nos échanges et séances d’apprentissage avec le Centre Horticole de la ville de Grenoble, avec lequel est un partenariat est noué.
Un atelier est également prévu avec Stéphanie Sagot, artiste qui explore depuis vingt ans les liens entre environnement, agriculture et alimentation. Chaque étudiant.e travaillera à partir d’un projet personnel. Nous rencontrerons au début de l’anéée l’artiste baniwa et brésilien Denilson Baniwa, qui nous présentera certains de ses travaux en lien avec le végétal.
Durant le semestre, des journées de réflexion et d’échanges seront également co-organisées avec les ARC et les IR de la mention Territoire et Société. Ainsi une rencontre et un temps d’échange est prévue avec l’ARC de Slimane Raïs intitulé « L’Air de rien… ».
Objectifs / contenu du cours :
En menant des recherches sur les spécificités historiques, environnementales et sociales du territoire entre le Trièves et la métropole Grenobloise articulant espaces urbains, ruraux et montagneux, il s’agira d’imaginer à travers objets et fictions futuristes, les liens pouvant se développer entre sculpture, installation, outil agricole et leurs lieux d’activation : l’exposition, le champ et les espaces de collectes et récoltes.
Pour la troisième édition de cet ARC, nous plongerons, en compagnie des intervenant.e.s et partenaires de ce cycles, dans des visions futuristes de possibles hybridations entre plantes et humains. Partant des écrits de Lynn Margulis et Dorion Sagan au sujet de l’apparition de l’Homo photosyntheticus, nous réfléchirons aux multiples scénarios extraordinaires que l’évolution des espèces permet.
Ces recherches nous demanderont une attention aux différentes échelles composant nos mondes. Comment appréhender les points de vue d’un insecte, d’une plante, d’un micro-organisme, d’un oiseau, d’un humain, d’une forêt, d’une montagne, ou d’une bio-région, et quelles manières peut-on hybrider, mettre en commun, et mettre en scène ces différentes corporéités ?
À partir d’une sensibilisation à ces différentes échelles, de quelle manière pouvons-nous penser et raconter les mouvements, les interactions et les migrations des êtres humains et végétaux à des horizons futurs ? Dans le contexte du Trièves et de la métropole de Grenoble, quelles alliances, quels récits, quelles hybridités possibles ?
Ainsi, en apprenant de la botanique et de l’ethnobotanique, en s’inspirant des recherches scientifiques sur l’évolution futur du climat et de l’environnement, sur l’évolution des sciences du vivant, en apprenant de la littérature des imaginaires (ou « science-fiction ») et des multiples formes de l’agriculture et de production de nourriture, nous imaginerons de possibles hybridations entre formes artistiques, agricoles et écologiques.
Dans une conjoncture, où le présentisme, les visions progressistes, spéculatives, ségrégationnistes et productivistes fragilisent fortement des modes de vies à l’échelle locale comme planétaire, il est crucial de ré-ouvrir les futurs et envisager une multitude de possibilités pour un avenir durable et symbiotique, construit d’interactions multiples, d’échanges entre différences, et d’espace de communs.
À l’horizon 2050, quels objets et quelles formes, quelles transformations du territoire, quelles représentations ou expressions peuvent engendrer de telles collaborations ?
À partir de méthodes transdisciplinaire, et à travers ce dialogue entre arts, agricultures et sciences, comment imaginer dans ces futurs des interactions entre un lieu et un territoire (un éco-système, un jardin, un champ, un quartier, une rivière, une intervention artistique in-situ), des objets (œuvres, outil et instrument) et des représentations (récit, narration, mise en scène) ?
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre, capacité à présenter et échanger à l’oral. Présence, assiduité et participation, assiduité, dialogue.
Repères bibliographiques / références :
L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021.
Karen Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, 2023
Emma Bigé, Clovis Maillet, Écotransféminismes, Pour des écologies transféministes, 2025
Octavia Butler, Parabole du Semeur, 1993.
Terres et liberté : Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, 2025
Patrick Chamoiseau, Les Neuf consciences du Malfini, 2009
Julie Crenn et Lauriane Gricourt, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024
Tj Demos, Radical Futurisms -Ecologies of Collapse/Chronopolitics/Justice to Come, 2023.
Donna J. Haraway Camille Stories, dans Vivre avec le Trouble, 2016.
Lynn Margulis, Dorion Sagan, L’univers bactériel, 1986
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées, 2013.
Ursula K. Le Guin, La Vallée de l’éternel retour, 1985.
Sébastien Marot, Taking the country’s side. Agriculture and architecture, 2019
William Morris, Nouvelles de Nulle Part, 1890.
Vandana Shiva, Jacques Caplat et André Leu, Une agriculture qui répare la planète, Les promesses de l’agriculture biologique régénérative, Actes Sud, 2021.
Œuvres et travail de : Atelier Paysan, Inland, Agence Coloco & Gilles Clément, FutureFarmers, Asunción Molinos Gordo, William Morris, Marjetica Potrc, Elisa Strinna, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Åsa Sonjasdotter, Otolith Group, Natsuko Uchino.
Atelier Pratique - Blender's Abstract Vibe (B.J.)
Méthode d’enseignement :
Travail sur le logiciel Blender et sur son interopérabilité avec les logiciels de montage Final Cut Pro et Da vinci Resolve. Cela signifie que ces autres logiciels sont également pris en compte dans l’enseignement.
Objectifs du cours :
Apprendre à créer des formes abstraites dans Blender, configurer des matériaux avec la transparence alpha et exporter des séquences d’images avec le canal alpha pour une utilisation composite dans des logiciels de montage (Final Cut Pro, Da vinci Resolve ou Gimp pour des travaux statiques). Cela pourra également donner lieu à quelques aperçus de la fonction tracking de Blender.
Contenu du cours :
Apprentissage des principes de production 3D dans Blender et compréhension de l’écosystème d’image à partir de la couche Alpha et des jeux de transparences. Concepts clés : modélisation, texturage, UV mapping, animation, montage, compositing, rendu.
Modalités et critères de l’évaluation :
Sera évalué la qualité du travail, la concentration de l’étudiant sur son projet, son degré de participation au cours lors des échanges. La présence en cours est un élément clé de l’évaluation.
Repères bibliographiques / références :
Simulacre et simulation (Jean Baudrillard)
Eloge de la simulation (Philippe Quéau)
Atelier Pratique - Brico Musique (F.N.)
Méthode d’enseignement :
La philosophe théoricienne Agnès Gayraud, dans son essai Dialectique de la pop, défini la musique pop comme étant : ”les musiques populaires enregistrées” et, par extension, diffusées et distribuées. En s’appropriant cette idée et en inscrivant le procédé de fabrication au centre de la réflexion, BRICO MUSIQUE envisage la création musicale comme un pratique accessible, joyeuse, et performative. Avec l’économie de moyens comme moteur de formes singulières, et expressives.
Objectifs du cours :
– Comment s’approprier l’outil informatique pour composer de la musique ?
– La musique pop a-t-elle des limites ?
– Comment performer la musique pop en live ?
– L’économie de moyens comme vecteur d’émancipation
– Comment prendre du recul face à la dichotomie art et industrie, inhérente à la musique pop ?
Contenu du cours :
BRICO MUSIQUE est un cycle pédagogique mené à l’ESAD Grenoble depuis trois saisons, s’articulant autour d’ateliers, de workshops, d’interventions.
Son objectif est de pratiquer et fabriquer de la musique pop contemporaine, tel une matière à détourner, à déconstruire, à rejouer. Il s’agit d’en faire un terrain d’expérimentations et un objet esthétique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continue
Repères bibliographiques / références :
Le workshop en partenariat avec Le CIEL s’attachera quant à lui, à poursuivre sa lancée et pousser plus loin les gestes performatifs et collaboratifs en live. Il sera aussi question d’investiguer sur la capacité de déconstruction et de réinvention de la musique pop en live, qui en font un objet plastique à part.
Vous trouverez sur via lien une playlist des films documentant les différents workshops BRICO MUSIQUE au CIEL depuis 2024 : https://urlr.me/75MFet
Atelier Pratique - Edit (A.O.)
Méthode d’enseignement :
Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l’embaussage à froid, le gaufrage, et d’autres techniques encore inexplorées. Mise en commun de savoir-faire technique.
Partage de données.
Objectifs du cours :
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession et de rythme. Comment le support papier, les doubles pages et leurs successions peuvent rendre compte des intentions ? Mettre en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Contenu du cours :
Un atelier
Qui part d’un besoin d’édition
Qui explore les éditions d’artistes
Qui propose des micro-expositions
Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Il s’agit d’effectuer un travail de mise en page, de mise en relation, de penser plastiquement le format et le rythme de succession des pages. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence et participation.
Repères bibliographiques / références :
Le travail d’atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentes à la bibliothèque et dans d’autres lieux de ressources.
Atelier Pratique - Fabriquer de l'image (C.T.)
Méthode d’enseignement :
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation et d’apprentissage, d’accompagnement, de production, permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.
Objectifs du cours :
À travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement…
Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC, finition/présentation).
Contenu du cours :
Il est proposé aux étudiants d’engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.
Au cours des deux première séances d’Octobre, l’appropriation des nouveaux espace du labo photo et l’exploration du medium se feront à travers une expérimentation collective de la photo-sensibilté alliant papier et film.
Ces productions seront présentées en novembre dans une exposition inaugurale des espaces du Pôle Image.
Plus globalement, les travaux seront conduits autant en prise de vue, que ce soit en extérieur ou en studio (film argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique…).
Les étudiants viendront à l’atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d’en faire l’inventaire et d’en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt de l’ESAD. Les consommables photographiques (films, papiers et chimies) seront fournis pour les travaux en AP.
Modalités et critères de l’évaluation :
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme à déterminer : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan.
Repères bibliographiques / références :
LLANG Thomas. https://www.thomaslang.fr/gestalt
MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d’une ville 1987-89.
SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
GENESTE Guillaume: Le tirage à mains nues. Edité par La main donne 2020.
À emprunter à La Bibliothèque d’étude et du patrimoine. Fonds moderne SL 771 GEN
Emission Par les temps qui courent ( France Culture 20/10/2020 durée : 00:44:56 ) – par : Marie Richeux, Jeanne Aléos, Romain de Becdelievre – nous recevons le tireur et photographe Guillaume Geneste. Avec lui nous discutons de son travail en laboratoire, de l’émotion devant une planche contact et de son ami Denis Roche. – réalisation : Jean- Christophe Francis, Lise-Marie Barré – invités : Guillaume Geneste Qui réalise des tirages de grands photographes https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-jeudi-22-octobre-2020
DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009. http://www.michelcampeauphotographies.com/
WOLFF Ilan « Camera Obscura at work » 1982-1997 et http://www.ilanwolff.com/
https://www.culture.gouv.fr/fr/espacedocumentation/bases-de-donnees/Fiches-bases-de-donnees/arago-le-portail-de-la-photographie Musée en ligne de la photographie permettant d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en France.
Exposition de Pascal Sarrazin à l’Espace Nelson Mandela de Fontaine jusqu’au 11 octobre 2025.
Journées de la photographie de la Maison de l’Image, les 8 et 9 novembre 2025 à l’Ancien Musée Bibliothèque, place de Verdun (https://www.maison-image.fr).
Atelier Pratique - L'eau ça coule et ça mouille (S.R.)
Atelier Pratique - Quels matériaux pour représenter les futurs ? (E.D.F.)
Méthode d’enseignement :
Chaque étudiant·e travaillera à partir d’un projet personnel. Dans une approche résolument transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation à partir de différentes visites dans un ou plusieurs sites de la métropole de Grenoble : entreprises et associations travaillant sur de matériaux recyclées, durables et écologiques comme l’association G-Recip, le département CraTerre (école d’architecture), la Design Factory de l’Université Grenoble-Alpes, MTK et autres lieux à confirmer.
Nous serons également en dialogue régulier avec Giulia Bellinetti (coordinatrice du Nature Research department et du laboratoire Future Materials Lab à la Jan Van Eyck Academy).
Objectifs et contenu du cours :
Dans les contextes environnementaux et sociaux que nous connaissons, il est indispensable d’engager une réflexion sur les matériaux utilisés, et de favoriser les circuits les plus courts et les plus éthiques mais aussi le réemploi ou le recyclage. Quelle vie des œuvres, quels devenirs des œuvres ? Comment prendre en compte le caractère éphémère ou en évolution d’un matériau. Quelle relation entre pérennité et transformation d’une œuvre ?
Dans le contexte de la réouverture de l’école sur le site de Lesdiguières, on s’interrogera sur les lieux dont les ateliers se fournissent en matériaux, et sur les conditions de création d’une récupérathèque. On continuera un travail de cartographie des ressources à l’échelle de la métropole de Grenoble et de son territoire environnant.
Par cette attention, il ne s’agit pas de limiter la créativité, mais au contraire de repartir d’une réflexion systémique sur les matières, leurs contextes d’origine et d’extraction pour déployer les imaginaires.
Bois, métaux, minéraux, matériaux de synthèse, chimiques, numériques, électroniques…nous ferons un tour d’horizon afin que chacun/chacun se saisisse de matières choisies, et réalise son projet personnel.
À partir de cette relation tissée à un ou plusieurs matériaux, il s’agira pour chaque étudiant·e. de penser un projet personnel dont le sujet sera la représentation de la métropole de Grenoble et de la région du Trièves dans un futur proche et lointain : 2050.
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre
Repères bibliographiques / références :
Future Materials Banks, Jan Van Eyck Académie, https://www.janvaneyck.nl/postacademy/future-materialshttps://www.futurematerialsbank.com/
Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental, ouvrage collectif sous la direction de Elio Della Noce et Lucas Murari, 2022
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Œuvres et travail de : Marjetica Potrc, Richard Long, Superflex, Joseph Beuys, Matthew Barney, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Giuseppe Penonne, Pierre Huyghe.
Atelier Pratique - Module curatorial (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Atelier pratique. Rendez-vous en groupe, conception, organisation et suivi des projets pris en charge par l’AP.
Objectifs du cours :
Ce module, ouvert à une quinzaine d’étudiant·es par semestre, propose une approche à l’échelle un de la pratique de l’exposition. De manière à apprendre à concevoir et mettre sur pied un projet d’exposition.
Cette année, il sera proposé aux étudiant·es de prendre part à deux projets, un pendant le semestre et l’autre au printemps, en lien avec des partenaires :
-l’événement Petites formes performatives, avec deux performances de Candice Burnet et Amar Ruiz, à l’automne, au Centre d’art Bastille
-l’exposition photographique dédiée aux représentation de l’habiter et de l’environnement pendant et après les confinements de 2020 dus à la pandémie de Cvid-19, en mars, à la galerie de l’école ou à la galerie Xavier Jouvin et dans les bibliothèques du campus ; avec le Master Pro Histoire de l’art de l’UGA
Ces projets permettront de mieux comprendre les enjeux conceptuels à l’origine d’un projet d’exposition, tout comme les enjeux logistiques, le transport d’œuvres, l’accrochage, la maintenance, la surveillance d’exposition, etc.
D’autres projets, amenés par les étudiant·es comme d’autres partenaires pourront être développés dans ce cadre.
Contenu du cours :
Le module curatorial repose sur l’expérience pratique, les étudiant·es seront en charge des projets réalisés où la prise de décision, le dialogue avec les personnels administratifs et techniques de l’école et les partenaires extérieurs de l’école seront au cœur de l’expérience collective. Cela permettra de comprendre les différentes étapes et enjeux d’un projet de monstration. Le but est de permettre aux étudiant·es d’acquérir les outils conceptuels et pratiques permettant à terme de construire des projets en toute autonomie et de commencer à construire un réseau artistique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, évaluation sur la présence, la participation aux temps collectifs et sur l’implication dans les projets.
Repères bibliographiques / références :
Atelier Pratique - Moulage (J.S.P.)
Méthode d’enseignement :
Atelier
Objectifs du cours :
Découvrir et se familiariser avec certaines techniques du moulage.
Contenu du cours :
Expérimenter le moulage d’objets simples, de partie du corps avec divers matériaux (en fonction des commandes et stocks disponibles) : Plâtre, argile, béton, alginate, silicone, résine, latex, etc.
Calendrier :
1- Jeudi 9 octobre 14-18
2- Jeudi 6 novembre 14-18
3- Jeudi 20 novembre 14-18
4- Jeudi 4 décembre 14-18
5- Jeudi 18 décembre 14-18
6- Jeudi 15 janvier 2026 14-18
7- Jeudi 29 janvier 2026 14-18
Modalités et critères de l’évaluation :
Présences régulière des étudiant·es.
Concevoir un projet final issu des différentes expériences du moulage.
Repères bibliographiques / références :
Une partie du matériel sera fourni par l’école. Pour des projets plus spécifiques, l’étudiant·e se fournira par ses propres moyens.
Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Cours théoriques à l’ÉSAD et ateliers à l’extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.
Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l’acte photographique. Nous essaierons d’interroger la photographie dans son essentialité, c’est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.
Objectifs du cours :
« Je ne fais pas la photo d’un paysage, je fais une photo d’un paysage. » Eric Hurtado
Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d’une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l’invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfuie, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.
Trouver un chemin dans les herbes, c’est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d’une éclaircie de notre existence au monde.
Contenu du cours :
Comment la photographie nous permet le passage de l’acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d’une vision.
L’enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre « prendre une photo » et « accueillir une image », dépasser le sujet pour sa question.
Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues (argentique ou numérique), à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimenterons lors d’ateliers pratiques, à l’ESAD comme lors de sorties en extérieur.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Livres
Raymond Depardon, Errance. Points / Seuil
Luc Delahaye, L’autre,Phaidon
Winterreise, Phaïdon
Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl
Lewis Baltz, Texts, Steidl
Garry Winogrand, Catalogue Jeu de Paume, Flammarion
Henri Cartier-Bresson, L’instant décisif, in L’imaginaire d’après nature, Fata Morgana
Voir est un tout, Centre Pompidou
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Rodtchenko photographe, Parenthèses
Bernard Plossu, Revue Lisières, 21
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Le point aveugle, Musée Hébert
Films
Raymond Depardon, Journal de France
Michelangelo Antonioni, Blow-up
Wim Wenders, Palermo shooting
Le sel de la terre
Sasha Waters Freyer, Garry Winogrand
Laurent Roth, Les yeux brûlés
Manoel de Oliveira, L’étrange affaire Angélica
Jean-Luc Godard, Je vous salue Saravejo
Film socialisme
Gilad Baram, Koudelka shooting holy land
Atelier Pratique - Si je ne peux pas danser... (K.S. & S.F.)
Méthode d’enseignement :
- Résidence de recherche de 6 jours à Centrale Fies – Centre de Recherche sur les Pratiques Performatives Contemporaines et workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (Octobre 2025)
- Organisation et suivi curatorial de la résidence de recherche de l’artiste Ru Kim (Novembre 2025) à Grenoble et participation en tant que performeur.euses à son projet pour le Festival des Gestes de la Recherche (Décembre 2025)
- Rendez-vous hebdomadaires.
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Contenu du cours :
L’atelier pratique « …si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution » est lié à l’unité de recherche “Hospitalité artistique et activisme visuel” (Simone Frangi et Katia Schneller) et à la mention “Holobionte. Pratiques visuelles, exposition, et nouvelles écologies de l’art”. Il est également mené en collaboration avec Melis Tezkan et son ARC lié à la seconde année du programme de recherche “What’s love got to do with it ?” soutenu par le Ministère de la Culture.
Intitulé d’après une affirmation historiquement attribuée à la militante anarchiste Emma Goldman, qui qualifiait la danse ainsi que la joie et le plaisir d’outils révolutionnaires dignes et efficaces, l’AP envisage la performance multimédia et la musique (au sens de production sonore élargie) comme des plateformes militantes puissantes. La collaboration entre S. Frangi, K. Schneller et M. Tezkan construit un parcours pédagogique structuré et centré sur les pratiques critiques joyeuses, exubérantes et non moralistes qui croisent l’expérience performative avec des questions militantes dans l’espace de lutte de la dissidence de genre, de l’anti-colonialisme, de l’anti-capitalisme et de l’écologie.
L’ARC de Melis Tezkan – développé en collaboration avec cet AP – donnera lieu également au cours du premier semestre à des workshops avec différent.es invité.es qui travaillent dans ce sens en lien avec le programme de recherche “What’s love got to do with it ?”. Les participant.es à l’AP qui auront assisté à la résidence à Centrale Fies prendront en charge quelques séances de restitution et de transmission des expériences menées en Italie.
Résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies (https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture de ce parcours du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025. L’idée de ce voyage est de faire une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel italien pour suivre un workshop. Situé dans une ancienne centrale hydroélectrique près de la ville de Trento dans le nord de l’Italie (https://www.centralefies.it/building/), Centrale Fies organise un festival de performance depuis plus de 45 ans, et récemment devenue partenaire institutionnel d’écoles supérieures européennes centrées autour de la performance comme le Dutch Art Institute d’Amsterdam/Arnhem et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence sera tout d’abord l’occasion de se former aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) en travaillant avec le technicien de Centrale Fies.
Un workshop y sera organisé avec l’artiste invité Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), artiste basé.e à Amsterdam, aux Pays-Bas, dont la pratique queer croise la performance et la musique. Le travail du Publik Universal Frxnd porte sur l’interaction entre les formes visuelles de représentation/abstraction et les formes politiques de reconnaissance et de marginalisation. En mettant l’accent sur les pratiques folkloriques et les histoires locales, son travail le plus récent explore les sentiments de deuil et de perte à travers une perspective critique de l’héritage nécropolitique du colonialisme sur les travailleur.euses. Son travail s’intéresse à la manière dont l’industrialisation a permis à notre interaction avec les machines de façonner nos vies et nos expressions culturelles. Le Frxnd fait référence à un personnage historique. Un.e hérétique, un charlatan.e, une contradiction dans les termes, le Frxnd est l’énonciation d’un pouvoir ou d’un esprit supérieur et n’a pas de sexe malgré la forme de son vaisseau terrestre. Iel est et a peut-être toujours été un instrument permettant d’aller au-delà de l’imagination et de la perspective limitées de la position spécifique d’un sujet. Le Publik Universal Frxnd est un mouvement dans le temps vers une défaite du moi. Vous trouverez des informations sur sa pratique sur son site.
Participer à la performance de Ru Kim : Au cours du mois de novembre, l’artiste coréen·ne Ru Kim fera une résidence de recherche à l’ESAD. Iel donnera un workshop (13-14/11 et 20-21/11) dans le but d’élaborer une performance avec les participant.es de l’AP qui sera présentée lors du Festival des Gestes de la Recherche (2-4 décembre 2025).
Dans sa pratique, Ru Kim associe la performance et le texte à des installations vidéo et sonores. Ses projets questionnent la résistance et la réappropriation des perpétuations de la violence générées par les idéologies patriarcales, impériales et coloniales de la domination. Ils cherchent à développer des formes qui remettent en question les binaires et les identités figées.
S’appuyant sur sa propre fluidité linguistique, culturelle et identitaire, Ru Kim se nourrit des théories féministes hydro-, noires et queer pour mener des analyses déconstructivistes des représentations oppressives, racistes et coloniales. Ses projets récents se concentrent particulièrement sur les histoires racontées depuis le point de vue du témoin plus qu’humain, les stratégies de l’eau abordées dans une perspective hydroféministe, la documentation de la queerness dans l’histoire coréenne, et les archives révélant la construction « asiatique » promulguée par le regard occidental.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet et rendu d’un document écrit.
Repères bibliographiques / références :
Travaux d'initiative personnelle (suivi d'année)
Atelier vidéographie (Y.F.)
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
L'art contemporain par ses lieux et celleux qui les font (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Rencontres et échanges avec des acteurices du champ de l’art contemporain, local et plus lointain.
Visites de structures de diffusion de l’agglomération, rencontres avec leurs directeur·ices et équipes.
Entretiens par groupes avec des artistes et commissaires d’exposition.
Travail de recherche en groupe afin de remettre en perspective historique les personnes et pratiques rencontrées.
Bilan par groupes à l’école.
Objectifs du cours :
Elargir et préciser ses connaissances du champ de l’art contemporain et de son actualité par sa partie émergée – expositions, événements publics – autant que par sa partie non visible – production, processus, activité en train de se faire.
Rencontrer diverses manières de penser, de faire et de montrer pour pouvoir affiner ses envies et fabriquer son propre positionnement.
Mener des recherches spécifiques afin de remettre en perspective historique, contextualiser, comprendre, critiquer et pouvoir se situer par rapport à ces cas d’étude (personnes, pratiques, structures).
Comprendre quelle(s) place(s) on peut occuper au sein des réseaux artistiques.
Contenu du cours :
Le cours se déroulera hors de l’école, sur les lieux et en présence de leurs acteur·ices. Chaque séance apportera des points de vue, des parcours, des manières de faire art, de l’étudier et/ou de le diffuser et de s’inscrire dans le champ de l’art contemporain. L’échange sera basé sur la préparation en amont, la participation active de chacun·e, l’ouverture et le dialogue. Les rencontres en classe entière seront accompagnées d’un travail sur la forme de l’entretien, en petit groupe. Chaque groupe devra mener ses recherches à la bibliothèque, en ligne ou sur le terrain de manière autonome et coordonnée.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité et participation ;
Rendu ad hoc en fin de semestre : compte-rendu par groupe de l’échange avec l’artiste, remise en contexte et en perspective historique, cohérence fond-forme de la présentation.
Repères bibliographiques / références :
– https://www.archivesdelacritiquedart.org/
– http://yaci-international.com/fr/collectives/jeunes-critiques-dart/
Des éléments biblio-sitographiques complémentaires seront apportées à chaque séance.
Histoire de l'art : Art, paysage, écologies (C.B.)
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B..V.)
Méthode d’enseignement :
Groupes de niveau :
A2-B1 : impliquant un renfort grammatical et lexical
B2-C1 : visant à une pratique avancée.
Objectifs du cours :
Acquisition de culture artistique anglophone.
Savoir s’exprimer sur ses productions artistiques et celles des autres.
Asseoir les compétences à l’écrit et à l’oral.
Contenu du cours :
Le (Self)-Portrait à travers l’étude de différents artistes et médiums
Parcours en anglais avec une médiatrice bilingue, Musée de Grenoble
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, assiduité et participation requises.
Production plastique possible, compétences écrites et orales de fin de semestre.
Tenir à jour le carnet de notes/ recherches en vue d’une présentation orale.
Repères bibliographiques / références :
Outils en ligne, support papier :
- sites internet, réseaux sociaux : musées, galeries, artistes, textes…
- Portrait, a poem by Louise Glück, 2020 Nobel Prize in Literature
- The Art History of the Selfie, PBS Digital Studios, 2016 (YouTube)
- How Artists Explore Identity, MoMA, 2015 (YouTube)
- The Picture of Dorian Gray (1945 & 2009 trailers)
- The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde, published in 1890
- Site internet : soundportraits.info
- Artistes présentés lors du Parcours en anglais avec une médiatrice bilingue, Musée de Grenoble.
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
UE3 Recherches et expérimentations
Recherches et expérimentations
à venir
UE4 Bilan
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
à venir
Grille d'évaluations Art 2 - Semestre 4 :
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Workshop mixte - Fête du cri (K.S & S.F.)
Contenu du programme
Utilisation « intelligente » des outils numériques tels que Chat GPT, Google, Deepl
Présentation croisée des étudiant·e·s à travers leur travail
Établir une liste de mots-clés
Révision du vocabulaire à travers des séances de brainstorming
Écriture d’un court texte sur le travail d’un·e pair à partir de mots-clés attribués
Échange et analyse de textes (bons et mauvais exemples de lettres et CV)
Constitution d’un lexique personnel lié à la présentation de soi et de ses projets
Élaboration et révision de son personal statement à l’aide d’outils numériques (ex. : ChatGPT)
Analyse collective d’un bon et mauvais exemple d’écrit
Comparaison des CV français et anglophones à partir de documents-types
Recherches documentaires
Étude de projets de mobilité réalisés les années précédentes
Préparation des portfolios numériques
Travail individuel sur les CV et les lettres de motivation, accompagné de retours personnalisés
Modalités et critères de l’évaluation :
Assiduité – Présence
Participation – Progrès
Rendus en fin de semestre –
C.V.
Artist’s Statement
Portfolio
Repères bibliographiques / références
International Mobility Applications – Années précedentes
Workshop mixte - Abstraction figurative (B.J.)
Workshop mixte - - Sculpter l'espace (M.T.)
Workshop mixte - Bricomusique (F.N.)
Workshop mixte - Oscinato (C.T.)
Workshop mixte - La forme du monde : montagne vivante, montagne morte (C.B.)
Workshop mixte - Image aux confins (E.H.)
Workshop mixte - Simulation effect (B.J.)
Workshop mixte - Terminus (S.R.)
Workshop - Elles (C.B.)
Workshop au CAIRN à Dignes (C.B.)
Workshop numérique (B.J.)
Workshop 1+1=1 (A.O.)
Workshop Mini (S.R.)
Atelier volume Miroir, mon beau miroir (J.S.P.)
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
L'art contemporain par ses lieux et celleux qui les font (P.R.)
Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : L'invention de l'Europe (S.F.)
Ce que l'on appelle performance : récits (C.B.)
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B.V.)
Méthode d’enseignement :
Groupes de niveau :
A2-B1 : impliquant un renfort grammatical et lexical
B2-C1 : visant à une pratique avancée.
Objectifs du cours :
Acquisition de culture artistique anglophone ;
Savoir s’exprimer sur ses productions artistiques ;
Asseoir les compétences à l’écrit et à l’oral.
Contenu du cours :
« Galeries d’essai/Test Tubes » en anglais
Accrocher et présenter son travail en cours ou abouti, en discussion avec le demi-groupe d’étudiant·es et l’enseignante, et possiblement un.e invité.e professionnel·le anglophone.
Production écrite de son « statement » (démarche artistique) avec insertion dans document de synthèse de fin d’année.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, assiduité et participation requises
Repères bibliographiques / références :
outils en ligne, support papier :
- sites internet, réseaux sociaux : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
UE3 Recherches et expérimentations
Recherches et expérimentations
à venir
Document de synthèse (P.R.)
UE4 Bilan
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
à venir
ANNÉE 3 - Option Art
L’organisation du semestre 5 doit favoriser la poursuite d’une pratique et d’une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d’expositions.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour des Mobiles Parlés et des Rendez-vous individuels, doivent être pris avec les professeurs pour suivre l’avancement des travaux.
L’étudiant de l’année 3 doit obligatoirement faire, ou avoir fait un stage d’au moins deux semaines, auprès d’un artiste ou d’un établissement culturel : attention, il doit être approuvé par le.a coordinateur.ice d’année. Un rapport doit être rédigé et rendu avant le mois de juin (fin du semestre 6). Ce stage sera validé par l’obtention de crédits.
Le séjour à l’étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l’année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d’information. Elle se structure en deux temps :
– écriture d’un projet qui oblige l’étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio, en langue étrangère, accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l’examen du semestre ;
– soutenance de ce projet devant une commission de mobilité, composée du directeur, des coordinateur.ice.s d’année et du responsable des mobilités internationales, qui évalue l’intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.
Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé, et s’y inscrire en début de semestre.
L’organisation du semestre 6 de la phase programme doit favoriser la poursuite d’une pratique et d’une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.
Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d’expositions.
Liste des unités d'enseignements
Semestres 5
UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 12 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS
UE3 : Recherches personnelles plastiques – 6 ECTS
UE4 : Bilan – 4 ECTS
Semestres 6
UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 4 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 5 ECTS
UE3 : Recherches personnelles plastiques – 4 ECTS
UE4 : Diplôme (DNA) – 15 ECTS
UE5 : Stage – 2 ECTS
Grille d'évaluations Art 3 - Semestre 5 :
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Atelier de Recherche et Création - Documenter le Monde (F.N.)
Atelier de Recherche et Création - Playlist Remix (M.T.)
Méthode d’enseignement :
Recherches individuelles et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, séances d’écoutes, séances de lectures, production d’objets rendant compte de la recherche, exercices de courte et de longue durée, présentation publique.
Avec également :
Une résidence de recherche de 6 jours avec 6 étudiant·es de l’ARC à Centrale Fies – Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, avec un workshop animé par l’artiste Publik Universal Frxnd (octobre 2025)
Un workshop de transmission à l’ARC par les étudiant·es ayant participé à la résidence
Un workshop de drag imaginé avec les étudiant·es Emmanuel·le Garin et Faustine Stricanne
Un·e ou deux invité·es pour un ou deux workshops
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Démystifier la performance
Produire ou interpréter des formes, gestes, textes, chansons, etc.
Travailler des formats de collaboration et/ou en collectif
Contenu du cours :
En partant de la place que la musique occupe dans nos mémoires et de la manière dont elle structure nos souvenirs, l’ARC Playlist Remix 2 s’inscrit dans le cadre du programme de recherche What’s love got to do with it?, qui explore comment nos émotions nous informent sur le monde et comment, en tant qu’artistes, nous pouvons apprendre de la façon dont ces émotions génèrent des récits. Avec les intervenant·es invité·es, nous nous pencherons également sur les pratiques musicales ou performatives, ainsi que sur les notions de spectacle et de fête.
*Sur la résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies(https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture du parcours Performance, du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025.
L’objectif est de vivre une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel situé dans une ancienne centrale hydroélectrique, près de Trente, en Italie (https://www.centralefies.it/building/). Ce lieu accueille un festival de performance depuis plus de 45 ans et collabore avec des écoles telles que le Dutch Art Institute (Amsterdam/Arnhem) et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence permettra notamment :
- Une formation aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) avec un technicien de Centrale Fies
- Un workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), basé·e à Amsterdam, dont la pratique queer articule performance et musique
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, régularité de la participation, qualité des recherches et soin dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dynamique collective de l’atelier.
L’évaluation portera également sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Atelier de Recherche et Création - Confluence (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique sur sites.
Exposition dans la galerie de l’école.
Objectifs du cours :
Eau qui médite, enclos du temps.
Paupière close. Un silence qui écoute.
Eric Hurtado
Questionner par la photographie et la vidéo le territoire d’une rivière, son bassin, son déploiement, sa confluence avec l’activité humaine. Nous questionnerons également notre conscience de celle-ci, confluence elle-même de l’existence de la rivière avec notre regard. La question du réel, toujours, rivière qui coule et semble fixe.
« L’image est au confluent de la lumière venue de l’objet et de celle qui vient du regard. » PLATON
Contenu de cours :
L’Arc débutera par la projection de Stalker, d’Andreï Tarkovski, film questionnant la réalité d’un territoire et la conscience des inventeurs de celui-ci (au sens réunissant découverte et invention, justement arcane fondamental de la quête photographique.)
Suivront deux journées de rencontre et d’atelier photographique avec le photographe Jean- Marc Blache, qui a photographié l’eau sous toutes ses formes, de la glace à l’exploration sous-marine dans de nombreux pays. Il nous accompagnera lors d’une séance de prises de vues sur le territoire du Drac, au sud de Pont-de-Claix et pour la restitution des travaux.
Chaque quinzaine, en semaine B, une des deux journées de travail de l’Arc sera consacrée à une sortie de prises de vues en extérieur sur le thème de l’eau.
Un voyage pédagogique est également prévu dans le Vercors à la grotte de Choranche.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à l’issue de l’Arc dans la galerie de l’École.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Films :
Andreï Tarkovski, Stalker
Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu
Michelangelo Antonioni, Gente del Po
Désert Rouge
Jean-Luc Godard, Opération Béton
Jean Giono, L’eau vive
Livres :
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Raymond Depardon, Errance. Points/Seuil
Roland Recht, La lettre de Humboldt, Christian Bourgois
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Atelier de Recherche et Création - Sphère (B.J.)
Méthode d’enseignement :
La sphère est un concept formel. Cet ARC est donc une proposition pour investir une forme dont la dynamique globale, sur le artistique, est abstraite. Mais l’idée de sphère est susceptible de s’imprégner d’éléments variés, comme celui de l’écologie par exemple (la terre est un écosystème sphérique), ou par des investigations fictionnelles (Sphère est le titre d’un film de science-fiction).
L’idée de sphère peut être investie de façon diverses : sur des supports digitaux (film, 3D), ou matériel (peinture, installation, photographie, performance). L’IA peut également être utilisée.
Objectifs du cours :
Cet ARC vous invite à plonger dans l’univers de la sphère, une forme universelle qui traverse l’art, la science, la philosophie et la nature. Symbole d’harmonie, de perfection et d’unité, la sphère est aussi une métaphore puissante pour réfléchir à la fragilité de notre planète Terre, un écosystème menacé par les activités humaines. À travers cet ARC, vous explorerez les dimensions formelles, symboliques et écologiques de la sphère à travers une œuvre ou plusieurs dans le médium de votre choix : dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, performance, multimédia, vidéo, 3D. Cet exercice est une occasion de conjuguer réflexion conceptuelle et engagement environnemental.
Contenu du cours :
Objectifs pédagogiques
- Explorer les caractéristiques formelles et esthétiques de la sphère.
- Intégrer une réflexion écologique en lien avec la Terre, sphère fragile et écosystème précieux.
Thèmes d’exploration autour de la sphère
La sphère, par sa simplicité et sa perfection, offre une multitude de pistes à explorer dont voici quelques exemples : :
- Forme et esthétique : géométriquement, la sphère est la forme la plus équilibrée, où chaque point de sa surface est équidistant de son centre. Dans l’histoire de l’art, elle inspire des œuvres architecturales (comme les dômes de Brunelleschi) ou sculpturales (les sphères polies d’Anish Kapoor). Comment pouvez-vous jouer avec la tridimensionnalité, les reflets, les ombres ou les illusions optiques pour réinterpréter la sphère ? Considérez les jeux de lumière, de texture ou de transparence dans votre travail.
- Symbolisme et philosophie : La sphère a longtemps incarné l’idée de perfection et d’infini. Pour les anciens Grecs, elle représentait le cosmos, une harmonie universelle. Dans l’art contemporain, elle peut évoquer l’unité, l’isolement ou la cyclicité du temps. Pensez aux installations immersives de Yayoi Kusama, où les sphères répétées créent un sentiment d’infini.
- Écologie et fragilité planétaire : La Terre est un écosystème complexe et vulnérable, confronté à des défis comme le changement climatique, la déforestation et la pollution. En tant qu’artistes, vous pouvez utiliser la sphère comme une métaphore pour alerter sur ces enjeux. Pensez à des matériaux de récupération ou à des installations qui évoquent la fragilité de notre environnement.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Format : Œuvre physique ou numérique.
- Recherche préparatoire : Au début de l’ARC, un moment d’échange qui s’appuiera sur une présentation visuelle d’images vous proposera des pistes de travail à travers la présentation d’un certain nombre d’exemples. Le domaine de l’art est privilégié mais il sera aussi question d’architecture, selon un choix lié à la forme sphérique. Lors de cette phase préparatoire, vous ressemblerez des références visuelles, textuelles ou conceptuelles dans un carnet de recherche pour trouver votre ou vos idées. Nous discuterons ensemble de ces projets et vous passerez ensuite à la réalisation.
- Production : vous aurez tout le premier semestre pour mettre au point votre réalisation. Vous produirez une œuvre dans le médium de votre choix. Il sera possible d’effectuer plusieurs travaux ou un seul s’il est suffisamment complexe pour justifier cette durée dans le temps.
- Dimension écologique : Intégrez une réflexion sur l’environnement, que ce soit par le choix de matériaux durables, un message visuel sur la crise climatique ou une œuvre qui incite à repenser notre relation à la Terre.
- Rythme des échanges : Je serai présent les lundi et mardi selon l’emploi du temps auquel vous devrez vous référer pour être présents à chaque fois. Les rencontres se feront de préférence de façon collective mais auront lieu également à travers des entretiens individuels.
- Présentation / évaluation : Fin janvier, vos œuvres seront accrochées lors du bilan à travers un accrochage collectif dans notre salle allouée à l’ARC et donneront lieu à un échange de points de vues et d’analyses.
METHODOLOGIE :
- Dessin/peinture : vous expérimenterez la forme de la sphère selon vos aspirations formelles. Les supports meuvent varier, pensez à expérimenter d’autres surfaces que le papier ou la toile.
- Sculpture/installation : vous utiliserez des matériaux disponibles à l’atelier de l’école ou des matériaux de recyclage que vous aurez glané (plastique, métal, bois) ou éphémères (terre, papier) pour construire une sphère ou une composition sphérique. Vous pourrez intégrer des projections, des sons ou des animations pour créer une expérience immersive autour du thème. Dans ce sens, pensez également à solliciter le matériel disponible dans le domaine de la lumière dont dispose l’école.
- Photographie/vidéo : jouez sur des paramètres de cadre, de lumière, pour construire des images dont la structure principale est sphérique. Le montage de films pourra se faire sur Final cut Pro ou Da Vinci Resolve.
- Performance : Les scénarios sont ouverts : mouvements circulaires, répétition, etc. (voir Abramovic et Ulay).
Repères bibliographiques / références art et architecture :
ART :
- Anish Kapoor : Ses sculptures sphériques, comme Cloud Gate, jouent avec les reflets et la monumentalité pour transformer l’espace et la perception. Sa série Sky Mirror présente également des surfaces paraboliques et circulaires.
- Tara Donovan : Une artiste américaine qui utilise des matériaux du quotidien (gobelets, pailles…) pour créer des installations organiques évoquant des formes sphériques ou cellulaires.
- Michelangelo Pistoletto : sa performance Newspaper Sphere interroge l’accumulation et la boulimie d’information à travers un processus d’accumulation performative.
- Marina Abramovic / Ulay : Relation dans le mouvement – une performance historique entre le mythe de Sisyphe (Camus) et celui de l’Eternel Retour (Nietzsche).
- Yayoi Kusama : connue pour ses motifs à pois omniprésents, elle utilise la forme ronde dans ses peintures, sculptures et installations immersives, créant des expériences infinies et psychédéliques.
- Olafur Eliasson : artiste danois-islandais qui explore souvent les formes géométriques, y compris la sphère, dans des installations qui jouent avec la lumière, la perception et les phénomènes naturels. Son œuvre The Weather Project avec son immense soleil artificiel sphérique en est un exemple marquant.
- Richard Long : associé au Land Art, il utilise souvent des formes géométriques simples trouvées dans la nature, comme des cercles de pierres.
- Michel Verjux : Un artiste visuo-spatial contemporain, poète et théoricien de l’art, mentionné ici pour ses sculptures de lumière utilisant des projections minimalistes rondes pour des expériences physiques utilisant l’espace et l’architecture comme support.
- Les artistes de l’Op Art (comme Victor Vasarely) : Bien qu’ils aient exploré diverses formes géométriques, le cercle et les formes rondes étaient essentiels pour créer des illusions d’optique de mouvement et de profondeur.
- Xavier Veilhan : artiste français aux registres étendus mentionné ici essentiellement pour ses mobiles inspirés de Calder, entre équilibre et déséquilibre, dont la finalité se situe peut-être dans un processus de déstabilisation de la sculpture.
- Karina Smigla Bobinsky, artiste germano-polonaise, mentionnée ici pour son installation interactive de 2018 présentant une sphère dans une pièce vide manipulable par les visiteurs.
ARCHITECTURE :
- Antti Lovag : l’architecte des maisons bulles, précurseur de la blob architecture et de l’architecture organique.
- Cabinet d’architecture Populous Severud Associates : La sphère de Las Vegas et son ingénierie de science-fiction.
- La Blob architecture : un terme donné à un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.
Artistes dans l’Histoire :
- Sandro Botticelli : Dans sa peinture La Madone du Magnificat, la forme circulaire (du tondo, support rond) encadre la Vierge et les anges, une forme courante à la Renaissance pour les sujets religieux.
- Jérôme Bosh : La création du monde.
- Ingres : Le bain turc, autre référence célèbre de peinture peint sur un tondeauen tant que peinture ronde, en écho aux rondeurs des corps.
- Fernand Léger : Au début du 20e siècle, il a intégré des formes cylindriques et circulaires dans son travail, décomposant les objets en éléments géométriques. Son tableau Les Disques dans la ville en est un exemple.
- Robert Delaunay et Sonia Delaunay : Pionniers de l’Orphisme, un dérivé du cubisme, ils ont utilisé des disques de couleurs et des formes circulaires pour explorer la lumière et le mouvement.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres artistes seront présentés comme sources d’investigation et d’inspiration lors du commencement du workshop à la rentrée.
Annexe : La Sphère comme exploration artistique : une lecture à travers Peter Sloterdijk
Dans sa trilogie Sphères, le philosophe Peter Sloterdijk propose une réflexion profonde sur cette forme, non seulement comme objet géométrique, mais comme métaphore de l’existence humaine, de l’espace et des relations. Ses idées offrent un cadre conceptuel riche pour explorer la sphère en tant que motif, symbole et espace de création.
Sloterdijk décrit la sphère comme une structure fondamentale de l’être-ensemble : L’homme est l’animal qui vit dans des sphères qu’il produit lui-même (Bulles, 1998). Cette idée invite les artistes à envisager la sphère non pas comme un simple volume, mais comme un espace de vie, un contenant intime où se tissent des relations. Dans ce sens, vous pourrez explorer des installations sphériques, jouant avec des matériaux transparents ou opaques pour exprimer cette tension entre intériorité et extériorité.
Les sphères sont des globalisations réussies, des mondes en miniature (Globes, 1999). Cette citation peut inspirer des œuvres qui questionnent l’idée de globalité : une sphère peut-elle contenir le monde ? Les étudiants peuvent créer des microcosmes sphériques, intégrant des fragments d’images, de sons ou d’objets, pour réfléchir à l’ambition de l’art de représenter l’universel à travers une forme finie.
Enfin, dans Écumes, Sloterdijk introduit la notion de sphères multiples et interconnectées : Nous vivons dans des écumes, des agrégats de sphères qui se touchent sans se fondre (Écumes, 2004). Cette image d’écumes, où chaque sphère est à la fois autonome et liée aux autres, pourrait guider des projets collectifs. Cette idée peut également s’envisager sous une forme plastique en deux dimensions, peinture, dessin…
En somme, la sphère, chez Sloterdijk, est bien plus qu’une forme : elle est un espace philosophique, poétique et relationnel. En s’appuyant sur ces concepts, vous pourrez explorer des médiums variés (sculpture, performance, installations immersives) pour interroger la sphère comme lieu de protection, de rêve ou de tension.
Atelier de Recherche et Création - Art and the city (S.S.)
Atelier de Recherche et Création - Le Banquet (P.R. & C.B. & A.O.)
Méthode d’enseignement :
Proposer des situations autour du repas lors desquelles les étudiant·es sont invité·es à répondre systématiquement. Mise en place d’exercices réguliers et création de protocoles autour de la cuisine. Les temps de cuisson, le dressage de la table, l’assaisonnement d’un plat seront des moments pédagogiques parmi d’autres.
Objectifs du cours :
Tous les mardis, développer collectivement des temps de recherche, de discussion et de création dans le cadre d’un repas. Faire la cuisine, manger ensemble, la digestion comme expérience simultanée, la vaisselle et le rangement seront les principaux objectifs de l’ARC. Mettre en œuvre le Symposium de fin de semestre en tant que forme artistique collective.
Contenu du cours :
Tous les mardis s’organiseront autour des repas de midi, depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Les déjeuners du mardi midi feront partie de l’ARC, chacun·e ramènera des ingrédients. Nous élaborerons des repas thématiques en questionnant l’économie d’un repas, les manières de faire, l’hospitalité. Nous pratiquerons l’art de la conversation, réfléchirons au vocabulaire de la cuisine dans sa polysémie, nous pratiquerons le “toast” comme forme poétique etc. Quelle différence entre faire la cuisine dans un restaurant, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine dans une école d’art? Quelle différence entre manger au restaurant, manger chez soi, manger dans une école d’art?
Chaque séance permettra de proposer des formes et préparera la séance suivante.
L’ARC sera aussi le laboratoire de préparation du Symposium qui se tiendra dans la Grande Galerie de l’ESAD le 13 janvier. Nous adresserons des invitations à des personnes choisies, élaborerons un menu et un programme de formes, de gestes et de prises de parole.
Modalités et critères de l’évaluation :
Participation à l’ensemble des temps de l’ARC sans exception et à l’organisation du Symposium du 13 janvier.
Repères bibliographiques / références :
-Karen Blixen, Le dîner de Babette, 1961 (1ere ed. danois 1958).
-Ludovic Burel, Le laboratoire de fermentation, it: éditions, 2025.
-Sally De Kunst et al., This Book is yours. Recipes for artistic collaboration/Recettes pour la collaboration artistique, Art&Fiction publications – Vexer Verlag, 2019.
-Thien Uyen Do, Fermentation rébellion, édition des Equateurs, 2024.
-Marguerite Duras, La cuisine de Marguerite, B. Jacob, 1999.
-Claire Gausse, Louise Drulhe, Cantines de quartier : la recette du lien, éditions 369, coll. Manuels, 2018.
-Emmanuel Guillemain d’Echon, Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis. Routes, recettes et tours de main, Keribus Éditions, 2024.
-Dorothy Ianonne, A CookBook, (edition anglaise), Presses du Réel, 2019.
– Lauren Malka, Mangeuses : histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, ed. les Pérégrines, 2023.
-Gaëlle Ronsin, Ajouter un couvert pour l’anthropologue, Les éditions de l’épure, 2024.
– Niki Segnit, Le répertoire des saveurs, Marabout, 2012.
-Yoann Thommerel, Manger low cost, édition Nous, coll. Disparate, 2025.
-Alice B. Toklas, Le livre de cuisine d’Alice Toklas, (Traduction de : The Alice B. Toklas cook book), les Éd. de Minuit, 1999.
-Gabriel Axel, Le festin de Babette, 1987 (film).
-Luc Moullet, Genèse d’un repas, 1978 (film).
Atelier de Recherche et Création - Bifurcations et chants photosynthèses (E.D.F.)
Intitulé du cours : ARC : Bifurcations et chants-photosynthèses
À la suite de l’Arc « Ré-ouvrir les futurs » et « Terre-strates-récits », troisième chapitre d’un cycle d’enseignement intitulé “DES CHEMINS HYBRIDES”, Imaginer en 2050 êtres et territoires, entre Trièves et Grenoble.
Intervenant.e.s : Stéphanie Sagot et Pascal Aspe (Ferme des MillePousses). Lisa Panico et Thomas Klein, chargé.e.s de la réouverture au public du Centre horticole de Grenoble.
Méthode d’enseignement :
Dans une approche transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation dans le Trièves et le Massif du Vercors avec un travail dans les ateliers de l’ÉSAD. Nous bénéficierons d’expériences d’apprentissage et de chantier participatif avec le nouveau projet d’agriculture urbaine de Mille Pousses Grenoble, dirigé par Pascal Aspe. Nous nous rendrons dans le Trièves pour apprendre de la ferme collective Sainte-Luce et puis dans le Vercors pour un arpentage-lecture de paysage et botanique.
Nous continuerons nos échanges et séances d’apprentissage avec le Centre Horticole de la ville de Grenoble, avec lequel est un partenariat est noué.
Un atelier est également prévu avec Stéphanie Sagot, artiste qui explore depuis vingt ans les liens entre environnement, agriculture et alimentation. Chaque étudiant.e travaillera à partir d’un projet personnel. Nous rencontrerons au début de l’anéée l’artiste baniwa et brésilien Denilson Baniwa, qui nous présentera certains de ses travaux en lien avec le végétal.
Durant le semestre, des journées de réflexion et d’échanges seront également co-organisées avec les ARC et les IR de la mention Territoire et Société. Ainsi une rencontre et un temps d’échange est prévue avec l’ARC de Slimane Raïs intitulé « L’Air de rien… ».
Objectifs / contenu du cours :
En menant des recherches sur les spécificités historiques, environnementales et sociales du territoire entre le Trièves et la métropole Grenobloise articulant espaces urbains, ruraux et montagneux, il s’agira d’imaginer à travers objets et fictions futuristes, les liens pouvant se développer entre sculpture, installation, outil agricole et leurs lieux d’activation : l’exposition, le champ et les espaces de collectes et récoltes.
Pour la troisième édition de cet ARC, nous plongerons, en compagnie des intervenant.e.s et partenaires de ce cycles, dans des visions futuristes de possibles hybridations entre plantes et humains. Partant des écrits de Lynn Margulis et Dorion Sagan au sujet de l’apparition de l’Homo photosyntheticus, nous réfléchirons aux multiples scénarios extraordinaires que l’évolution des espèces permet.
Ces recherches nous demanderont une attention aux différentes échelles composant nos mondes. Comment appréhender les points de vue d’un insecte, d’une plante, d’un micro-organisme, d’un oiseau, d’un humain, d’une forêt, d’une montagne, ou d’une bio-région, et quelles manières peut-on hybrider, mettre en commun, et mettre en scène ces différentes corporéités ?
À partir d’une sensibilisation à ces différentes échelles, de quelle manière pouvons-nous penser et raconter les mouvements, les interactions et les migrations des êtres humains et végétaux à des horizons futurs ? Dans le contexte du Trièves et de la métropole de Grenoble, quelles alliances, quels récits, quelles hybridités possibles ?
Ainsi, en apprenant de la botanique et de l’ethnobotanique, en s’inspirant des recherches scientifiques sur l’évolution futur du climat et de l’environnement, sur l’évolution des sciences du vivant, en apprenant de la littérature des imaginaires (ou « science-fiction ») et des multiples formes de l’agriculture et de production de nourriture, nous imaginerons de possibles hybridations entre formes artistiques, agricoles et écologiques.
Dans une conjoncture, où le présentisme, les visions progressistes, spéculatives, ségrégationnistes et productivistes fragilisent fortement des modes de vies à l’échelle locale comme planétaire, il est crucial de ré-ouvrir les futurs et envisager une multitude de possibilités pour un avenir durable et symbiotique, construit d’interactions multiples, d’échanges entre différences, et d’espace de communs.
À l’horizon 2050, quels objets et quelles formes, quelles transformations du territoire, quelles représentations ou expressions peuvent engendrer de telles collaborations ?
À partir de méthodes transdisciplinaire, et à travers ce dialogue entre arts, agricultures et sciences, comment imaginer dans ces futurs des interactions entre un lieu et un territoire (un éco-système, un jardin, un champ, un quartier, une rivière, une intervention artistique in-situ), des objets (œuvres, outil et instrument) et des représentations (récit, narration, mise en scène) ?
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre, capacité à présenter et échanger à l’oral. Présence, assiduité et participation, assiduité, dialogue.
Repères bibliographiques / références :
L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021.
Karen Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, 2023
Emma Bigé, Clovis Maillet, Écotransféminismes, Pour des écologies transféministes, 2025
Octavia Butler, Parabole du Semeur, 1993.
Terres et liberté : Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, 2025
Patrick Chamoiseau, Les Neuf consciences du Malfini, 2009
Julie Crenn et Lauriane Gricourt, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024
Tj Demos, Radical Futurisms -Ecologies of Collapse/Chronopolitics/Justice to Come, 2023.
Donna J. Haraway Camille Stories, dans Vivre avec le Trouble, 2016.
Lynn Margulis, Dorion Sagan, L’univers bactériel, 1986
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées, 2013.
Ursula K. Le Guin, La Vallée de l’éternel retour, 1985.
Sébastien Marot, Taking the country’s side. Agriculture and architecture, 2019
William Morris, Nouvelles de Nulle Part, 1890.
Vandana Shiva, Jacques Caplat et André Leu, Une agriculture qui répare la planète, Les promesses de l’agriculture biologique régénérative, Actes Sud, 2021.
Œuvres et travail de : Atelier Paysan, Inland, Agence Coloco & Gilles Clément, FutureFarmers, Asunción Molinos Gordo, William Morris, Marjetica Potrc, Elisa Strinna, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Åsa Sonjasdotter, Otolith Group, Natsuko Uchino.
Atelier de Recherche et Création - L'air de rien (S.R.)
“La partie importante de l’œuvre était que je retournais simplement le gaz qui avait été enlevé de l’atmosphère, gardé dans un récipient dans un certain volume mesurable, et aurait donc été utilisé commercialement.. De cette façon, se crée un cycle. » Robert Barry 1966
Objectifs du cours :
Dans cet ARC nous nous intéresserons aux éléments naturels et leurs interactions avec la création artistique. Comment depuis des siècles les artistes exploitent dans leurs œuvres les éléments naturels, non seulement comme sujet ou motif, mais aussi, comme matériaux, outils ou comme espace dans lequel s’articulent des formes.
Il est également question de l’air et de l’art. Le premier est l’incarnation de l’invisible, le second, le sacro-saint du regard. Ceci pourrait sembler paradoxal et pourtant ! Bien qu’il puise son langage dans le visible et le tangible, dans un monde où la visibilité est devenu un enjeu majeur de l’existence, la fonction essentielle de l’art ne serait-elle pas de figurer l’invisible ?
De Botticelli a Otoniel, passant par Duchamp, Morris, Barry ou encore Messager, l’art prend parfois de bonnes inspirations pour donner a voir « cela qui ne peut être peint »*.
Plusieurs intervenants, théoriciens et plasticiens, viendront partager leurs expériences et réflexions sur ces questions. Ainsi, nous accueillerons Thierry Davila, historien de l’art, conservateur de musée et commissaire d’expositions, pour une conférence d’ouverture intitulée De l’air.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu
. Exposition des travaux en fin d’ARC (lieu encore à définir)
. Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
. Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)
. Présentation des travaux, mise en espace.
. Qualité des réalisations.
. Relation de travail, présence en cours, engagement.
. Entretien 20 minutes avec l’étudiant lors du bilan. Notation /20
Repères bibliographiques / références :
- De l’inframince – Brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Thierry Davila. Editions du Regard. 2019
- Littératures et arts du vide, Sous la direction de Jérôme Duwa et Pierre Taminiaux Édition : Hermann. 2018
- La puissance créatrice du souffle, Maurice Fréchuret Edition: Les presses du réel. 2024
- Inclusions, esthétique du captitalocène, Nicolas BourriaudEdition : Puf, Perspectives critiques. 2021
- L’art a l’état gazeux, Yves Michaux Edition : Stock. 2003
Atelier Pratique - Blender's Abstract Vibe (B.J.)
Méthode d’enseignement :
Travail sur le logiciel Blender et sur son interopérabilité avec les logiciels de montage Final Cut Pro et Da vinci Resolve. Cela signifie que ces autres logiciels sont également pris en compte dans l’enseignement.
Objectifs du cours :
Apprendre à créer des formes abstraites dans Blender, configurer des matériaux avec la transparence alpha et exporter des séquences d’images avec le canal alpha pour une utilisation composite dans des logiciels de montage (Final Cut Pro, Da vinci Resolve ou Gimp pour des travaux statiques). Cela pourra également donner lieu à quelques aperçus de la fonction tracking de Blender.
Contenu du cours :
Apprentissage des principes de production 3D dans Blender et compréhension de l’écosystème d’image à partir de la couche Alpha et des jeux de transparences. Concepts clés : modélisation, texturage, UV mapping, animation, montage, compositing, rendu.
Modalités et critères de l’évaluation :
Sera évalué la qualité du travail, la concentration de l’étudiant sur son projet, son degré de participation au cours lors des échanges. La présence en cours est un élément clé de l’évaluation.
Repères bibliographiques / références :
Simulacre et simulation (Jean Baudrillard)
Eloge de la simulation (Philippe Quéau)
Atelier Pratique - Brico Musique (F.N.)
Méthode d’enseignement :
La philosophe théoricienne Agnès Gayraud, dans son essai Dialectique de la pop, défini la musique pop comme étant : ”les musiques populaires enregistrées” et, par extension, diffusées et distribuées. En s’appropriant cette idée et en inscrivant le procédé de fabrication au centre de la réflexion, BRICO MUSIQUE envisage la création musicale comme un pratique accessible, joyeuse, et performative. Avec l’économie de moyens comme moteur de formes singulières, et expressives.
Objectifs du cours :
– Comment s’approprier l’outil informatique pour composer de la musique ?
– La musique pop a-t-elle des limites ?
– Comment performer la musique pop en live ?
– L’économie de moyens comme vecteur d’émancipation
– Comment prendre du recul face à la dichotomie art et industrie, inhérente à la musique pop ?
Contenu du cours :
BRICO MUSIQUE est un cycle pédagogique mené à l’ESAD Grenoble depuis trois saisons, s’articulant autour d’ateliers, de workshops, d’interventions.
Son objectif est de pratiquer et fabriquer de la musique pop contemporaine, tel une matière à détourner, à déconstruire, à rejouer. Il s’agit d’en faire un terrain d’expérimentations et un objet esthétique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continue
Repères bibliographiques / références :
Le workshop en partenariat avec Le CIEL s’attachera quant à lui, à poursuivre sa lancée et pousser plus loin les gestes performatifs et collaboratifs en live. Il sera aussi question d’investiguer sur la capacité de déconstruction et de réinvention de la musique pop en live, qui en font un objet plastique à part.
Vous trouverez sur via lien une playlist des films documentant les différents workshops BRICO MUSIQUE au CIEL depuis 2024 : https://urlr.me/75MFet
Atelier Pratique - Edit (A.O.)
Méthode d’enseignement :
Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l’embaussage à froid, le gaufrage, et d’autres techniques encore inexplorées. Mise en commun de savoir-faire technique.
Partage de données.
Objectifs du cours :
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession et de rythme. Comment le support papier, les doubles pages et leurs successions peuvent rendre compte des intentions ? Mettre en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Contenu du cours :
Un atelier
Qui part d’un besoin d’édition
Qui explore les éditions d’artistes
Qui propose des micro-expositions
Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Il s’agit d’effectuer un travail de mise en page, de mise en relation, de penser plastiquement le format et le rythme de succession des pages. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence et participation.
Repères bibliographiques / références :
Le travail d’atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentes à la bibliothèque et dans d’autres lieux de ressources.
Atelier Pratique - Fabrique de l'image (C.T.)
Méthode d’enseignement :
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation et d’apprentissage, d’accompagnement, de production, permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.
Objectifs du cours :
À travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement…
Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC, finition/présentation).
Contenu du cours :
Il est proposé aux étudiants d’engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.
Au cours des deux première séances d’Octobre, l’appropriation des nouveaux espace du labo photo et l’exploration du medium se feront à travers une expérimentation collective de la photo-sensibilté alliant papier et film.
Ces productions seront présentées en novembre dans une exposition inaugurale des espaces du Pôle Image.
Plus globalement, les travaux seront conduits autant en prise de vue, que ce soit en extérieur ou en studio (film argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique…).
Les étudiants viendront à l’atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d’en faire l’inventaire et d’en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt de l’ESAD. Les consommables photographiques (films, papiers et chimies) seront fournis pour les travaux en AP.
Modalités et critères de l’évaluation :
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme à déterminer : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan.
Repères bibliographiques / références :
LLANG Thomas. https://www.thomaslang.fr/gestalt
MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d’une ville 1987-89.
SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
GENESTE Guillaume: Le tirage à mains nues. Edité par La main donne 2020.
À emprunter à La Bibliothèque d’étude et du patrimoine. Fonds moderne SL 771 GEN
Emission Par les temps qui courent ( France Culture 20/10/2020 durée : 00:44:56 ) – par : Marie Richeux, Jeanne Aléos, Romain de Becdelievre – nous recevons le tireur et photographe Guillaume Geneste. Avec lui nous discutons de son travail en laboratoire, de l’émotion devant une planche contact et de son ami Denis Roche. – réalisation : Jean- Christophe Francis, Lise-Marie Barré – invités : Guillaume Geneste Qui réalise des tirages de grands photographes https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-jeudi-22-octobre-2020
DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009. http://www.michelcampeauphotographies.com/
WOLFF Ilan « Camera Obscura at work » 1982-1997 et http://www.ilanwolff.com/
https://www.culture.gouv.fr/fr/espacedocumentation/bases-de-donnees/Fiches-bases-de-donnees/arago-le-portail-de-la-photographie Musée en ligne de la photographie permettant d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en France.
Exposition de Pascal Sarrazin à l’Espace Nelson Mandela de Fontaine jusqu’au 11 octobre 2025.
Journées de la photographie de la Maison de l’Image, les 8 et 9 novembre 2025 à l’Ancien Musée Bibliothèque, place de Verdun (https://www.maison-image.fr).
Atelier Pratique - L'eau ça coule et ça mouille (S.R.)
Atelier Pratique - Quels matériaux pour représenter les futurs ? (E.D.F.)
Méthode d’enseignement :
Chaque étudiant·e travaillera à partir d’un projet personnel. Dans une approche résolument transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation à partir de différentes visites dans un ou plusieurs sites de la métropole de Grenoble : entreprises et associations travaillant sur de matériaux recyclées, durables et écologiques comme l’association G-Recip, le département CraTerre (école d’architecture), la Design Factory de l’Université Grenoble-Alpes, MTK et autres lieux à confirmer.
Nous serons également en dialogue régulier avec Giulia Bellinetti (coordinatrice du Nature Research department et du laboratoire Future Materials Lab à la Jan Van Eyck Academy).
Objectifs et contenu du cours :
Dans les contextes environnementaux et sociaux que nous connaissons, il est indispensable d’engager une réflexion sur les matériaux utilisés, et de favoriser les circuits les plus courts et les plus éthiques mais aussi le réemploi ou le recyclage. Quelle vie des œuvres, quels devenirs des œuvres ? Comment prendre en compte le caractère éphémère ou en évolution d’un matériau. Quelle relation entre pérennité et transformation d’une œuvre ?
Dans le contexte de la réouverture de l’école sur le site de Lesdiguières, on s’interrogera sur les lieux dont les ateliers se fournissent en matériaux, et sur les conditions de création d’une récupérathèque. On continuera un travail de cartographie des ressources à l’échelle de la métropole de Grenoble et de son territoire environnant.
Par cette attention, il ne s’agit pas de limiter la créativité, mais au contraire de repartir d’une réflexion systémique sur les matières, leurs contextes d’origine et d’extraction pour déployer les imaginaires.
Bois, métaux, minéraux, matériaux de synthèse, chimiques, numériques, électroniques…nous ferons un tour d’horizon afin que chacun/chacun se saisisse de matières choisies, et réalise son projet personnel.
À partir de cette relation tissée à un ou plusieurs matériaux, il s’agira pour chaque étudiant·e. de penser un projet personnel dont le sujet sera la représentation de la métropole de Grenoble et de la région du Trièves dans un futur proche et lointain : 2050.
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre
Repères bibliographiques / références :
Future Materials Banks, Jan Van Eyck Académie, https://www.janvaneyck.nl/postacademy/future-materialshttps://www.futurematerialsbank.com/
Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental, ouvrage collectif sous la direction de Elio Della Noce et Lucas Murari, 2022
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Œuvres et travail de : Marjetica Potrc, Richard Long, Superflex, Joseph Beuys, Matthew Barney, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Giuseppe Penonne, Pierre Huyghe.
Atelier Pratique - Module curatorial (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Atelier pratique. Rendez-vous en groupe, conception, organisation et suivi des projets pris en charge par l’AP.
Objectifs du cours :
Ce module, ouvert à une quinzaine d’étudiant·es par semestre, propose une approche à l’échelle un de la pratique de l’exposition. De manière à apprendre à concevoir et mettre sur pied un projet d’exposition.
Cette année, il sera proposé aux étudiant·es de prendre part à deux projets, un pendant le semestre et l’autre au printemps, en lien avec des partenaires :
-l’événement Petites formes performatives, avec deux performances de Candice Burnet et Amar Ruiz, à l’automne, au Centre d’art Bastille
-l’exposition photographique dédiée aux représentation de l’habiter et de l’environnement pendant et après les confinements de 2020 dus à la pandémie de Cvid-19, en mars, à la galerie de l’école ou à la galerie Xavier Jouvin et dans les bibliothèques du campus ; avec le Master Pro Histoire de l’art de l’UGA
Ces projets permettront de mieux comprendre les enjeux conceptuels à l’origine d’un projet d’exposition, tout comme les enjeux logistiques, le transport d’œuvres, l’accrochage, la maintenance, la surveillance d’exposition, etc.
D’autres projets, amenés par les étudiant·es comme d’autres partenaires pourront être développés dans ce cadre.
Contenu du cours :
Le module curatorial repose sur l’expérience pratique, les étudiant·es seront en charge des projets réalisés où la prise de décision, le dialogue avec les personnels administratifs et techniques de l’école et les partenaires extérieurs de l’école seront au cœur de l’expérience collective. Cela permettra de comprendre les différentes étapes et enjeux d’un projet de monstration. Le but est de permettre aux étudiant·es d’acquérir les outils conceptuels et pratiques permettant à terme de construire des projets en toute autonomie et de commencer à construire un réseau artistique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, évaluation sur la présence, la participation aux temps collectifs et sur l’implication dans les projets.
Repères bibliographiques / références :
Atelier Pratique - Moulage (J.S.P.)
Méthode d’enseignement :
Atelier
Objectifs du cours :
Découvrir et se familiariser avec certaines techniques du moulage.
Contenu du cours :
Expérimenter le moulage d’objets simples, de partie du corps avec divers matériaux (en fonction des commandes et stocks disponibles) : Plâtre, argile, béton, alginate, silicone, résine, latex, etc.
Calendrier :
1- Jeudi 9 octobre 14-18
2- Jeudi 6 novembre 14-18
3- Jeudi 20 novembre 14-18
4- Jeudi 4 décembre 14-18
5- Jeudi 18 décembre 14-18
6- Jeudi 15 janvier 2026 14-18
7- Jeudi 29 janvier 2026 14-18
Modalités et critères de l’évaluation :
Présences régulière des étudiant·es.
Concevoir un projet final issu des différentes expériences du moulage.
Repères bibliographiques / références :
Une partie du matériel sera fourni par l’école. Pour des projets plus spécifiques, l’étudiant·e se fournira par ses propres moyens.
Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Cours théoriques à l’ÉSAD et ateliers à l’extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.
Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l’acte photographique. Nous essaierons d’interroger la photographie dans son essentialité, c’est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.
Objectifs du cours :
« Je ne fais pas la photo d’un paysage, je fais une photo d’un paysage. » Eric Hurtado
Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d’une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l’invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfuie, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.
Trouver un chemin dans les herbes, c’est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d’une éclaircie de notre existence au monde.
Contenu du cours :
Comment la photographie nous permet le passage de l’acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d’une vision.
L’enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre « prendre une photo » et « accueillir une image », dépasser le sujet pour sa question.
Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues (argentique ou numérique), à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimenterons lors d’ateliers pratiques, à l’ESAD comme lors de sorties en extérieur.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Livres
Raymond Depardon, Errance. Points / Seuil
Luc Delahaye, L’autre,Phaidon
Winterreise, Phaïdon
Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl
Lewis Baltz, Texts, Steidl
Garry Winogrand, Catalogue Jeu de Paume, Flammarion
Henri Cartier-Bresson, L’instant décisif, in L’imaginaire d’après nature, Fata Morgana
Voir est un tout, Centre Pompidou
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Rodtchenko photographe, Parenthèses
Bernard Plossu, Revue Lisières, 21
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Le point aveugle, Musée Hébert
Films
Raymond Depardon, Journal de France
Michelangelo Antonioni, Blow-up
Wim Wenders, Palermo shooting
Le sel de la terre
Sasha Waters Freyer, Garry Winogrand
Laurent Roth, Les yeux brûlés
Manoel de Oliveira, L’étrange affaire Angélica
Jean-Luc Godard, Je vous salue Saravejo
Film socialisme
Gilad Baram, Koudelka shooting holy land
Atelier Pratique - Si je ne peux pas danser... (K.S. & S.F.)
Méthode d’enseignement :
- Résidence de recherche de 6 jours à Centrale Fies – Centre de Recherche sur les Pratiques Performatives Contemporaines et workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (Octobre 2025)
- Organisation et suivi curatorial de la résidence de recherche de l’artiste Ru Kim (Novembre 2025) à Grenoble et participation en tant que performeur.euses à son projet pour le Festival des Gestes de la Recherche (Décembre 2025)
- Rendez-vous hebdomadaires.
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Contenu du cours :
L’atelier pratique « …si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution » est lié à l’unité de recherche “Hospitalité artistique et activisme visuel” (Simone Frangi et Katia Schneller) et à la mention “Holobionte. Pratiques visuelles, exposition, et nouvelles écologies de l’art”. Il est également mené en collaboration avec Melis Tezkan et son ARC lié à la seconde année du programme de recherche “What’s love got to do with it ?” soutenu par le Ministère de la Culture.
Intitulé d’après une affirmation historiquement attribuée à la militante anarchiste Emma Goldman, qui qualifiait la danse ainsi que la joie et le plaisir d’outils révolutionnaires dignes et efficaces, l’AP envisage la performance multimédia et la musique (au sens de production sonore élargie) comme des plateformes militantes puissantes. La collaboration entre S. Frangi, K. Schneller et M. Tezkan construit un parcours pédagogique structuré et centré sur les pratiques critiques joyeuses, exubérantes et non moralistes qui croisent l’expérience performative avec des questions militantes dans l’espace de lutte de la dissidence de genre, de l’anti-colonialisme, de l’anti-capitalisme et de l’écologie.
L’ARC de Melis Tezkan – développé en collaboration avec cet AP – donnera lieu également au cours du premier semestre à des workshops avec différent.es invité.es qui travaillent dans ce sens en lien avec le programme de recherche “What’s love got to do with it ?”. Les participant.es à l’AP qui auront assisté à la résidence à Centrale Fies prendront en charge quelques séances de restitution et de transmission des expériences menées en Italie.
Résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies (https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture de ce parcours du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025. L’idée de ce voyage est de faire une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel italien pour suivre un workshop. Situé dans une ancienne centrale hydroélectrique près de la ville de Trento dans le nord de l’Italie (https://www.centralefies.it/building/), Centrale Fies organise un festival de performance depuis plus de 45 ans, et récemment devenue partenaire institutionnel d’écoles supérieures européennes centrées autour de la performance comme le Dutch Art Institute d’Amsterdam/Arnhem et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence sera tout d’abord l’occasion de se former aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) en travaillant avec le technicien de Centrale Fies.
Un workshop y sera organisé avec l’artiste invité Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), artiste basé.e à Amsterdam, aux Pays-Bas, dont la pratique queer croise la performance et la musique. Le travail du Publik Universal Frxnd porte sur l’interaction entre les formes visuelles de représentation/abstraction et les formes politiques de reconnaissance et de marginalisation. En mettant l’accent sur les pratiques folkloriques et les histoires locales, son travail le plus récent explore les sentiments de deuil et de perte à travers une perspective critique de l’héritage nécropolitique du colonialisme sur les travailleur.euses. Son travail s’intéresse à la manière dont l’industrialisation a permis à notre interaction avec les machines de façonner nos vies et nos expressions culturelles. Le Frxnd fait référence à un personnage historique. Un.e hérétique, un charlatan.e, une contradiction dans les termes, le Frxnd est l’énonciation d’un pouvoir ou d’un esprit supérieur et n’a pas de sexe malgré la forme de son vaisseau terrestre. Iel est et a peut-être toujours été un instrument permettant d’aller au-delà de l’imagination et de la perspective limitées de la position spécifique d’un sujet. Le Publik Universal Frxnd est un mouvement dans le temps vers une défaite du moi. Vous trouverez des informations sur sa pratique sur son site.
Participer à la performance de Ru Kim : Au cours du mois de novembre, l’artiste coréen·ne Ru Kim fera une résidence de recherche à l’ESAD. Iel donnera un workshop (13-14/11 et 20-21/11) dans le but d’élaborer une performance avec les participant.es de l’AP qui sera présentée lors du Festival des Gestes de la Recherche (2-4 décembre 2025).
Dans sa pratique, Ru Kim associe la performance et le texte à des installations vidéo et sonores. Ses projets questionnent la résistance et la réappropriation des perpétuations de la violence générées par les idéologies patriarcales, impériales et coloniales de la domination. Ils cherchent à développer des formes qui remettent en question les binaires et les identités figées.
S’appuyant sur sa propre fluidité linguistique, culturelle et identitaire, Ru Kim se nourrit des théories féministes hydro-, noires et queer pour mener des analyses déconstructivistes des représentations oppressives, racistes et coloniales. Ses projets récents se concentrent particulièrement sur les histoires racontées depuis le point de vue du témoin plus qu’humain, les stratégies de l’eau abordées dans une perspective hydroféministe, la documentation de la queerness dans l’histoire coréenne, et les archives révélant la construction « asiatique » promulguée par le regard occidental.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet et rendu d’un document écrit.
Repères bibliographiques / références :
Atelier vidéographie (Y.F.)
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Actualités de l'art contemporain : rencontre avec des acteur·ices du champ artistique grenoblois et d'ailleurs (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Rencontres et échanges avec des acteurices du champ de l’art contemporain, local et plus lointain.
Visites de structures de diffusion de l’agglomération, rencontres avec leurs directeur·ices et équipes.
Entretiens par groupes avec des artistes et commissaires d’exposition.
Travail de recherche en groupe afin de remettre en perspective historique les personnes et pratiques rencontrées.
Bilan par groupes à l’école.
Objectifs du cours :
Elargir et préciser ses connaissances du champ de l’art contemporain et de son actualité par sa partie émergée – expositions, événements publics – autant que par sa partie non visible – production, processus, activité en train de se faire.
Rencontrer diverses manières de penser, de faire et de montrer pour pouvoir affiner ses envies et fabriquer son propre positionnement.
Mener des recherches spécifiques afin de remettre en perspective historique, contextualiser, comprendre, critiquer et pouvoir se situer par rapport à ces cas d’étude (personnes, pratiques, structures).
Comprendre quelle(s) place(s) on peut occuper au sein des réseaux artistiques.
Contenu du cours :
Le cours se déroulera hors de l’école, sur les lieux et en présence de leurs acteur·ices. Chaque séance apportera des points de vue, des parcours, des manières de faire art, de l’étudier et/ou de le diffuser et de s’inscrire dans le champ de l’art contemporain. L’échange sera basé sur la préparation en amont, la participation active de chacun·e, l’ouverture et le dialogue. Les rencontres en classe entière seront accompagnées d’un travail sur la forme de l’entretien, en petit groupe. Chaque groupe devra mener ses recherches à la bibliothèque, en ligne ou sur le terrain de manière autonome et coordonnée.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité et participation ;
Rendu ad hoc en fin de semestre : compte-rendu par groupe de l’échange avec l’artiste, remise en contexte et en perspective historique, cohérence fond-forme de la présentation.
Repères bibliographiques / références :
– https://www.archivesdelacritiquedart.org/
– http://yaci-international.com/fr/collectives/jeunes-critiques-dart/
Des éléments biblio-sitographiques complémentaires seront apportées à chaque séance.
De l'artiste qui illustre et qui écrit à l'artiste qui édite : histoires du livre d'artiste (C.B.)
Essai textuel et visuel (C.B.)
Anglais et Atelier de Mobilité (B.V.)
Méthode d’enseignement :
Discussions et ateliers d’écriture, travail en petits groupes et rendez-vous individuels.
Objectifs du cours :
Développement de l’autonomie critique de son travail, de la capacité de le situer par rapport à d’autres œuvres du champ de l’art et à l’articuler avec des textes théoriques. Développement d’un type d’écriture personnelle et cohérente avec le projet de recherche, étude des différents régimes d’écriture existant entre art et littérature. Acquisition du vocabulaire et des modalités descriptives des œuvres plastiques. Réflexion sur la cohérence fond-forme et réalisation d’un objet abouti autant dans son contenu que dans sa forme et son format.
Contenu du cours :
Ce temps de travail a pour but d’amener les étudiant·es à formaliser par écrit les relations existant entre la production d’un texte à partir d’un travail plastique et ce travail lui-même. Les étudiant·es présenteront régulièrement des textes présentant la recherche théorique développée à partir de leurs recherches plastiques. Ce travail prépare les étudiant·es au travail d’écriture de l’Essai de DNSEP, en utilisant la lecture et l’écriture comme un outil de production et de recherche.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, participation orale et travaux écrits remis au fil du semestre.
Repères bibliographiques / références :
Des repères bibliographiques seront donnés au cas par cas à chaque étudiant·e.
UE3 Recherches et expérimentations
Recherches personnelles plastiques
à venir
Galeries d'essai / accrochages
Champ libre
Méthode d’enseignement :
Séminaire d’accompagnement à l’après-école à destination des étudiant·es de 3A, 4A, 5A. Mise en question des enjeux de professionnalisation.
Interventions d’acteur·ices des mondes de l’art (artistes, commissaires d’exposition, juristes, etc.).
Chaque séance est préparée collectivement via un document partagé par les étudiant·es ; les échanges avec les intervenant·es sont ainsi pris en charge par les participant·es.
Objectifs du cours :
Préparer à l’après-école par des retours d’expériences et des séances d’information et/ou d’ateliers pratiques.
Contenu du cours :
Au 1er semestre : cycle de 4 séances de rencontres avec des artistes, enseignantes de l’ESAD-G, diplômé·es de l’ESAD-Grenoble ou d’ailleurs, en résidence à Grenoble et environs, un mercredi par mois (en octobre, novembre, décembre, janvier).
Au 2nd semestre : séances thématiques à propos du statut (artiste-auteur, micro-entreprise, association), de la communication de la pratique (portfolio et site web) et de la résidence artistique (résidence mission, résidence de recherche), etc.
Modalités et critères de l’évaluation :
Préparation de chaque séance par des recherches.
Préparation collective d’une série de questions à destination des intervenant·es.
Présence et participation active dans les échanges lors de la rencontre.
Repères bibliographiques / références :
UE4 Bilan
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
à venir
Grille d'évaluations Art 3 - Semestre 6 :
UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Workshop mixte - Fête du cri (K.S & S.F.)
Contenu du programme
Utilisation « intelligente » des outils numériques tels que Chat GPT, Google, Deepl
Présentation croisée des étudiant·e·s à travers leur travail
Établir une liste de mots-clés
Révision du vocabulaire à travers des séances de brainstorming
Écriture d’un court texte sur le travail d’un·e pair à partir de mots-clés attribués
Échange et analyse de textes (bons et mauvais exemples de lettres et CV)
Constitution d’un lexique personnel lié à la présentation de soi et de ses projets
Élaboration et révision de son personal statement à l’aide d’outils numériques (ex. : ChatGPT)
Analyse collective d’un bon et mauvais exemple d’écrit
Comparaison des CV français et anglophones à partir de documents-types
Recherches documentaires
Étude de projets de mobilité réalisés les années précédentes
Préparation des portfolios numériques
Travail individuel sur les CV et les lettres de motivation, accompagné de retours personnalisés
Modalités et critères de l’évaluation :
Assiduité – Présence
Participation – Progrès
Rendus en fin de semestre –
C.V.
Artist’s Statement
Portfolio
Repères bibliographiques / références
International Mobility Applications – Années précedentes
Workshop mixte - Abstraction figurative (B.J.)
Workshop mixte - - Sculpter l'espace (M.T.)
Workshop mixte - Bricomusique (F.N.)
Workshop mixte - Oscinato (C.T.)
Workshop mixte - La forme du monde : montagne vivante, montagne morte (C.B.)
Workshop mixte - Image aux confins (E.H.)
Workshop mixte - Simulation effect (B.J.)
Workshop mixte - Terminus (S.R.)
UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Workshop Temps forts écriture - Portfolio
L’écriture est à la fois matière et outil dans le parcours des étudiant·es en école d’art.
Certain·es convoqueront ce medium d’expression en lui donnant place au sein de pratiques plastiques et toustes s’en empareront pour différentes nécessités d’analyse et de réflexion ou de communication.
Méthode d’enseignement :
Au cours du premier semestre, avant d’engager les deux Temps Forts, un travail préparatoire est demandé à chaque étudiant·e à travers un Index consignant chronologiquement et renseignant selon quelques critères pertinents, tous les travaux qu’il·elle a réalisés au cours des trois dernières années.
Par ailleurs seront rassemblées et organisées dans des dossiers l’ensemble des images et photographies documentant ces travaux et pratiques artistiques.
Afin que chacun·e puisse enrichir le fonds iconographique documentant ses productions, des séances de prise de vue seront mises en place à la demande au statif de reproduction et en studio de prise de vue.
-Temps fort écriture n°1 du 17 au 19 Février 2026.
Présentation des objectifs liés au Portfolio. Exercices et mises en place des éléments essentiels qui participent à la conception du Portfolio. Choix de la structuration du document (axes et travaux associés) et des textes, des images dans une maquette appropriée.
-Temps fort écriture n°2 du du 24 au 26 Mars 2026.
Période intense de finalisation du Portfolio en vue, dans un premier temps, des dossiers de mobilité auprès d’établissements universitaires ou culturels à l’étranger ou pour les demandes de stages auprès d’artistes.
Objectifs et contenu du cours :
Au second semestre, le travail d’écriture se module à travers plusieurs objectifs liés à la préparation du DNA, à l’orientation de chacun·e et à la préparation de la mobilité se déroulant en quatrième année: le Portfolio, accompagné par l’enseignant·e en Photographie / Image en étroite relation avec Anglais et Atelier Mobilité : projet de mobilité, Statement, CV, lettres de motivation, proposés par Béatrice Vigato avec un travail de l’anglais (ou d’autres langues étrangères si nécessaire).
Pour permettre une dynamique porteuse de créativité, deux Temps Forts sont programmés autour de l’élaboration et la réalisation de ces documents et plus particulièrement du portfolio.
Les processus d’écriture, les formes de textes, l’utilisation de corpus d’images, les rapports texte-image, la mise en page et les solutions éditoriales seront explorées et se concrétiseront dans la finalisation des documents attendus.
Modalités et critères de l’évaluation :
Attribution d’ECTS pour ce workshop « Temps Fort Ecriture ». Evaluation continue tout au long du projet. Sont prises en compte les capacités que montre l’étudiant·e à aborder les différentes phases de recherche et réalisation : participation, travail fourni, capacité de proposition et production, qualité de l’échange et de l’analyse.
Repères bibliographiques / références :
Document texte / Image (S.F.)
Anglais et Atelier de mobilité
Anglais - textes portfolio
Méthode d’enseignement :
Groupes de niveau :
A2-B1 : impliquant un renfort grammatical et lexical
B2-C1 : visant à une pratique avancée.
Objectifs du cours :
Acquisition de culture artistique anglophone ;
Savoir s’exprimer sur ses productions artistiques ;
Asseoir les compétences à l’écrit et à l’oral.
Contenu du cours :
« Galeries d’essai/Test Tubes » en anglais
Accrocher et présenter son travail en cours ou abouti, en discussion avec le demi-groupe d’étudiant·es et l’enseignante, et possiblement un.e invité.e professionnel·le anglophone.
Production écrite de son « statement » (démarche artistique) avec insertion dans document de synthèse de fin d’année.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, assiduité et participation requises
Repères bibliographiques / références :
outils en ligne, support papier :
- sites internet, réseaux sociaux : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
UE3 Recherches et expérimentations
Recherches et expérimentations
à venir
UE4 Diplôme
Passage du diplôme
à venir
UE4 Stage
Stage
à venir
Deuxième cycle - option Art
ANNÉE 4
L’organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d’une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d’encourager la maîtrise et la production d’outils méthodologiques de création et de recherche, c’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.
Les enseignements pratiques d’ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés. Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d’espaces d’échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d’interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant·es. et ponctuellement soutenus par des intervenant-e-s au sein des Arc et workshops proposés.
L’étudiant·e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, auprès d’un artiste ou d’une structure artistique (école d’art, centre d’art, musée…) qui fait l’objet d’une recherche et validation encadrée par Béatrice Vigato et Raphaëlle Gondry, co-responsables des relations internationales. La mobilité s’étend d’une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé au semestre 8.
Le semestre 8 est consacré aux mobilités internationales : dans notre école, les stages et semestres réalisés dans une école d’art à l’étranger se font tous sur cette période. Pour autant, un suivi pédagogique continu est garanti avec son équipe pédagogique de Grenoble, principalement pour son suivi de rédaction de mémoire. L’étudiant·e se voit attribuer 2 tuteurs·rices enseignant·es qui l’accompagneront tout au long du semestre pour faire progresser la recherche et l’écriture.
Liste des unités d'enseignements
Semestres 7 et 8
UE1 : Initiation à la recherche – Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts – 9 ECTS
UE2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production – 20 ECTS
UE3 : Langue étrangère – 1 ECTS
Grille d'évaluations Art 4 - Semestre 7 :
UE1 Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
Suivi d'écrits : le mémoire
Initiation à la recherche - Home is a gut feeling (K.S. et S.F.)
Initiation à la recherche - Nourriture et convivialité (P.R. et C.B.)
Initiation à la recherche - Art et santé (UGA)
Initiation à la recherche - Cinéma et philosophie (UGA)
UE2 Projet plastique – prospective, méthodologie, production
Atelier de Recherche et Création - Documenter le Monde (F.N.)
Atelier de Recherche et Création - Playlist Remix (M.T.)
Méthode d’enseignement :
Recherches individuelles et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, séances d’écoutes, séances de lectures, production d’objets rendant compte de la recherche, exercices de courte et de longue durée, présentation publique.
Avec également :
Une résidence de recherche de 6 jours avec 6 étudiant·es de l’ARC à Centrale Fies – Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, avec un workshop animé par l’artiste Publik Universal Frxnd (octobre 2025)
Un workshop de transmission à l’ARC par les étudiant·es ayant participé à la résidence
Un workshop de drag imaginé avec les étudiant·es Emmanuel·le Garin et Faustine Stricanne
Un·e ou deux invité·es pour un ou deux workshops
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Démystifier la performance
Produire ou interpréter des formes, gestes, textes, chansons, etc.
Travailler des formats de collaboration et/ou en collectif
Contenu du cours :
En partant de la place que la musique occupe dans nos mémoires et de la manière dont elle structure nos souvenirs, l’ARC Playlist Remix 2 s’inscrit dans le cadre du programme de recherche What’s love got to do with it?, qui explore comment nos émotions nous informent sur le monde et comment, en tant qu’artistes, nous pouvons apprendre de la façon dont ces émotions génèrent des récits. Avec les intervenant·es invité·es, nous nous pencherons également sur les pratiques musicales ou performatives, ainsi que sur les notions de spectacle et de fête.
*Sur la résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies(https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture du parcours Performance, du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025.
L’objectif est de vivre une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel situé dans une ancienne centrale hydroélectrique, près de Trente, en Italie (https://www.centralefies.it/building/). Ce lieu accueille un festival de performance depuis plus de 45 ans et collabore avec des écoles telles que le Dutch Art Institute (Amsterdam/Arnhem) et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence permettra notamment :
- Une formation aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) avec un technicien de Centrale Fies
- Un workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), basé·e à Amsterdam, dont la pratique queer articule performance et musique
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, régularité de la participation, qualité des recherches et soin dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dynamique collective de l’atelier.
L’évaluation portera également sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Atelier de Recherche et Création - Confluence (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique sur sites.
Exposition dans la galerie de l’école.
Objectifs du cours :
Eau qui médite, enclos du temps.
Paupière close. Un silence qui écoute.
Eric Hurtado
Questionner par la photographie et la vidéo le territoire d’une rivière, son bassin, son déploiement, sa confluence avec l’activité humaine. Nous questionnerons également notre conscience de celle-ci, confluence elle-même de l’existence de la rivière avec notre regard. La question du réel, toujours, rivière qui coule et semble fixe.
« L’image est au confluent de la lumière venue de l’objet et de celle qui vient du regard. » PLATON
Contenu de cours :
L’Arc débutera par la projection de Stalker, d’Andreï Tarkovski, film questionnant la réalité d’un territoire et la conscience des inventeurs de celui-ci (au sens réunissant découverte et invention, justement arcane fondamental de la quête photographique.)
Suivront deux journées de rencontre et d’atelier photographique avec le photographe Jean- Marc Blache, qui a photographié l’eau sous toutes ses formes, de la glace à l’exploration sous-marine dans de nombreux pays. Il nous accompagnera lors d’une séance de prises de vues sur le territoire du Drac, au sud de Pont-de-Claix et pour la restitution des travaux.
Chaque quinzaine, en semaine B, une des deux journées de travail de l’Arc sera consacrée à une sortie de prises de vues en extérieur sur le thème de l’eau.
Un voyage pédagogique est également prévu dans le Vercors à la grotte de Choranche.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à l’issue de l’Arc dans la galerie de l’École.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Films :
Andreï Tarkovski, Stalker
Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu
Michelangelo Antonioni, Gente del Po
Désert Rouge
Jean-Luc Godard, Opération Béton
Jean Giono, L’eau vive
Livres :
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Raymond Depardon, Errance. Points/Seuil
Roland Recht, La lettre de Humboldt, Christian Bourgois
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Atelier de Recherche et Création - Sphère (B.J.)
Méthode d’enseignement :
La sphère est un concept formel. Cet ARC est donc une proposition pour investir une forme dont la dynamique globale, sur le artistique, est abstraite. Mais l’idée de sphère est susceptible de s’imprégner d’éléments variés, comme celui de l’écologie par exemple (la terre est un écosystème sphérique), ou par des investigations fictionnelles (Sphère est le titre d’un film de science-fiction).
L’idée de sphère peut être investie de façon diverses : sur des supports digitaux (film, 3D), ou matériel (peinture, installation, photographie, performance). L’IA peut également être utilisée.
Objectifs du cours :
Cet ARC vous invite à plonger dans l’univers de la sphère, une forme universelle qui traverse l’art, la science, la philosophie et la nature. Symbole d’harmonie, de perfection et d’unité, la sphère est aussi une métaphore puissante pour réfléchir à la fragilité de notre planète Terre, un écosystème menacé par les activités humaines. À travers cet ARC, vous explorerez les dimensions formelles, symboliques et écologiques de la sphère à travers une œuvre ou plusieurs dans le médium de votre choix : dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, performance, multimédia, vidéo, 3D. Cet exercice est une occasion de conjuguer réflexion conceptuelle et engagement environnemental.
Contenu du cours :
Objectifs pédagogiques
- Explorer les caractéristiques formelles et esthétiques de la sphère.
- Intégrer une réflexion écologique en lien avec la Terre, sphère fragile et écosystème précieux.
Thèmes d’exploration autour de la sphère
La sphère, par sa simplicité et sa perfection, offre une multitude de pistes à explorer dont voici quelques exemples : :
- Forme et esthétique : géométriquement, la sphère est la forme la plus équilibrée, où chaque point de sa surface est équidistant de son centre. Dans l’histoire de l’art, elle inspire des œuvres architecturales (comme les dômes de Brunelleschi) ou sculpturales (les sphères polies d’Anish Kapoor). Comment pouvez-vous jouer avec la tridimensionnalité, les reflets, les ombres ou les illusions optiques pour réinterpréter la sphère ? Considérez les jeux de lumière, de texture ou de transparence dans votre travail.
- Symbolisme et philosophie : La sphère a longtemps incarné l’idée de perfection et d’infini. Pour les anciens Grecs, elle représentait le cosmos, une harmonie universelle. Dans l’art contemporain, elle peut évoquer l’unité, l’isolement ou la cyclicité du temps. Pensez aux installations immersives de Yayoi Kusama, où les sphères répétées créent un sentiment d’infini.
- Écologie et fragilité planétaire : La Terre est un écosystème complexe et vulnérable, confronté à des défis comme le changement climatique, la déforestation et la pollution. En tant qu’artistes, vous pouvez utiliser la sphère comme une métaphore pour alerter sur ces enjeux. Pensez à des matériaux de récupération ou à des installations qui évoquent la fragilité de notre environnement.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Format : Œuvre physique ou numérique.
- Recherche préparatoire : Au début de l’ARC, un moment d’échange qui s’appuiera sur une présentation visuelle d’images vous proposera des pistes de travail à travers la présentation d’un certain nombre d’exemples. Le domaine de l’art est privilégié mais il sera aussi question d’architecture, selon un choix lié à la forme sphérique. Lors de cette phase préparatoire, vous ressemblerez des références visuelles, textuelles ou conceptuelles dans un carnet de recherche pour trouver votre ou vos idées. Nous discuterons ensemble de ces projets et vous passerez ensuite à la réalisation.
- Production : vous aurez tout le premier semestre pour mettre au point votre réalisation. Vous produirez une œuvre dans le médium de votre choix. Il sera possible d’effectuer plusieurs travaux ou un seul s’il est suffisamment complexe pour justifier cette durée dans le temps.
- Dimension écologique : Intégrez une réflexion sur l’environnement, que ce soit par le choix de matériaux durables, un message visuel sur la crise climatique ou une œuvre qui incite à repenser notre relation à la Terre.
- Rythme des échanges : Je serai présent les lundi et mardi selon l’emploi du temps auquel vous devrez vous référer pour être présents à chaque fois. Les rencontres se feront de préférence de façon collective mais auront lieu également à travers des entretiens individuels.
- Présentation / évaluation : Fin janvier, vos œuvres seront accrochées lors du bilan à travers un accrochage collectif dans notre salle allouée à l’ARC et donneront lieu à un échange de points de vues et d’analyses.
METHODOLOGIE :
- Dessin/peinture : vous expérimenterez la forme de la sphère selon vos aspirations formelles. Les supports meuvent varier, pensez à expérimenter d’autres surfaces que le papier ou la toile.
- Sculpture/installation : vous utiliserez des matériaux disponibles à l’atelier de l’école ou des matériaux de recyclage que vous aurez glané (plastique, métal, bois) ou éphémères (terre, papier) pour construire une sphère ou une composition sphérique. Vous pourrez intégrer des projections, des sons ou des animations pour créer une expérience immersive autour du thème. Dans ce sens, pensez également à solliciter le matériel disponible dans le domaine de la lumière dont dispose l’école.
- Photographie/vidéo : jouez sur des paramètres de cadre, de lumière, pour construire des images dont la structure principale est sphérique. Le montage de films pourra se faire sur Final cut Pro ou Da Vinci Resolve.
- Performance : Les scénarios sont ouverts : mouvements circulaires, répétition, etc. (voir Abramovic et Ulay).
Repères bibliographiques / références art et architecture :
ART :
- Anish Kapoor : Ses sculptures sphériques, comme Cloud Gate, jouent avec les reflets et la monumentalité pour transformer l’espace et la perception. Sa série Sky Mirror présente également des surfaces paraboliques et circulaires.
- Tara Donovan : Une artiste américaine qui utilise des matériaux du quotidien (gobelets, pailles…) pour créer des installations organiques évoquant des formes sphériques ou cellulaires.
- Michelangelo Pistoletto : sa performance Newspaper Sphere interroge l’accumulation et la boulimie d’information à travers un processus d’accumulation performative.
- Marina Abramovic / Ulay : Relation dans le mouvement – une performance historique entre le mythe de Sisyphe (Camus) et celui de l’Eternel Retour (Nietzsche).
- Yayoi Kusama : connue pour ses motifs à pois omniprésents, elle utilise la forme ronde dans ses peintures, sculptures et installations immersives, créant des expériences infinies et psychédéliques.
- Olafur Eliasson : artiste danois-islandais qui explore souvent les formes géométriques, y compris la sphère, dans des installations qui jouent avec la lumière, la perception et les phénomènes naturels. Son œuvre The Weather Project avec son immense soleil artificiel sphérique en est un exemple marquant.
- Richard Long : associé au Land Art, il utilise souvent des formes géométriques simples trouvées dans la nature, comme des cercles de pierres.
- Michel Verjux : Un artiste visuo-spatial contemporain, poète et théoricien de l’art, mentionné ici pour ses sculptures de lumière utilisant des projections minimalistes rondes pour des expériences physiques utilisant l’espace et l’architecture comme support.
- Les artistes de l’Op Art (comme Victor Vasarely) : Bien qu’ils aient exploré diverses formes géométriques, le cercle et les formes rondes étaient essentiels pour créer des illusions d’optique de mouvement et de profondeur.
- Xavier Veilhan : artiste français aux registres étendus mentionné ici essentiellement pour ses mobiles inspirés de Calder, entre équilibre et déséquilibre, dont la finalité se situe peut-être dans un processus de déstabilisation de la sculpture.
- Karina Smigla Bobinsky, artiste germano-polonaise, mentionnée ici pour son installation interactive de 2018 présentant une sphère dans une pièce vide manipulable par les visiteurs.
ARCHITECTURE :
- Antti Lovag : l’architecte des maisons bulles, précurseur de la blob architecture et de l’architecture organique.
- Cabinet d’architecture Populous Severud Associates : La sphère de Las Vegas et son ingénierie de science-fiction.
- La Blob architecture : un terme donné à un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.
Artistes dans l’Histoire :
- Sandro Botticelli : Dans sa peinture La Madone du Magnificat, la forme circulaire (du tondo, support rond) encadre la Vierge et les anges, une forme courante à la Renaissance pour les sujets religieux.
- Jérôme Bosh : La création du monde.
- Ingres : Le bain turc, autre référence célèbre de peinture peint sur un tondeauen tant que peinture ronde, en écho aux rondeurs des corps.
- Fernand Léger : Au début du 20e siècle, il a intégré des formes cylindriques et circulaires dans son travail, décomposant les objets en éléments géométriques. Son tableau Les Disques dans la ville en est un exemple.
- Robert Delaunay et Sonia Delaunay : Pionniers de l’Orphisme, un dérivé du cubisme, ils ont utilisé des disques de couleurs et des formes circulaires pour explorer la lumière et le mouvement.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres artistes seront présentés comme sources d’investigation et d’inspiration lors du commencement du workshop à la rentrée.
Annexe : La Sphère comme exploration artistique : une lecture à travers Peter Sloterdijk
Dans sa trilogie Sphères, le philosophe Peter Sloterdijk propose une réflexion profonde sur cette forme, non seulement comme objet géométrique, mais comme métaphore de l’existence humaine, de l’espace et des relations. Ses idées offrent un cadre conceptuel riche pour explorer la sphère en tant que motif, symbole et espace de création.
Sloterdijk décrit la sphère comme une structure fondamentale de l’être-ensemble : L’homme est l’animal qui vit dans des sphères qu’il produit lui-même (Bulles, 1998). Cette idée invite les artistes à envisager la sphère non pas comme un simple volume, mais comme un espace de vie, un contenant intime où se tissent des relations. Dans ce sens, vous pourrez explorer des installations sphériques, jouant avec des matériaux transparents ou opaques pour exprimer cette tension entre intériorité et extériorité.
Les sphères sont des globalisations réussies, des mondes en miniature (Globes, 1999). Cette citation peut inspirer des œuvres qui questionnent l’idée de globalité : une sphère peut-elle contenir le monde ? Les étudiants peuvent créer des microcosmes sphériques, intégrant des fragments d’images, de sons ou d’objets, pour réfléchir à l’ambition de l’art de représenter l’universel à travers une forme finie.
Enfin, dans Écumes, Sloterdijk introduit la notion de sphères multiples et interconnectées : Nous vivons dans des écumes, des agrégats de sphères qui se touchent sans se fondre (Écumes, 2004). Cette image d’écumes, où chaque sphère est à la fois autonome et liée aux autres, pourrait guider des projets collectifs. Cette idée peut également s’envisager sous une forme plastique en deux dimensions, peinture, dessin…
En somme, la sphère, chez Sloterdijk, est bien plus qu’une forme : elle est un espace philosophique, poétique et relationnel. En s’appuyant sur ces concepts, vous pourrez explorer des médiums variés (sculpture, performance, installations immersives) pour interroger la sphère comme lieu de protection, de rêve ou de tension.
Atelier de Recherche et Création - Art and the city (S.S.)
Atelier de Recherche et Création - Le Banquet (P.R. & C.B. & A.O.)
Méthode d’enseignement :
Proposer des situations autour du repas lors desquelles les étudiant·es sont invité·es à répondre systématiquement. Mise en place d’exercices réguliers et création de protocoles autour de la cuisine. Les temps de cuisson, le dressage de la table, l’assaisonnement d’un plat seront des moments pédagogiques parmi d’autres.
Objectifs du cours :
Tous les mardis, développer collectivement des temps de recherche, de discussion et de création dans le cadre d’un repas. Faire la cuisine, manger ensemble, la digestion comme expérience simultanée, la vaisselle et le rangement seront les principaux objectifs de l’ARC. Mettre en œuvre le Symposium de fin de semestre en tant que forme artistique collective.
Contenu du cours :
Tous les mardis s’organiseront autour des repas de midi, depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Les déjeuners du mardi midi feront partie de l’ARC, chacun·e ramènera des ingrédients. Nous élaborerons des repas thématiques en questionnant l’économie d’un repas, les manières de faire, l’hospitalité. Nous pratiquerons l’art de la conversation, réfléchirons au vocabulaire de la cuisine dans sa polysémie, nous pratiquerons le “toast” comme forme poétique etc. Quelle différence entre faire la cuisine dans un restaurant, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine dans une école d’art? Quelle différence entre manger au restaurant, manger chez soi, manger dans une école d’art?
Chaque séance permettra de proposer des formes et préparera la séance suivante.
L’ARC sera aussi le laboratoire de préparation du Symposium qui se tiendra dans la Grande Galerie de l’ESAD le 13 janvier. Nous adresserons des invitations à des personnes choisies, élaborerons un menu et un programme de formes, de gestes et de prises de parole.
Modalités et critères de l’évaluation :
Participation à l’ensemble des temps de l’ARC sans exception et à l’organisation du Symposium du 13 janvier.
Repères bibliographiques / références :
-Karen Blixen, Le dîner de Babette, 1961 (1ere ed. danois 1958).
-Ludovic Burel, Le laboratoire de fermentation, it: éditions, 2025.
-Sally De Kunst et al., This Book is yours. Recipes for artistic collaboration/Recettes pour la collaboration artistique, Art&Fiction publications – Vexer Verlag, 2019.
-Thien Uyen Do, Fermentation rébellion, édition des Equateurs, 2024.
-Marguerite Duras, La cuisine de Marguerite, B. Jacob, 1999.
-Claire Gausse, Louise Drulhe, Cantines de quartier : la recette du lien, éditions 369, coll. Manuels, 2018.
-Emmanuel Guillemain d’Echon, Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis. Routes, recettes et tours de main, Keribus Éditions, 2024.
-Dorothy Ianonne, A CookBook, (edition anglaise), Presses du Réel, 2019.
– Lauren Malka, Mangeuses : histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, ed. les Pérégrines, 2023.
-Gaëlle Ronsin, Ajouter un couvert pour l’anthropologue, Les éditions de l’épure, 2024.
– Niki Segnit, Le répertoire des saveurs, Marabout, 2012.
-Yoann Thommerel, Manger low cost, édition Nous, coll. Disparate, 2025.
-Alice B. Toklas, Le livre de cuisine d’Alice Toklas, (Traduction de : The Alice B. Toklas cook book), les Éd. de Minuit, 1999.
-Gabriel Axel, Le festin de Babette, 1987 (film).
-Luc Moullet, Genèse d’un repas, 1978 (film).
Atelier de Recherche et Création - Bifurcations et chants photosynthèses (E.D.F.)
Intitulé du cours : ARC : Bifurcations et chants-photosynthèses
À la suite de l’Arc « Ré-ouvrir les futurs » et « Terre-strates-récits », troisième chapitre d’un cycle d’enseignement intitulé “DES CHEMINS HYBRIDES”, Imaginer en 2050 êtres et territoires, entre Trièves et Grenoble.
Intervenant.e.s : Stéphanie Sagot et Pascal Aspe (Ferme des MillePousses). Lisa Panico et Thomas Klein, chargé.e.s de la réouverture au public du Centre horticole de Grenoble.
Méthode d’enseignement :
Dans une approche transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation dans le Trièves et le Massif du Vercors avec un travail dans les ateliers de l’ÉSAD. Nous bénéficierons d’expériences d’apprentissage et de chantier participatif avec le nouveau projet d’agriculture urbaine de Mille Pousses Grenoble, dirigé par Pascal Aspe. Nous nous rendrons dans le Trièves pour apprendre de la ferme collective Sainte-Luce et puis dans le Vercors pour un arpentage-lecture de paysage et botanique.
Nous continuerons nos échanges et séances d’apprentissage avec le Centre Horticole de la ville de Grenoble, avec lequel est un partenariat est noué.
Un atelier est également prévu avec Stéphanie Sagot, artiste qui explore depuis vingt ans les liens entre environnement, agriculture et alimentation. Chaque étudiant.e travaillera à partir d’un projet personnel. Nous rencontrerons au début de l’anéée l’artiste baniwa et brésilien Denilson Baniwa, qui nous présentera certains de ses travaux en lien avec le végétal.
Durant le semestre, des journées de réflexion et d’échanges seront également co-organisées avec les ARC et les IR de la mention Territoire et Société. Ainsi une rencontre et un temps d’échange est prévue avec l’ARC de Slimane Raïs intitulé « L’Air de rien… ».
Objectifs / contenu du cours :
En menant des recherches sur les spécificités historiques, environnementales et sociales du territoire entre le Trièves et la métropole Grenobloise articulant espaces urbains, ruraux et montagneux, il s’agira d’imaginer à travers objets et fictions futuristes, les liens pouvant se développer entre sculpture, installation, outil agricole et leurs lieux d’activation : l’exposition, le champ et les espaces de collectes et récoltes.
Pour la troisième édition de cet ARC, nous plongerons, en compagnie des intervenant.e.s et partenaires de ce cycles, dans des visions futuristes de possibles hybridations entre plantes et humains. Partant des écrits de Lynn Margulis et Dorion Sagan au sujet de l’apparition de l’Homo photosyntheticus, nous réfléchirons aux multiples scénarios extraordinaires que l’évolution des espèces permet.
Ces recherches nous demanderont une attention aux différentes échelles composant nos mondes. Comment appréhender les points de vue d’un insecte, d’une plante, d’un micro-organisme, d’un oiseau, d’un humain, d’une forêt, d’une montagne, ou d’une bio-région, et quelles manières peut-on hybrider, mettre en commun, et mettre en scène ces différentes corporéités ?
À partir d’une sensibilisation à ces différentes échelles, de quelle manière pouvons-nous penser et raconter les mouvements, les interactions et les migrations des êtres humains et végétaux à des horizons futurs ? Dans le contexte du Trièves et de la métropole de Grenoble, quelles alliances, quels récits, quelles hybridités possibles ?
Ainsi, en apprenant de la botanique et de l’ethnobotanique, en s’inspirant des recherches scientifiques sur l’évolution futur du climat et de l’environnement, sur l’évolution des sciences du vivant, en apprenant de la littérature des imaginaires (ou « science-fiction ») et des multiples formes de l’agriculture et de production de nourriture, nous imaginerons de possibles hybridations entre formes artistiques, agricoles et écologiques.
Dans une conjoncture, où le présentisme, les visions progressistes, spéculatives, ségrégationnistes et productivistes fragilisent fortement des modes de vies à l’échelle locale comme planétaire, il est crucial de ré-ouvrir les futurs et envisager une multitude de possibilités pour un avenir durable et symbiotique, construit d’interactions multiples, d’échanges entre différences, et d’espace de communs.
À l’horizon 2050, quels objets et quelles formes, quelles transformations du territoire, quelles représentations ou expressions peuvent engendrer de telles collaborations ?
À partir de méthodes transdisciplinaire, et à travers ce dialogue entre arts, agricultures et sciences, comment imaginer dans ces futurs des interactions entre un lieu et un territoire (un éco-système, un jardin, un champ, un quartier, une rivière, une intervention artistique in-situ), des objets (œuvres, outil et instrument) et des représentations (récit, narration, mise en scène) ?
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre, capacité à présenter et échanger à l’oral. Présence, assiduité et participation, assiduité, dialogue.
Repères bibliographiques / références :
L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021.
Karen Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, 2023
Emma Bigé, Clovis Maillet, Écotransféminismes, Pour des écologies transféministes, 2025
Octavia Butler, Parabole du Semeur, 1993.
Terres et liberté : Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, 2025
Patrick Chamoiseau, Les Neuf consciences du Malfini, 2009
Julie Crenn et Lauriane Gricourt, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024
Tj Demos, Radical Futurisms -Ecologies of Collapse/Chronopolitics/Justice to Come, 2023.
Donna J. Haraway Camille Stories, dans Vivre avec le Trouble, 2016.
Lynn Margulis, Dorion Sagan, L’univers bactériel, 1986
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées, 2013.
Ursula K. Le Guin, La Vallée de l’éternel retour, 1985.
Sébastien Marot, Taking the country’s side. Agriculture and architecture, 2019
William Morris, Nouvelles de Nulle Part, 1890.
Vandana Shiva, Jacques Caplat et André Leu, Une agriculture qui répare la planète, Les promesses de l’agriculture biologique régénérative, Actes Sud, 2021.
Œuvres et travail de : Atelier Paysan, Inland, Agence Coloco & Gilles Clément, FutureFarmers, Asunción Molinos Gordo, William Morris, Marjetica Potrc, Elisa Strinna, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Åsa Sonjasdotter, Otolith Group, Natsuko Uchino.
Atelier de Recherche et Création - L'air de rien (S.R.)
“La partie importante de l’œuvre était que je retournais simplement le gaz qui avait été enlevé de l’atmosphère, gardé dans un récipient dans un certain volume mesurable, et aurait donc été utilisé commercialement.. De cette façon, se crée un cycle. » Robert Barry 1966
Objectifs du cours :
Dans cet ARC nous nous intéresserons aux éléments naturels et leurs interactions avec la création artistique. Comment depuis des siècles les artistes exploitent dans leurs œuvres les éléments naturels, non seulement comme sujet ou motif, mais aussi, comme matériaux, outils ou comme espace dans lequel s’articulent des formes.
Il est également question de l’air et de l’art. Le premier est l’incarnation de l’invisible, le second, le sacro-saint du regard. Ceci pourrait sembler paradoxal et pourtant ! Bien qu’il puise son langage dans le visible et le tangible, dans un monde où la visibilité est devenu un enjeu majeur de l’existence, la fonction essentielle de l’art ne serait-elle pas de figurer l’invisible ?
De Botticelli a Otoniel, passant par Duchamp, Morris, Barry ou encore Messager, l’art prend parfois de bonnes inspirations pour donner a voir « cela qui ne peut être peint »*.
Plusieurs intervenants, théoriciens et plasticiens, viendront partager leurs expériences et réflexions sur ces questions. Ainsi, nous accueillerons Thierry Davila, historien de l’art, conservateur de musée et commissaire d’expositions, pour une conférence d’ouverture intitulée De l’air.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu
. Exposition des travaux en fin d’ARC (lieu encore à définir)
. Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
. Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)
. Présentation des travaux, mise en espace.
. Qualité des réalisations.
. Relation de travail, présence en cours, engagement.
. Entretien 20 minutes avec l’étudiant lors du bilan. Notation /20
Repères bibliographiques / références :
- De l’inframince – Brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Thierry Davila. Editions du Regard. 2019
- Littératures et arts du vide, Sous la direction de Jérôme Duwa et Pierre Taminiaux Édition : Hermann. 2018
- La puissance créatrice du souffle, Maurice Fréchuret Edition: Les presses du réel. 2024
- Inclusions, esthétique du captitalocène, Nicolas BourriaudEdition : Puf, Perspectives critiques. 2021
- L’art a l’état gazeux, Yves Michaux Edition : Stock. 2003
Atelier Pratique - Blender's Abstract Vibe (B.J.)
Méthode d’enseignement :
Travail sur le logiciel Blender et sur son interopérabilité avec les logiciels de montage Final Cut Pro et Da vinci Resolve. Cela signifie que ces autres logiciels sont également pris en compte dans l’enseignement.
Objectifs du cours :
Apprendre à créer des formes abstraites dans Blender, configurer des matériaux avec la transparence alpha et exporter des séquences d’images avec le canal alpha pour une utilisation composite dans des logiciels de montage (Final Cut Pro, Da vinci Resolve ou Gimp pour des travaux statiques). Cela pourra également donner lieu à quelques aperçus de la fonction tracking de Blender.
Contenu du cours :
Apprentissage des principes de production 3D dans Blender et compréhension de l’écosystème d’image à partir de la couche Alpha et des jeux de transparences. Concepts clés : modélisation, texturage, UV mapping, animation, montage, compositing, rendu.
Modalités et critères de l’évaluation :
Sera évalué la qualité du travail, la concentration de l’étudiant sur son projet, son degré de participation au cours lors des échanges. La présence en cours est un élément clé de l’évaluation.
Repères bibliographiques / références :
Simulacre et simulation (Jean Baudrillard)
Eloge de la simulation (Philippe Quéau)
Atelier Pratique - Brico Musique (F.N.)
Méthode d’enseignement :
La philosophe théoricienne Agnès Gayraud, dans son essai Dialectique de la pop, défini la musique pop comme étant : ”les musiques populaires enregistrées” et, par extension, diffusées et distribuées. En s’appropriant cette idée et en inscrivant le procédé de fabrication au centre de la réflexion, BRICO MUSIQUE envisage la création musicale comme un pratique accessible, joyeuse, et performative. Avec l’économie de moyens comme moteur de formes singulières, et expressives.
Objectifs du cours :
– Comment s’approprier l’outil informatique pour composer de la musique ?
– La musique pop a-t-elle des limites ?
– Comment performer la musique pop en live ?
– L’économie de moyens comme vecteur d’émancipation
– Comment prendre du recul face à la dichotomie art et industrie, inhérente à la musique pop ?
Contenu du cours :
BRICO MUSIQUE est un cycle pédagogique mené à l’ESAD Grenoble depuis trois saisons, s’articulant autour d’ateliers, de workshops, d’interventions.
Son objectif est de pratiquer et fabriquer de la musique pop contemporaine, tel une matière à détourner, à déconstruire, à rejouer. Il s’agit d’en faire un terrain d’expérimentations et un objet esthétique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continue
Repères bibliographiques / références :
Le workshop en partenariat avec Le CIEL s’attachera quant à lui, à poursuivre sa lancée et pousser plus loin les gestes performatifs et collaboratifs en live. Il sera aussi question d’investiguer sur la capacité de déconstruction et de réinvention de la musique pop en live, qui en font un objet plastique à part.
Vous trouverez sur via lien une playlist des films documentant les différents workshops BRICO MUSIQUE au CIEL depuis 2024 : https://urlr.me/75MFet
Atelier Pratique - Edit (A.O.)
Méthode d’enseignement :
Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l’embaussage à froid, le gaufrage, et d’autres techniques encore inexplorées. Mise en commun de savoir-faire technique.
Partage de données.
Objectifs du cours :
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession et de rythme. Comment le support papier, les doubles pages et leurs successions peuvent rendre compte des intentions ? Mettre en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Contenu du cours :
Un atelier
Qui part d’un besoin d’édition
Qui explore les éditions d’artistes
Qui propose des micro-expositions
Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Il s’agit d’effectuer un travail de mise en page, de mise en relation, de penser plastiquement le format et le rythme de succession des pages. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence et participation.
Repères bibliographiques / références :
Le travail d’atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentes à la bibliothèque et dans d’autres lieux de ressources.
Atelier Pratique - Fabrique de l'image (C.T.)
Méthode d’enseignement :
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation et d’apprentissage, d’accompagnement, de production, permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.
Objectifs du cours :
À travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement…
Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC, finition/présentation).
Contenu du cours :
Il est proposé aux étudiants d’engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.
Au cours des deux première séances d’Octobre, l’appropriation des nouveaux espace du labo photo et l’exploration du medium se feront à travers une expérimentation collective de la photo-sensibilté alliant papier et film.
Ces productions seront présentées en novembre dans une exposition inaugurale des espaces du Pôle Image.
Plus globalement, les travaux seront conduits autant en prise de vue, que ce soit en extérieur ou en studio (film argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique…).
Les étudiants viendront à l’atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d’en faire l’inventaire et d’en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt de l’ESAD. Les consommables photographiques (films, papiers et chimies) seront fournis pour les travaux en AP.
Modalités et critères de l’évaluation :
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme à déterminer : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan.
Repères bibliographiques / références :
LLANG Thomas. https://www.thomaslang.fr/gestalt
MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d’une ville 1987-89.
SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
GENESTE Guillaume: Le tirage à mains nues. Edité par La main donne 2020.
À emprunter à La Bibliothèque d’étude et du patrimoine. Fonds moderne SL 771 GEN
Emission Par les temps qui courent ( France Culture 20/10/2020 durée : 00:44:56 ) – par : Marie Richeux, Jeanne Aléos, Romain de Becdelievre – nous recevons le tireur et photographe Guillaume Geneste. Avec lui nous discutons de son travail en laboratoire, de l’émotion devant une planche contact et de son ami Denis Roche. – réalisation : Jean- Christophe Francis, Lise-Marie Barré – invités : Guillaume Geneste Qui réalise des tirages de grands photographes https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-jeudi-22-octobre-2020
DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009. http://www.michelcampeauphotographies.com/
WOLFF Ilan « Camera Obscura at work » 1982-1997 et http://www.ilanwolff.com/
https://www.culture.gouv.fr/fr/espacedocumentation/bases-de-donnees/Fiches-bases-de-donnees/arago-le-portail-de-la-photographie Musée en ligne de la photographie permettant d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en France.
Exposition de Pascal Sarrazin à l’Espace Nelson Mandela de Fontaine jusqu’au 11 octobre 2025.
Journées de la photographie de la Maison de l’Image, les 8 et 9 novembre 2025 à l’Ancien Musée Bibliothèque, place de Verdun (https://www.maison-image.fr).
Atelier Pratique - L'eau ça coule et ça mouille (S.R.)
Atelier Pratique - Quels matériaux pour représenter les futurs ? (E.D.F.)
Méthode d’enseignement :
Chaque étudiant·e travaillera à partir d’un projet personnel. Dans une approche résolument transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation à partir de différentes visites dans un ou plusieurs sites de la métropole de Grenoble : entreprises et associations travaillant sur de matériaux recyclées, durables et écologiques comme l’association G-Recip, le département CraTerre (école d’architecture), la Design Factory de l’Université Grenoble-Alpes, MTK et autres lieux à confirmer.
Nous serons également en dialogue régulier avec Giulia Bellinetti (coordinatrice du Nature Research department et du laboratoire Future Materials Lab à la Jan Van Eyck Academy).
Objectifs et contenu du cours :
Dans les contextes environnementaux et sociaux que nous connaissons, il est indispensable d’engager une réflexion sur les matériaux utilisés, et de favoriser les circuits les plus courts et les plus éthiques mais aussi le réemploi ou le recyclage. Quelle vie des œuvres, quels devenirs des œuvres ? Comment prendre en compte le caractère éphémère ou en évolution d’un matériau. Quelle relation entre pérennité et transformation d’une œuvre ?
Dans le contexte de la réouverture de l’école sur le site de Lesdiguières, on s’interrogera sur les lieux dont les ateliers se fournissent en matériaux, et sur les conditions de création d’une récupérathèque. On continuera un travail de cartographie des ressources à l’échelle de la métropole de Grenoble et de son territoire environnant.
Par cette attention, il ne s’agit pas de limiter la créativité, mais au contraire de repartir d’une réflexion systémique sur les matières, leurs contextes d’origine et d’extraction pour déployer les imaginaires.
Bois, métaux, minéraux, matériaux de synthèse, chimiques, numériques, électroniques…nous ferons un tour d’horizon afin que chacun/chacun se saisisse de matières choisies, et réalise son projet personnel.
À partir de cette relation tissée à un ou plusieurs matériaux, il s’agira pour chaque étudiant·e. de penser un projet personnel dont le sujet sera la représentation de la métropole de Grenoble et de la région du Trièves dans un futur proche et lointain : 2050.
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre
Repères bibliographiques / références :
Future Materials Banks, Jan Van Eyck Académie, https://www.janvaneyck.nl/postacademy/future-materialshttps://www.futurematerialsbank.com/
Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental, ouvrage collectif sous la direction de Elio Della Noce et Lucas Murari, 2022
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Œuvres et travail de : Marjetica Potrc, Richard Long, Superflex, Joseph Beuys, Matthew Barney, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Giuseppe Penonne, Pierre Huyghe.
Atelier Pratique - Module curatorial (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Atelier pratique. Rendez-vous en groupe, conception, organisation et suivi des projets pris en charge par l’AP.
Objectifs du cours :
Ce module, ouvert à une quinzaine d’étudiant·es par semestre, propose une approche à l’échelle un de la pratique de l’exposition. De manière à apprendre à concevoir et mettre sur pied un projet d’exposition.
Cette année, il sera proposé aux étudiant·es de prendre part à deux projets, un pendant le semestre et l’autre au printemps, en lien avec des partenaires :
-l’événement Petites formes performatives, avec deux performances de Candice Burnet et Amar Ruiz, à l’automne, au Centre d’art Bastille
-l’exposition photographique dédiée aux représentation de l’habiter et de l’environnement pendant et après les confinements de 2020 dus à la pandémie de Cvid-19, en mars, à la galerie de l’école ou à la galerie Xavier Jouvin et dans les bibliothèques du campus ; avec le Master Pro Histoire de l’art de l’UGA
Ces projets permettront de mieux comprendre les enjeux conceptuels à l’origine d’un projet d’exposition, tout comme les enjeux logistiques, le transport d’œuvres, l’accrochage, la maintenance, la surveillance d’exposition, etc.
D’autres projets, amenés par les étudiant·es comme d’autres partenaires pourront être développés dans ce cadre.
Contenu du cours :
Le module curatorial repose sur l’expérience pratique, les étudiant·es seront en charge des projets réalisés où la prise de décision, le dialogue avec les personnels administratifs et techniques de l’école et les partenaires extérieurs de l’école seront au cœur de l’expérience collective. Cela permettra de comprendre les différentes étapes et enjeux d’un projet de monstration. Le but est de permettre aux étudiant·es d’acquérir les outils conceptuels et pratiques permettant à terme de construire des projets en toute autonomie et de commencer à construire un réseau artistique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, évaluation sur la présence, la participation aux temps collectifs et sur l’implication dans les projets.
Repères bibliographiques / références :
Atelier Pratique - Moulage (J.S.P.)
Méthode d’enseignement :
Atelier
Objectifs du cours :
Découvrir et se familiariser avec certaines techniques du moulage.
Contenu du cours :
Expérimenter le moulage d’objets simples, de partie du corps avec divers matériaux (en fonction des commandes et stocks disponibles) : Plâtre, argile, béton, alginate, silicone, résine, latex, etc.
Calendrier :
1- Jeudi 9 octobre 14-18
2- Jeudi 6 novembre 14-18
3- Jeudi 20 novembre 14-18
4- Jeudi 4 décembre 14-18
5- Jeudi 18 décembre 14-18
6- Jeudi 15 janvier 2026 14-18
7- Jeudi 29 janvier 2026 14-18
Modalités et critères de l’évaluation :
Présences régulière des étudiant·es.
Concevoir un projet final issu des différentes expériences du moulage.
Repères bibliographiques / références :
Une partie du matériel sera fourni par l’école. Pour des projets plus spécifiques, l’étudiant·e se fournira par ses propres moyens.
Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Cours théoriques à l’ÉSAD et ateliers à l’extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.
Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l’acte photographique. Nous essaierons d’interroger la photographie dans son essentialité, c’est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.
Objectifs du cours :
« Je ne fais pas la photo d’un paysage, je fais une photo d’un paysage. » Eric Hurtado
Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d’une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l’invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfuie, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.
Trouver un chemin dans les herbes, c’est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d’une éclaircie de notre existence au monde.
Contenu du cours :
Comment la photographie nous permet le passage de l’acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d’une vision.
L’enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre « prendre une photo » et « accueillir une image », dépasser le sujet pour sa question.
Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues (argentique ou numérique), à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimenterons lors d’ateliers pratiques, à l’ESAD comme lors de sorties en extérieur.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Livres
Raymond Depardon, Errance. Points / Seuil
Luc Delahaye, L’autre,Phaidon
Winterreise, Phaïdon
Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl
Lewis Baltz, Texts, Steidl
Garry Winogrand, Catalogue Jeu de Paume, Flammarion
Henri Cartier-Bresson, L’instant décisif, in L’imaginaire d’après nature, Fata Morgana
Voir est un tout, Centre Pompidou
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Rodtchenko photographe, Parenthèses
Bernard Plossu, Revue Lisières, 21
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Le point aveugle, Musée Hébert
Films
Raymond Depardon, Journal de France
Michelangelo Antonioni, Blow-up
Wim Wenders, Palermo shooting
Le sel de la terre
Sasha Waters Freyer, Garry Winogrand
Laurent Roth, Les yeux brûlés
Manoel de Oliveira, L’étrange affaire Angélica
Jean-Luc Godard, Je vous salue Saravejo
Film socialisme
Gilad Baram, Koudelka shooting holy land
Atelier Pratique - Si je ne peux pas danser... (K.S. & S.F.)
Méthode d’enseignement :
- Résidence de recherche de 6 jours à Centrale Fies – Centre de Recherche sur les Pratiques Performatives Contemporaines et workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (Octobre 2025)
- Organisation et suivi curatorial de la résidence de recherche de l’artiste Ru Kim (Novembre 2025) à Grenoble et participation en tant que performeur.euses à son projet pour le Festival des Gestes de la Recherche (Décembre 2025)
- Rendez-vous hebdomadaires.
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Contenu du cours :
L’atelier pratique « …si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution » est lié à l’unité de recherche “Hospitalité artistique et activisme visuel” (Simone Frangi et Katia Schneller) et à la mention “Holobionte. Pratiques visuelles, exposition, et nouvelles écologies de l’art”. Il est également mené en collaboration avec Melis Tezkan et son ARC lié à la seconde année du programme de recherche “What’s love got to do with it ?” soutenu par le Ministère de la Culture.
Intitulé d’après une affirmation historiquement attribuée à la militante anarchiste Emma Goldman, qui qualifiait la danse ainsi que la joie et le plaisir d’outils révolutionnaires dignes et efficaces, l’AP envisage la performance multimédia et la musique (au sens de production sonore élargie) comme des plateformes militantes puissantes. La collaboration entre S. Frangi, K. Schneller et M. Tezkan construit un parcours pédagogique structuré et centré sur les pratiques critiques joyeuses, exubérantes et non moralistes qui croisent l’expérience performative avec des questions militantes dans l’espace de lutte de la dissidence de genre, de l’anti-colonialisme, de l’anti-capitalisme et de l’écologie.
L’ARC de Melis Tezkan – développé en collaboration avec cet AP – donnera lieu également au cours du premier semestre à des workshops avec différent.es invité.es qui travaillent dans ce sens en lien avec le programme de recherche “What’s love got to do with it ?”. Les participant.es à l’AP qui auront assisté à la résidence à Centrale Fies prendront en charge quelques séances de restitution et de transmission des expériences menées en Italie.
Résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies (https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture de ce parcours du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025. L’idée de ce voyage est de faire une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel italien pour suivre un workshop. Situé dans une ancienne centrale hydroélectrique près de la ville de Trento dans le nord de l’Italie (https://www.centralefies.it/building/), Centrale Fies organise un festival de performance depuis plus de 45 ans, et récemment devenue partenaire institutionnel d’écoles supérieures européennes centrées autour de la performance comme le Dutch Art Institute d’Amsterdam/Arnhem et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence sera tout d’abord l’occasion de se former aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) en travaillant avec le technicien de Centrale Fies.
Un workshop y sera organisé avec l’artiste invité Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), artiste basé.e à Amsterdam, aux Pays-Bas, dont la pratique queer croise la performance et la musique. Le travail du Publik Universal Frxnd porte sur l’interaction entre les formes visuelles de représentation/abstraction et les formes politiques de reconnaissance et de marginalisation. En mettant l’accent sur les pratiques folkloriques et les histoires locales, son travail le plus récent explore les sentiments de deuil et de perte à travers une perspective critique de l’héritage nécropolitique du colonialisme sur les travailleur.euses. Son travail s’intéresse à la manière dont l’industrialisation a permis à notre interaction avec les machines de façonner nos vies et nos expressions culturelles. Le Frxnd fait référence à un personnage historique. Un.e hérétique, un charlatan.e, une contradiction dans les termes, le Frxnd est l’énonciation d’un pouvoir ou d’un esprit supérieur et n’a pas de sexe malgré la forme de son vaisseau terrestre. Iel est et a peut-être toujours été un instrument permettant d’aller au-delà de l’imagination et de la perspective limitées de la position spécifique d’un sujet. Le Publik Universal Frxnd est un mouvement dans le temps vers une défaite du moi. Vous trouverez des informations sur sa pratique sur son site.
Participer à la performance de Ru Kim : Au cours du mois de novembre, l’artiste coréen·ne Ru Kim fera une résidence de recherche à l’ESAD. Iel donnera un workshop (13-14/11 et 20-21/11) dans le but d’élaborer une performance avec les participant.es de l’AP qui sera présentée lors du Festival des Gestes de la Recherche (2-4 décembre 2025).
Dans sa pratique, Ru Kim associe la performance et le texte à des installations vidéo et sonores. Ses projets questionnent la résistance et la réappropriation des perpétuations de la violence générées par les idéologies patriarcales, impériales et coloniales de la domination. Ils cherchent à développer des formes qui remettent en question les binaires et les identités figées.
S’appuyant sur sa propre fluidité linguistique, culturelle et identitaire, Ru Kim se nourrit des théories féministes hydro-, noires et queer pour mener des analyses déconstructivistes des représentations oppressives, racistes et coloniales. Ses projets récents se concentrent particulièrement sur les histoires racontées depuis le point de vue du témoin plus qu’humain, les stratégies de l’eau abordées dans une perspective hydroféministe, la documentation de la queerness dans l’histoire coréenne, et les archives révélant la construction « asiatique » promulguée par le regard occidental.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet et rendu d’un document écrit.
Repères bibliographiques / références :
Projet personnel
UE3 Langue étrangère
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B.V.)
Méthode d’enseignement
Cours en groupe, rendez-vous individuel
Objectifs du cours
Travail préparatoire au Travel Book demandé au semestre 8
Contenu du cours
- La biographie (savoir se présenter face à un.e interlocuteur.rice étranger.e).
- La question des artistes explorateurs- exploratrices, voyageurs-voyageuses et nomades aujourd’hui – présentation d’artistes à l’oral avec parcours en anglais au Musée de Grenoble.
- Travail sur différentes formes d’écriture.
Modalités et critères de l’évaluation
Contrôle continu, assiduité et participation requises
Expression écrite, expression orale, production écrite, production orale pour en savoir plus sur les différents types d’exercices à l’oral, se référer à la fiche générale intitulée « Communication orale – 1A à 5A »
Repères bibliographiques / références
Crossing Africa in a Corset: The Female Explorers who Changed the World Forever, Hazel Plush, 2017 (telegraph.co.uk)
Haiku, Jack Kerouac, 1956-> 1959
Free Creative Prompts: Travel (build-creative-writing-ideas.com)
DISPLACEMENTS: Uncertain Journeys (displacementjourneys.org)
Musée de Grenoble : parcours en anglais avec médiatrice sur les thèmes du voyage et du déplacement.
outils en ligne, support papier, en lien avec la Bibliothèque de l’ESAD : sites internet, réseaux sociaux : résidences, musées, galeries, artistes… dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
Grille d'évaluations Art 4 - Semestre 8 :
UE1 Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
Mémoire
Contenu du programme
Utilisation « intelligente » des outils numériques tels que Chat GPT, Google, Deepl
Présentation croisée des étudiant·e·s à travers leur travail
Établir une liste de mots-clés
Révision du vocabulaire à travers des séances de brainstorming
Écriture d’un court texte sur le travail d’un·e pair à partir de mots-clés attribués
Échange et analyse de textes (bons et mauvais exemples de lettres et CV)
Constitution d’un lexique personnel lié à la présentation de soi et de ses projets
Élaboration et révision de son personal statement à l’aide d’outils numériques (ex. : ChatGPT)
Analyse collective d’un bon et mauvais exemple d’écrit
Comparaison des CV français et anglophones à partir de documents-types
Recherches documentaires
Étude de projets de mobilité réalisés les années précédentes
Préparation des portfolios numériques
Travail individuel sur les CV et les lettres de motivation, accompagné de retours personnalisés
Modalités et critères de l’évaluation :
Assiduité – Présence
Participation – Progrès
Rendus en fin de semestre –
C.V.
Artist’s Statement
Portfolio
Repères bibliographiques / références
International Mobility Applications – Années précedentes
Séminaire - présentation "retour de mobilité"
UE2 Projet plastique – prospective, méthodologie, production
Mobilité
UE3 Langue étrangère
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B.V.)
Méthode d’enseignement :
Suivi individuel en distanciel
Objectifs du cours :
Lors de ce semestre «hors les murs», production du Travel Book qui participera au séminaire/ àl’exposition de retour de mobilité.
Contenu du cours :
Echanges et retours réguliers concernant la maquette, le contenu textes, images, sons, vidéos… qui composeront le Travel Book.
Modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu via des points réguliers individuels en distanciel
Repères bibliographiques / références :
outils en ligne, documentation diverses, ici et ailleurs :
sites internet, réseaux sociaux : résidences, musées, galeries, artistes…
dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com, Reverso Context, Wordreference.com
ANNÉE 5 - option Art
L’organisation de l’année 5 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.
À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.
Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d’espaces d’échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d’interrogations plus larges.Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant-e-s au sein des Arc et workshops proposés. Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et les Workshops proposés aux étudiants des années 2 à 5.Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun-e doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l’être dans un module différent), et s’y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l’examen du semestre 9.
L’organisation du semestre 10 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaire pour revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d’y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée.
À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.
Liste des unités d'enseignements
Semestre 9 :
UE1 : Méthodologie de la recherche, dont suivi de mémoire – 20 ECTS
UE2 : Mise en forme du projet personnel – 10 ECTS
Semestre 10 :
UE1 : Épreuves du diplôme – 30 ECTS
Grille d'évaluations Art 5 - Semestre 9 :
UE1 Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)
Méthodologie de la recherche plastique
Suivi du mémoire
Initiation à la recherche - Home is a gut feeling (K.S. et S.F.)
Méthode d’enseignement :
Séances d’écoute et de lecture; workshops; accompagnement à la création d’un programme sonore curaté, rendez-vous hebdomadaires.
Objectifs du cours :
- Initiation théorique aux notions de politiques de l’écoute et aux approches décoloniales des pratiques sonores
- Production d’un programme sonore pour le Festival des Gestes de la Recherche
- Organisation et suivi curatorial du Festival des Gestes de la Recherche
- Organisation et participation au premier volet de la 6ème édition du Festival des Gestes de la Recherche (2-4 décembre 2025) consacré à l’axe “Pour en finir avec la Terra Nullius” et portant sur les relations entre histoire coloniale, colonialité, écologie et son.
Contenu du cours :
Inspiré par la lecture de l’ouvrage Hungry Listening: Resonant Theory for Indigenous Sound Studies du chercheur autochtone Dylan Robinson, cette initiation à la recherche s’intéresse à la relation entre pratiques sonores, politiques de l’écoute et colonialité dans les créations artistiques contemporaines. Dylan Robinson affirme que les pratiques décoloniales d’écoute doivent émerger d’une prise de conscience croissante de notre positionnalité en matière d’écoute. Selon lui, cela implique d’identifier les habitudes de perception coloniale des colons et de lutter contre la « surdité » du colonialisme qui réduit au silence les fondements épistémiques des sons autochtones.
Grâce à la collaboration de deux artistes sonores de renommée internationale invité.es à donner deux workshops à l’ESAD et à des séances d’écoute et de lecture collective, cette IR propose une immersion dans des pratiques d’écoute situées pour apprendre à identifier la colonialité résiduelle présente dans les sens.
Les participant.es seront également invité.es à construire collaborativement une séance d’écoute pour le Festival des Geste de la Recherche (Décembre 2025) ainsi que de se charger du suivi curatorial de cette édition du Festival consacrée notamment aux relations entre histoire coloniale et son.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, rendu de projet
Repères bibliographiques / références :
- Ronald Radano – Tejumola Olaniyan (éds.), Audible empire, Music, Global Politics, Critique, Durham, Duke University Press, 2016.
- Dylan Robinson, Hungry Listening: Resonant Theory for Indigenous Sound Studies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2020.
CALENDRIER ACTIVITÉS UdR 2025-2026 Schneller-Frangi
– 06.10.2025 – 11.05.2025: Résidence à Centrale Fies (AP)
– 08.10.2025: Conférence en ligne depuis Centrale Fies avec Publik Universal Frxnd (AP – Mention “Holobionte”) – Conflit avec la conférence de Fabrice Nesta
– 22.10.2025 – 24.10-2025: Workshop (IR – Holobionte) avec Joe Namy (à confirmer)
– 22.10.2025: Conférence Joe Namy (IR – Mention “Holobionte”) Conflit avec Champ Libre
– 05.11.2025 : Conférence de Ru Kim (AP – Mention “Holobionte”) (Auditorium de l’ESAD) 17h-19h – Conflit avec la conférence de Fabrice Nesta
– 06.11.2025: Séance de Ru Kim avec étudiant.es (AP – Mention “Holobionte”)
– 13.11.2025 – 14.11.2025: Workshop Ru Kim avec étudiant.es (AP – Mention “Holobionte”)
– 20.11.2025 – 21.11.2025: Workshop Ru Kim avec étudiant.es (AP – Mention “Holobionte”)
– 02.11.2025 – 05.12.2025: FESTIVAL DES GESTES DE LA RECHERCHE Conflit avec la conférence de Fabrice Nesta le 03.12.2025
– 18.12.2025 – 19.12.2025: Workshop (IR – Holobionte) avec Vintage Arab (à confirmer)
– 18.12.2025: Conférence Holobionte de Vintage Arab (à confirmer)
– 10.03.2026 – 13.03.2026: FESTIVAL DES GESTES DE LA RECHERCHE Conflit avec la conférence de Fabrice Nesta le 11.03.2026
– 04.02.2026: Conférence Holobionte Michaela Alessandrini
– 16.03.2026 – 20.03.2026: ARWE à Turin?
Initiation à la recherche - Nourritures et convivialité (P.R. et C.B.)
Méthode d’enseignement :
Cours théoriques et historiques collectifs, ateliers pratiques et rendez-vous individuels.
Objectifs du cours :
Ce cours a pour objectif d’accompagner les étudiant·es sur la dimension visuelle et/ou iconographique de leur travail, notamment dans le cadre du mémoire. Il s’agit de s’intéresser non seulement à la place tangible prise par les images dans ce travail, mais aussi dans la façon dont méthodologiquement, le visuel participe à la construction de nos systèmes de pensée. Chacun·e sera amené à se constituer en observateur·ice, lecteur·ice, opérateur·ice critique d’images, d’objets, de formes à partir desquels iels doivent construire un point de vue singulier et affirmé.
Contenu : Partant du postulat qu’une image n’existe jamais seule, nous travaillerons sur les « ensembles » d’images et sur les formes diverses qu’ils peuvent prendre : collections, atlas, flux, constellations, collages, montages, murs ou livres d’images, etc. Nous nous questionnerons sur les pratiques d’artistes, de designeur·euses graphiques, d’historien·nes, de chercheur·euses de multiples disciplines pour aborder les différentes méthodologies employées pour archiver, inventorier, classifier et reproduire les images. Nous observerons ce que les images produisent entre elles lorsqu’elles sont plusieurs, et apprendrons à les regarder, à les analyser, à parler et à écrire à partir d’elles.
Modalités et critères d’évaluation Les critères d’évaluation seront l’assiduité, l’engagement dans le travail, la participation active au cours des séances, mais aussi le déploiement du travail personnel de chacun·e.
Références indicatives
BENJAMIN, Walter, L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, Paris, Allia, 2010.
BOIDY, Maxime, Les études visuelles, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 2019.
CHABERT, Garance et MOLE, Aurélien, Les Artistes iconographes, Paris, Annemasse, Empire books, Villa du Parc, Centre d’art contemporain, 2018.
DIDI-HUBERMAN, Georges, Atlas ou le gai savoir inquiet, L’œil de l’histoire 3, Paris, Minuit, 2011. —, Tables de montage. Regarder, recueillir, raconter, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Éditions de l’IMEC, 2023
GIANNECCHINI, Hélène, Voir de ses propres yeux, Paris, Seuil, 2021.
HAMON, Philippe, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris, José Corti, 2001. REVERSEAU, Anne et al., Murs d’images d’écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle), Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2022.
THÜLERMANN, Felix, More than One Picture: An Art History of the Hyperimage, translated by Elisabeth Tucker, Los Angeles, Getty Publications, 2019. WARBURG, Aby, L’Atlas Mnémosyne, Paris, L’écarquillé, 2012.
Initiation à la recherche - Cinématographie de la mémoire (UGA)
Initiation à la recherche - Cinéma et philosophie (UGA)
Anglais - Théorie des arts et communication orale (B.V.)
Professionnalisation / Champ libre (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Séminaire d’accompagnement à l’après-école à destination des étudiant·es de 3A, 4A, 5A. Mise en question des enjeux de professionnalisation.
Interventions d’acteur·ices des mondes de l’art (artistes, commissaires d’exposition, juristes, etc.).
Chaque séance est préparée collectivement via un document partagé par les étudiant·es ; les échanges avec les intervenant·es sont ainsi pris en charge par les participant·es.
Objectifs du cours :
Préparer à l’après-école par des retours d’expériences et des séances d’information et/ou d’ateliers pratiques.
Contenu du cours :
Au 1er semestre : cycle de 4 séances de rencontres avec des artistes, enseignantes de l’ESAD-G, diplômé·es de l’ESAD-Grenoble ou d’ailleurs, en résidence à Grenoble et environs, un mercredi par mois (en octobre, novembre, décembre, janvier).
Au 2nd semestre : séances thématiques à propos du statut (artiste-auteur, micro-entreprise, association), de la communication de la pratique (portfolio et site web) et de la résidence artistique (résidence mission, résidence de recherche), etc.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Préparation de chaque séance par des recherches.
- Préparation collective d’une série de questions à destination des intervenant·es.
- Présence et participation active dans les échanges lors de la rencontre.
Repères bibliographiques / références :
UE2 Mise en forme du projet personnel
Atelier de Recherche et Création - Documenter le Monde (F.N.)
Atelier de Recherche et Création - Playlist Remix (M.T.)
Méthode d’enseignement :
Recherches individuelles et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, séances d’écoutes, séances de lectures, production d’objets rendant compte de la recherche, exercices de courte et de longue durée, présentation publique.
Avec également :
Une résidence de recherche de 6 jours avec 6 étudiant·es de l’ARC à Centrale Fies – Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, avec un workshop animé par l’artiste Publik Universal Frxnd (octobre 2025)
Un workshop de transmission à l’ARC par les étudiant·es ayant participé à la résidence
Un workshop de drag imaginé avec les étudiant·es Emmanuel·le Garin et Faustine Stricanne
Un·e ou deux invité·es pour un ou deux workshops
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Démystifier la performance
Produire ou interpréter des formes, gestes, textes, chansons, etc.
Travailler des formats de collaboration et/ou en collectif
Contenu du cours :
En partant de la place que la musique occupe dans nos mémoires et de la manière dont elle structure nos souvenirs, l’ARC Playlist Remix 2 s’inscrit dans le cadre du programme de recherche What’s love got to do with it?, qui explore comment nos émotions nous informent sur le monde et comment, en tant qu’artistes, nous pouvons apprendre de la façon dont ces émotions génèrent des récits. Avec les intervenant·es invité·es, nous nous pencherons également sur les pratiques musicales ou performatives, ainsi que sur les notions de spectacle et de fête.
*Sur la résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au Centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies(https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture du parcours Performance, du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025.
L’objectif est de vivre une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel situé dans une ancienne centrale hydroélectrique, près de Trente, en Italie (https://www.centralefies.it/building/). Ce lieu accueille un festival de performance depuis plus de 45 ans et collabore avec des écoles telles que le Dutch Art Institute (Amsterdam/Arnhem) et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence permettra notamment :
- Une formation aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) avec un technicien de Centrale Fies
- Un workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), basé·e à Amsterdam, dont la pratique queer articule performance et musique
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet, régularité de la participation, qualité des recherches et soin dans la mise en œuvre, prise de parole, prise de décision, inscription dans la dynamique collective de l’atelier.
L’évaluation portera également sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Atelier de Recherche et Création - Confluence (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique sur sites.
Exposition dans la galerie de l’école.
Objectifs du cours :
Eau qui médite, enclos du temps.
Paupière close. Un silence qui écoute.
Eric Hurtado
Questionner par la photographie et la vidéo le territoire d’une rivière, son bassin, son déploiement, sa confluence avec l’activité humaine. Nous questionnerons également notre conscience de celle-ci, confluence elle-même de l’existence de la rivière avec notre regard. La question du réel, toujours, rivière qui coule et semble fixe.
« L’image est au confluent de la lumière venue de l’objet et de celle qui vient du regard. » PLATON
Contenu de cours :
L’Arc débutera par la projection de Stalker, d’Andreï Tarkovski, film questionnant la réalité d’un territoire et la conscience des inventeurs de celui-ci (au sens réunissant découverte et invention, justement arcane fondamental de la quête photographique.)
Suivront deux journées de rencontre et d’atelier photographique avec le photographe Jean- Marc Blache, qui a photographié l’eau sous toutes ses formes, de la glace à l’exploration sous-marine dans de nombreux pays. Il nous accompagnera lors d’une séance de prises de vues sur le territoire du Drac, au sud de Pont-de-Claix et pour la restitution des travaux.
Chaque quinzaine, en semaine B, une des deux journées de travail de l’Arc sera consacrée à une sortie de prises de vues en extérieur sur le thème de l’eau.
Un voyage pédagogique est également prévu dans le Vercors à la grotte de Choranche.
Une exposition des travaux réalisés se tiendra à l’issue de l’Arc dans la galerie de l’École.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Films :
Andreï Tarkovski, Stalker
Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu
Michelangelo Antonioni, Gente del Po
Désert Rouge
Jean-Luc Godard, Opération Béton
Jean Giono, L’eau vive
Livres :
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Raymond Depardon, Errance. Points/Seuil
Roland Recht, La lettre de Humboldt, Christian Bourgois
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Atelier de Recherche et Création - Sphère (B.J.)
Méthode d’enseignement :
La sphère est un concept formel. Cet ARC est donc une proposition pour investir une forme dont la dynamique globale, sur le artistique, est abstraite. Mais l’idée de sphère est susceptible de s’imprégner d’éléments variés, comme celui de l’écologie par exemple (la terre est un écosystème sphérique), ou par des investigations fictionnelles (Sphère est le titre d’un film de science-fiction).
L’idée de sphère peut être investie de façon diverses : sur des supports digitaux (film, 3D), ou matériel (peinture, installation, photographie, performance). L’IA peut également être utilisée.
Objectifs du cours :
Cet ARC vous invite à plonger dans l’univers de la sphère, une forme universelle qui traverse l’art, la science, la philosophie et la nature. Symbole d’harmonie, de perfection et d’unité, la sphère est aussi une métaphore puissante pour réfléchir à la fragilité de notre planète Terre, un écosystème menacé par les activités humaines. À travers cet ARC, vous explorerez les dimensions formelles, symboliques et écologiques de la sphère à travers une œuvre ou plusieurs dans le médium de votre choix : dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, performance, multimédia, vidéo, 3D. Cet exercice est une occasion de conjuguer réflexion conceptuelle et engagement environnemental.
Contenu du cours :
Objectifs pédagogiques
- Explorer les caractéristiques formelles et esthétiques de la sphère.
- Intégrer une réflexion écologique en lien avec la Terre, sphère fragile et écosystème précieux.
Thèmes d’exploration autour de la sphère
La sphère, par sa simplicité et sa perfection, offre une multitude de pistes à explorer dont voici quelques exemples : :
- Forme et esthétique : géométriquement, la sphère est la forme la plus équilibrée, où chaque point de sa surface est équidistant de son centre. Dans l’histoire de l’art, elle inspire des œuvres architecturales (comme les dômes de Brunelleschi) ou sculpturales (les sphères polies d’Anish Kapoor). Comment pouvez-vous jouer avec la tridimensionnalité, les reflets, les ombres ou les illusions optiques pour réinterpréter la sphère ? Considérez les jeux de lumière, de texture ou de transparence dans votre travail.
- Symbolisme et philosophie : La sphère a longtemps incarné l’idée de perfection et d’infini. Pour les anciens Grecs, elle représentait le cosmos, une harmonie universelle. Dans l’art contemporain, elle peut évoquer l’unité, l’isolement ou la cyclicité du temps. Pensez aux installations immersives de Yayoi Kusama, où les sphères répétées créent un sentiment d’infini.
- Écologie et fragilité planétaire : La Terre est un écosystème complexe et vulnérable, confronté à des défis comme le changement climatique, la déforestation et la pollution. En tant qu’artistes, vous pouvez utiliser la sphère comme une métaphore pour alerter sur ces enjeux. Pensez à des matériaux de récupération ou à des installations qui évoquent la fragilité de notre environnement.
Modalités et critères de l’évaluation :
- Format : Œuvre physique ou numérique.
- Recherche préparatoire : Au début de l’ARC, un moment d’échange qui s’appuiera sur une présentation visuelle d’images vous proposera des pistes de travail à travers la présentation d’un certain nombre d’exemples. Le domaine de l’art est privilégié mais il sera aussi question d’architecture, selon un choix lié à la forme sphérique. Lors de cette phase préparatoire, vous ressemblerez des références visuelles, textuelles ou conceptuelles dans un carnet de recherche pour trouver votre ou vos idées. Nous discuterons ensemble de ces projets et vous passerez ensuite à la réalisation.
- Production : vous aurez tout le premier semestre pour mettre au point votre réalisation. Vous produirez une œuvre dans le médium de votre choix. Il sera possible d’effectuer plusieurs travaux ou un seul s’il est suffisamment complexe pour justifier cette durée dans le temps.
- Dimension écologique : Intégrez une réflexion sur l’environnement, que ce soit par le choix de matériaux durables, un message visuel sur la crise climatique ou une œuvre qui incite à repenser notre relation à la Terre.
- Rythme des échanges : Je serai présent les lundi et mardi selon l’emploi du temps auquel vous devrez vous référer pour être présents à chaque fois. Les rencontres se feront de préférence de façon collective mais auront lieu également à travers des entretiens individuels.
- Présentation / évaluation : Fin janvier, vos œuvres seront accrochées lors du bilan à travers un accrochage collectif dans notre salle allouée à l’ARC et donneront lieu à un échange de points de vues et d’analyses.
METHODOLOGIE :
- Dessin/peinture : vous expérimenterez la forme de la sphère selon vos aspirations formelles. Les supports meuvent varier, pensez à expérimenter d’autres surfaces que le papier ou la toile.
- Sculpture/installation : vous utiliserez des matériaux disponibles à l’atelier de l’école ou des matériaux de recyclage que vous aurez glané (plastique, métal, bois) ou éphémères (terre, papier) pour construire une sphère ou une composition sphérique. Vous pourrez intégrer des projections, des sons ou des animations pour créer une expérience immersive autour du thème. Dans ce sens, pensez également à solliciter le matériel disponible dans le domaine de la lumière dont dispose l’école.
- Photographie/vidéo : jouez sur des paramètres de cadre, de lumière, pour construire des images dont la structure principale est sphérique. Le montage de films pourra se faire sur Final cut Pro ou Da Vinci Resolve.
- Performance : Les scénarios sont ouverts : mouvements circulaires, répétition, etc. (voir Abramovic et Ulay).
Repères bibliographiques / références art et architecture :
ART :
- Anish Kapoor : Ses sculptures sphériques, comme Cloud Gate, jouent avec les reflets et la monumentalité pour transformer l’espace et la perception. Sa série Sky Mirror présente également des surfaces paraboliques et circulaires.
- Tara Donovan : Une artiste américaine qui utilise des matériaux du quotidien (gobelets, pailles…) pour créer des installations organiques évoquant des formes sphériques ou cellulaires.
- Michelangelo Pistoletto : sa performance Newspaper Sphere interroge l’accumulation et la boulimie d’information à travers un processus d’accumulation performative.
- Marina Abramovic / Ulay : Relation dans le mouvement – une performance historique entre le mythe de Sisyphe (Camus) et celui de l’Eternel Retour (Nietzsche).
- Yayoi Kusama : connue pour ses motifs à pois omniprésents, elle utilise la forme ronde dans ses peintures, sculptures et installations immersives, créant des expériences infinies et psychédéliques.
- Olafur Eliasson : artiste danois-islandais qui explore souvent les formes géométriques, y compris la sphère, dans des installations qui jouent avec la lumière, la perception et les phénomènes naturels. Son œuvre The Weather Project avec son immense soleil artificiel sphérique en est un exemple marquant.
- Richard Long : associé au Land Art, il utilise souvent des formes géométriques simples trouvées dans la nature, comme des cercles de pierres.
- Michel Verjux : Un artiste visuo-spatial contemporain, poète et théoricien de l’art, mentionné ici pour ses sculptures de lumière utilisant des projections minimalistes rondes pour des expériences physiques utilisant l’espace et l’architecture comme support.
- Les artistes de l’Op Art (comme Victor Vasarely) : Bien qu’ils aient exploré diverses formes géométriques, le cercle et les formes rondes étaient essentiels pour créer des illusions d’optique de mouvement et de profondeur.
- Xavier Veilhan : artiste français aux registres étendus mentionné ici essentiellement pour ses mobiles inspirés de Calder, entre équilibre et déséquilibre, dont la finalité se situe peut-être dans un processus de déstabilisation de la sculpture.
- Karina Smigla Bobinsky, artiste germano-polonaise, mentionnée ici pour son installation interactive de 2018 présentant une sphère dans une pièce vide manipulable par les visiteurs.
ARCHITECTURE :
- Antti Lovag : l’architecte des maisons bulles, précurseur de la blob architecture et de l’architecture organique.
- Cabinet d’architecture Populous Severud Associates : La sphère de Las Vegas et son ingénierie de science-fiction.
- La Blob architecture : un terme donné à un courant architectural dans lequel les bâtiments ont une forme organique molle et bombée, comme de grosses amibes.
Artistes dans l’Histoire :
- Sandro Botticelli : Dans sa peinture La Madone du Magnificat, la forme circulaire (du tondo, support rond) encadre la Vierge et les anges, une forme courante à la Renaissance pour les sujets religieux.
- Jérôme Bosh : La création du monde.
- Ingres : Le bain turc, autre référence célèbre de peinture peint sur un tondeauen tant que peinture ronde, en écho aux rondeurs des corps.
- Fernand Léger : Au début du 20e siècle, il a intégré des formes cylindriques et circulaires dans son travail, décomposant les objets en éléments géométriques. Son tableau Les Disques dans la ville en est un exemple.
- Robert Delaunay et Sonia Delaunay : Pionniers de l’Orphisme, un dérivé du cubisme, ils ont utilisé des disques de couleurs et des formes circulaires pour explorer la lumière et le mouvement.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres artistes seront présentés comme sources d’investigation et d’inspiration lors du commencement du workshop à la rentrée.
Annexe : La Sphère comme exploration artistique : une lecture à travers Peter Sloterdijk
Dans sa trilogie Sphères, le philosophe Peter Sloterdijk propose une réflexion profonde sur cette forme, non seulement comme objet géométrique, mais comme métaphore de l’existence humaine, de l’espace et des relations. Ses idées offrent un cadre conceptuel riche pour explorer la sphère en tant que motif, symbole et espace de création.
Sloterdijk décrit la sphère comme une structure fondamentale de l’être-ensemble : L’homme est l’animal qui vit dans des sphères qu’il produit lui-même (Bulles, 1998). Cette idée invite les artistes à envisager la sphère non pas comme un simple volume, mais comme un espace de vie, un contenant intime où se tissent des relations. Dans ce sens, vous pourrez explorer des installations sphériques, jouant avec des matériaux transparents ou opaques pour exprimer cette tension entre intériorité et extériorité.
Les sphères sont des globalisations réussies, des mondes en miniature (Globes, 1999). Cette citation peut inspirer des œuvres qui questionnent l’idée de globalité : une sphère peut-elle contenir le monde ? Les étudiants peuvent créer des microcosmes sphériques, intégrant des fragments d’images, de sons ou d’objets, pour réfléchir à l’ambition de l’art de représenter l’universel à travers une forme finie.
Enfin, dans Écumes, Sloterdijk introduit la notion de sphères multiples et interconnectées : Nous vivons dans des écumes, des agrégats de sphères qui se touchent sans se fondre (Écumes, 2004). Cette image d’écumes, où chaque sphère est à la fois autonome et liée aux autres, pourrait guider des projets collectifs. Cette idée peut également s’envisager sous une forme plastique en deux dimensions, peinture, dessin…
En somme, la sphère, chez Sloterdijk, est bien plus qu’une forme : elle est un espace philosophique, poétique et relationnel. En s’appuyant sur ces concepts, vous pourrez explorer des médiums variés (sculpture, performance, installations immersives) pour interroger la sphère comme lieu de protection, de rêve ou de tension.
Atelier de Recherche et Création - Art and the city (S.S.)
Atelier de Recherche et Création - Le Banquet (P.R. & C.B. & A.O.)
Méthode d’enseignement :
Proposer des situations autour du repas lors desquelles les étudiant·es sont invité·es à répondre systématiquement. Mise en place d’exercices réguliers et création de protocoles autour de la cuisine. Les temps de cuisson, le dressage de la table, l’assaisonnement d’un plat seront des moments pédagogiques parmi d’autres.
Objectifs du cours :
Tous les mardis, développer collectivement des temps de recherche, de discussion et de création dans le cadre d’un repas. Faire la cuisine, manger ensemble, la digestion comme expérience simultanée, la vaisselle et le rangement seront les principaux objectifs de l’ARC. Mettre en œuvre le Symposium de fin de semestre en tant que forme artistique collective.
Contenu du cours :
Tous les mardis s’organiseront autour des repas de midi, depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi. Les déjeuners du mardi midi feront partie de l’ARC, chacun·e ramènera des ingrédients. Nous élaborerons des repas thématiques en questionnant l’économie d’un repas, les manières de faire, l’hospitalité. Nous pratiquerons l’art de la conversation, réfléchirons au vocabulaire de la cuisine dans sa polysémie, nous pratiquerons le “toast” comme forme poétique etc. Quelle différence entre faire la cuisine dans un restaurant, faire la cuisine pour ses amis, faire la cuisine dans une école d’art? Quelle différence entre manger au restaurant, manger chez soi, manger dans une école d’art?
Chaque séance permettra de proposer des formes et préparera la séance suivante.
L’ARC sera aussi le laboratoire de préparation du Symposium qui se tiendra dans la Grande Galerie de l’ESAD le 13 janvier. Nous adresserons des invitations à des personnes choisies, élaborerons un menu et un programme de formes, de gestes et de prises de parole.
Modalités et critères de l’évaluation :
Participation à l’ensemble des temps de l’ARC sans exception et à l’organisation du Symposium du 13 janvier.
Repères bibliographiques / références :
-Karen Blixen, Le dîner de Babette, 1961 (1ere ed. danois 1958).
-Ludovic Burel, Le laboratoire de fermentation, it: éditions, 2025.
-Sally De Kunst et al., This Book is yours. Recipes for artistic collaboration/Recettes pour la collaboration artistique, Art&Fiction publications – Vexer Verlag, 2019.
-Thien Uyen Do, Fermentation rébellion, édition des Equateurs, 2024.
-Marguerite Duras, La cuisine de Marguerite, B. Jacob, 1999.
-Claire Gausse, Louise Drulhe, Cantines de quartier : la recette du lien, éditions 369, coll. Manuels, 2018.
-Emmanuel Guillemain d’Echon, Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis. Routes, recettes et tours de main, Keribus Éditions, 2024.
-Dorothy Ianonne, A CookBook, (edition anglaise), Presses du Réel, 2019.
– Lauren Malka, Mangeuses : histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, ed. les Pérégrines, 2023.
-Gaëlle Ronsin, Ajouter un couvert pour l’anthropologue, Les éditions de l’épure, 2024.
– Niki Segnit, Le répertoire des saveurs, Marabout, 2012.
-Yoann Thommerel, Manger low cost, édition Nous, coll. Disparate, 2025.
-Alice B. Toklas, Le livre de cuisine d’Alice Toklas, (Traduction de : The Alice B. Toklas cook book), les Éd. de Minuit, 1999.
-Gabriel Axel, Le festin de Babette, 1987 (film).
-Luc Moullet, Genèse d’un repas, 1978 (film).
Atelier de Recherche et Création - Bifurcations et chants photosynthèses (E.D.F.)
Intitulé du cours : ARC : Bifurcations et chants-photosynthèses
À la suite de l’Arc « Ré-ouvrir les futurs » et « Terre-strates-récits », troisième chapitre d’un cycle d’enseignement intitulé “DES CHEMINS HYBRIDES”, Imaginer en 2050 êtres et territoires, entre Trièves et Grenoble.
Intervenant.e.s : Stéphanie Sagot et Pascal Aspe (Ferme des MillePousses). Lisa Panico et Thomas Klein, chargé.e.s de la réouverture au public du Centre horticole de Grenoble.
Méthode d’enseignement :
Dans une approche transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation dans le Trièves et le Massif du Vercors avec un travail dans les ateliers de l’ÉSAD. Nous bénéficierons d’expériences d’apprentissage et de chantier participatif avec le nouveau projet d’agriculture urbaine de Mille Pousses Grenoble, dirigé par Pascal Aspe. Nous nous rendrons dans le Trièves pour apprendre de la ferme collective Sainte-Luce et puis dans le Vercors pour un arpentage-lecture de paysage et botanique.
Nous continuerons nos échanges et séances d’apprentissage avec le Centre Horticole de la ville de Grenoble, avec lequel est un partenariat est noué.
Un atelier est également prévu avec Stéphanie Sagot, artiste qui explore depuis vingt ans les liens entre environnement, agriculture et alimentation. Chaque étudiant.e travaillera à partir d’un projet personnel. Nous rencontrerons au début de l’anéée l’artiste baniwa et brésilien Denilson Baniwa, qui nous présentera certains de ses travaux en lien avec le végétal.
Durant le semestre, des journées de réflexion et d’échanges seront également co-organisées avec les ARC et les IR de la mention Territoire et Société. Ainsi une rencontre et un temps d’échange est prévue avec l’ARC de Slimane Raïs intitulé « L’Air de rien… ».
Objectifs / contenu du cours :
En menant des recherches sur les spécificités historiques, environnementales et sociales du territoire entre le Trièves et la métropole Grenobloise articulant espaces urbains, ruraux et montagneux, il s’agira d’imaginer à travers objets et fictions futuristes, les liens pouvant se développer entre sculpture, installation, outil agricole et leurs lieux d’activation : l’exposition, le champ et les espaces de collectes et récoltes.
Pour la troisième édition de cet ARC, nous plongerons, en compagnie des intervenant.e.s et partenaires de ce cycles, dans des visions futuristes de possibles hybridations entre plantes et humains. Partant des écrits de Lynn Margulis et Dorion Sagan au sujet de l’apparition de l’Homo photosyntheticus, nous réfléchirons aux multiples scénarios extraordinaires que l’évolution des espèces permet.
Ces recherches nous demanderont une attention aux différentes échelles composant nos mondes. Comment appréhender les points de vue d’un insecte, d’une plante, d’un micro-organisme, d’un oiseau, d’un humain, d’une forêt, d’une montagne, ou d’une bio-région, et quelles manières peut-on hybrider, mettre en commun, et mettre en scène ces différentes corporéités ?
À partir d’une sensibilisation à ces différentes échelles, de quelle manière pouvons-nous penser et raconter les mouvements, les interactions et les migrations des êtres humains et végétaux à des horizons futurs ? Dans le contexte du Trièves et de la métropole de Grenoble, quelles alliances, quels récits, quelles hybridités possibles ?
Ainsi, en apprenant de la botanique et de l’ethnobotanique, en s’inspirant des recherches scientifiques sur l’évolution futur du climat et de l’environnement, sur l’évolution des sciences du vivant, en apprenant de la littérature des imaginaires (ou « science-fiction ») et des multiples formes de l’agriculture et de production de nourriture, nous imaginerons de possibles hybridations entre formes artistiques, agricoles et écologiques.
Dans une conjoncture, où le présentisme, les visions progressistes, spéculatives, ségrégationnistes et productivistes fragilisent fortement des modes de vies à l’échelle locale comme planétaire, il est crucial de ré-ouvrir les futurs et envisager une multitude de possibilités pour un avenir durable et symbiotique, construit d’interactions multiples, d’échanges entre différences, et d’espace de communs.
À l’horizon 2050, quels objets et quelles formes, quelles transformations du territoire, quelles représentations ou expressions peuvent engendrer de telles collaborations ?
À partir de méthodes transdisciplinaire, et à travers ce dialogue entre arts, agricultures et sciences, comment imaginer dans ces futurs des interactions entre un lieu et un territoire (un éco-système, un jardin, un champ, un quartier, une rivière, une intervention artistique in-situ), des objets (œuvres, outil et instrument) et des représentations (récit, narration, mise en scène) ?
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre, capacité à présenter et échanger à l’oral. Présence, assiduité et participation, assiduité, dialogue.
Repères bibliographiques / références :
L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021.
Karen Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, 2023
Emma Bigé, Clovis Maillet, Écotransféminismes, Pour des écologies transféministes, 2025
Octavia Butler, Parabole du Semeur, 1993.
Terres et liberté : Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, 2025
Patrick Chamoiseau, Les Neuf consciences du Malfini, 2009
Julie Crenn et Lauriane Gricourt, Artistes et paysans. Battre la campagne, 2024
Tj Demos, Radical Futurisms -Ecologies of Collapse/Chronopolitics/Justice to Come, 2023.
Donna J. Haraway Camille Stories, dans Vivre avec le Trouble, 2016.
Lynn Margulis, Dorion Sagan, L’univers bactériel, 1986
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Robin Wall Kimmerer, Tresser les herbes sacrées, 2013.
Ursula K. Le Guin, La Vallée de l’éternel retour, 1985.
Sébastien Marot, Taking the country’s side. Agriculture and architecture, 2019
William Morris, Nouvelles de Nulle Part, 1890.
Vandana Shiva, Jacques Caplat et André Leu, Une agriculture qui répare la planète, Les promesses de l’agriculture biologique régénérative, Actes Sud, 2021.
Œuvres et travail de : Atelier Paysan, Inland, Agence Coloco & Gilles Clément, FutureFarmers, Asunción Molinos Gordo, William Morris, Marjetica Potrc, Elisa Strinna, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Åsa Sonjasdotter, Otolith Group, Natsuko Uchino.
Atelier de Recherche et Création - L'air de rien (S.R.)
“La partie importante de l’œuvre était que je retournais simplement le gaz qui avait été enlevé de l’atmosphère, gardé dans un récipient dans un certain volume mesurable, et aurait donc été utilisé commercialement.. De cette façon, se crée un cycle. » Robert Barry 1966
Objectifs du cours :
Dans cet ARC nous nous intéresserons aux éléments naturels et leurs interactions avec la création artistique. Comment depuis des siècles les artistes exploitent dans leurs œuvres les éléments naturels, non seulement comme sujet ou motif, mais aussi, comme matériaux, outils ou comme espace dans lequel s’articulent des formes.
Il est également question de l’air et de l’art. Le premier est l’incarnation de l’invisible, le second, le sacro-saint du regard. Ceci pourrait sembler paradoxal et pourtant ! Bien qu’il puise son langage dans le visible et le tangible, dans un monde où la visibilité est devenu un enjeu majeur de l’existence, la fonction essentielle de l’art ne serait-elle pas de figurer l’invisible ?
De Botticelli a Otoniel, passant par Duchamp, Morris, Barry ou encore Messager, l’art prend parfois de bonnes inspirations pour donner a voir « cela qui ne peut être peint »*.
Plusieurs intervenants, théoriciens et plasticiens, viendront partager leurs expériences et réflexions sur ces questions. Ainsi, nous accueillerons Thierry Davila, historien de l’art, conservateur de musée et commissaire d’expositions, pour une conférence d’ouverture intitulée De l’air.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu
. Exposition des travaux en fin d’ARC (lieu encore à définir)
. Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
. Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références)
. Présentation des travaux, mise en espace.
. Qualité des réalisations.
. Relation de travail, présence en cours, engagement.
. Entretien 20 minutes avec l’étudiant lors du bilan. Notation /20
Repères bibliographiques / références :
- De l’inframince – Brève histoire de l’imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours. Thierry Davila. Editions du Regard. 2019
- Littératures et arts du vide, Sous la direction de Jérôme Duwa et Pierre Taminiaux Édition : Hermann. 2018
- La puissance créatrice du souffle, Maurice Fréchuret Edition: Les presses du réel. 2024
- Inclusions, esthétique du captitalocène, Nicolas BourriaudEdition : Puf, Perspectives critiques. 2021
- L’art a l’état gazeux, Yves Michaux Edition : Stock. 2003
Atelier Pratique - Blender's Abstract Vibe (B.J.)
Méthode d’enseignement :
Travail sur le logiciel Blender et sur son interopérabilité avec les logiciels de montage Final Cut Pro et Da vinci Resolve. Cela signifie que ces autres logiciels sont également pris en compte dans l’enseignement.
Objectifs du cours :
Apprendre à créer des formes abstraites dans Blender, configurer des matériaux avec la transparence alpha et exporter des séquences d’images avec le canal alpha pour une utilisation composite dans des logiciels de montage (Final Cut Pro, Da vinci Resolve ou Gimp pour des travaux statiques). Cela pourra également donner lieu à quelques aperçus de la fonction tracking de Blender.
Contenu du cours :
Apprentissage des principes de production 3D dans Blender et compréhension de l’écosystème d’image à partir de la couche Alpha et des jeux de transparences. Concepts clés : modélisation, texturage, UV mapping, animation, montage, compositing, rendu.
Modalités et critères de l’évaluation :
Sera évalué la qualité du travail, la concentration de l’étudiant sur son projet, son degré de participation au cours lors des échanges. La présence en cours est un élément clé de l’évaluation.
Repères bibliographiques / références :
Simulacre et simulation (Jean Baudrillard)
Eloge de la simulation (Philippe Quéau)
Atelier Pratique - Brico Musique (F.N.)
Méthode d’enseignement :
La philosophe théoricienne Agnès Gayraud, dans son essai Dialectique de la pop, défini la musique pop comme étant : ”les musiques populaires enregistrées” et, par extension, diffusées et distribuées. En s’appropriant cette idée et en inscrivant le procédé de fabrication au centre de la réflexion, BRICO MUSIQUE envisage la création musicale comme un pratique accessible, joyeuse, et performative. Avec l’économie de moyens comme moteur de formes singulières, et expressives.
Objectifs du cours :
– Comment s’approprier l’outil informatique pour composer de la musique ?
– La musique pop a-t-elle des limites ?
– Comment performer la musique pop en live ?
– L’économie de moyens comme vecteur d’émancipation
– Comment prendre du recul face à la dichotomie art et industrie, inhérente à la musique pop ?
Contenu du cours :
BRICO MUSIQUE est un cycle pédagogique mené à l’ESAD Grenoble depuis trois saisons, s’articulant autour d’ateliers, de workshops, d’interventions.
Son objectif est de pratiquer et fabriquer de la musique pop contemporaine, tel une matière à détourner, à déconstruire, à rejouer. Il s’agit d’en faire un terrain d’expérimentations et un objet esthétique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continue
Repères bibliographiques / références :
Le workshop en partenariat avec Le CIEL s’attachera quant à lui, à poursuivre sa lancée et pousser plus loin les gestes performatifs et collaboratifs en live. Il sera aussi question d’investiguer sur la capacité de déconstruction et de réinvention de la musique pop en live, qui en font un objet plastique à part.
Vous trouverez sur via lien une playlist des films documentant les différents workshops BRICO MUSIQUE au CIEL depuis 2024 : https://urlr.me/75MFet
Atelier Pratique - Edit (A.O.)
Méthode d’enseignement :
Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l’embaussage à froid, le gaufrage, et d’autres techniques encore inexplorées. Mise en commun de savoir-faire technique.
Partage de données.
Objectifs du cours :
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession et de rythme. Comment le support papier, les doubles pages et leurs successions peuvent rendre compte des intentions ? Mettre en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Contenu du cours :
Un atelier
Qui part d’un besoin d’édition
Qui explore les éditions d’artistes
Qui propose des micro-expositions
Qui invite des artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Il s’agit d’effectuer un travail de mise en page, de mise en relation, de penser plastiquement le format et le rythme de succession des pages. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point d’arrivée une publication.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence et participation.
Repères bibliographiques / références :
Le travail d’atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions présentes à la bibliothèque et dans d’autres lieux de ressources.
Atelier Pratique - Fabrique de l'image (C.T.)
Méthode d’enseignement :
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation et d’apprentissage, d’accompagnement, de production, permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.
Objectifs du cours :
À travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement…
Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC, finition/présentation).
Contenu du cours :
Il est proposé aux étudiants d’engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.
Au cours des deux première séances d’Octobre, l’appropriation des nouveaux espace du labo photo et l’exploration du medium se feront à travers une expérimentation collective de la photo-sensibilté alliant papier et film.
Ces productions seront présentées en novembre dans une exposition inaugurale des espaces du Pôle Image.
Plus globalement, les travaux seront conduits autant en prise de vue, que ce soit en extérieur ou en studio (film argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique…).
Les étudiants viendront à l’atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d’en faire l’inventaire et d’en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt de l’ESAD. Les consommables photographiques (films, papiers et chimies) seront fournis pour les travaux en AP.
Modalités et critères de l’évaluation :
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme à déterminer : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan.
Repères bibliographiques / références :
LLANG Thomas. https://www.thomaslang.fr/gestalt
MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d’une ville 1987-89.
SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
GENESTE Guillaume: Le tirage à mains nues. Edité par La main donne 2020.
À emprunter à La Bibliothèque d’étude et du patrimoine. Fonds moderne SL 771 GEN
Emission Par les temps qui courent ( France Culture 20/10/2020 durée : 00:44:56 ) – par : Marie Richeux, Jeanne Aléos, Romain de Becdelievre – nous recevons le tireur et photographe Guillaume Geneste. Avec lui nous discutons de son travail en laboratoire, de l’émotion devant une planche contact et de son ami Denis Roche. – réalisation : Jean- Christophe Francis, Lise-Marie Barré – invités : Guillaume Geneste Qui réalise des tirages de grands photographes https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-jeudi-22-octobre-2020
DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009. http://www.michelcampeauphotographies.com/
WOLFF Ilan « Camera Obscura at work » 1982-1997 et http://www.ilanwolff.com/
https://www.culture.gouv.fr/fr/espacedocumentation/bases-de-donnees/Fiches-bases-de-donnees/arago-le-portail-de-la-photographie Musée en ligne de la photographie permettant d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en France.
Exposition de Pascal Sarrazin à l’Espace Nelson Mandela de Fontaine jusqu’au 11 octobre 2025.
Journées de la photographie de la Maison de l’Image, les 8 et 9 novembre 2025 à l’Ancien Musée Bibliothèque, place de Verdun (https://www.maison-image.fr).
Atelier Pratique - L'eau ça coule et ça mouille (S.R.)
Atelier Pratique - Quels matériaux pour représenter les futurs ? (E.D.F.)
Méthode d’enseignement :
Chaque étudiant·e travaillera à partir d’un projet personnel. Dans une approche résolument transdisciplinaire, nous alternerons des sessions d’apprentissage et d’expérimentation à partir de différentes visites dans un ou plusieurs sites de la métropole de Grenoble : entreprises et associations travaillant sur de matériaux recyclées, durables et écologiques comme l’association G-Recip, le département CraTerre (école d’architecture), la Design Factory de l’Université Grenoble-Alpes, MTK et autres lieux à confirmer.
Nous serons également en dialogue régulier avec Giulia Bellinetti (coordinatrice du Nature Research department et du laboratoire Future Materials Lab à la Jan Van Eyck Academy).
Objectifs et contenu du cours :
Dans les contextes environnementaux et sociaux que nous connaissons, il est indispensable d’engager une réflexion sur les matériaux utilisés, et de favoriser les circuits les plus courts et les plus éthiques mais aussi le réemploi ou le recyclage. Quelle vie des œuvres, quels devenirs des œuvres ? Comment prendre en compte le caractère éphémère ou en évolution d’un matériau. Quelle relation entre pérennité et transformation d’une œuvre ?
Dans le contexte de la réouverture de l’école sur le site de Lesdiguières, on s’interrogera sur les lieux dont les ateliers se fournissent en matériaux, et sur les conditions de création d’une récupérathèque. On continuera un travail de cartographie des ressources à l’échelle de la métropole de Grenoble et de son territoire environnant.
Par cette attention, il ne s’agit pas de limiter la créativité, mais au contraire de repartir d’une réflexion systémique sur les matières, leurs contextes d’origine et d’extraction pour déployer les imaginaires.
Bois, métaux, minéraux, matériaux de synthèse, chimiques, numériques, électroniques…nous ferons un tour d’horizon afin que chacun/chacun se saisisse de matières choisies, et réalise son projet personnel.
À partir de cette relation tissée à un ou plusieurs matériaux, il s’agira pour chaque étudiant·e. de penser un projet personnel dont le sujet sera la représentation de la métropole de Grenoble et de la région du Trièves dans un futur proche et lointain : 2050.
Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue et présentation des travaux en fin de semestre
Repères bibliographiques / références :
Future Materials Banks, Jan Van Eyck Académie, https://www.janvaneyck.nl/postacademy/future-materialshttps://www.futurematerialsbank.com/
Expanded Nature. Écologies du cinéma expérimental, ouvrage collectif sous la direction de Elio Della Noce et Lucas Murari, 2022
Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, 2017.
Œuvres et travail de : Marjetica Potrc, Richard Long, Superflex, Joseph Beuys, Matthew Barney, Cooking Sections, Maria Thereza Alves, Giuseppe Penonne, Pierre Huyghe.
Atelier Pratique - Module curatorial (P.R.)
Méthode d’enseignement :
Atelier pratique. Rendez-vous en groupe, conception, organisation et suivi des projets pris en charge par l’AP.
Objectifs du cours :
Ce module, ouvert à une quinzaine d’étudiant·es par semestre, propose une approche à l’échelle un de la pratique de l’exposition. De manière à apprendre à concevoir et mettre sur pied un projet d’exposition.
Cette année, il sera proposé aux étudiant·es de prendre part à deux projets, un pendant le semestre et l’autre au printemps, en lien avec des partenaires :
-l’événement Petites formes performatives, avec deux performances de Candice Burnet et Amar Ruiz, à l’automne, au Centre d’art Bastille
-l’exposition photographique dédiée aux représentation de l’habiter et de l’environnement pendant et après les confinements de 2020 dus à la pandémie de Cvid-19, en mars, à la galerie de l’école ou à la galerie Xavier Jouvin et dans les bibliothèques du campus ; avec le Master Pro Histoire de l’art de l’UGA
Ces projets permettront de mieux comprendre les enjeux conceptuels à l’origine d’un projet d’exposition, tout comme les enjeux logistiques, le transport d’œuvres, l’accrochage, la maintenance, la surveillance d’exposition, etc.
D’autres projets, amenés par les étudiant·es comme d’autres partenaires pourront être développés dans ce cadre.
Contenu du cours :
Le module curatorial repose sur l’expérience pratique, les étudiant·es seront en charge des projets réalisés où la prise de décision, le dialogue avec les personnels administratifs et techniques de l’école et les partenaires extérieurs de l’école seront au cœur de l’expérience collective. Cela permettra de comprendre les différentes étapes et enjeux d’un projet de monstration. Le but est de permettre aux étudiant·es d’acquérir les outils conceptuels et pratiques permettant à terme de construire des projets en toute autonomie et de commencer à construire un réseau artistique.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu, évaluation sur la présence, la participation aux temps collectifs et sur l’implication dans les projets.
Repères bibliographiques / références :
Atelier Pratique - Moulage (J.S.P.)
Méthode d’enseignement :
Atelier
Objectifs du cours :
Découvrir et se familiariser avec certaines techniques du moulage.
Contenu du cours :
Expérimenter le moulage d’objets simples, de partie du corps avec divers matériaux (en fonction des commandes et stocks disponibles) : Plâtre, argile, béton, alginate, silicone, résine, latex, etc.
Calendrier :
1- Jeudi 9 octobre 14-18
2- Jeudi 6 novembre 14-18
3- Jeudi 20 novembre 14-18
4- Jeudi 4 décembre 14-18
5- Jeudi 18 décembre 14-18
6- Jeudi 15 janvier 2026 14-18
7- Jeudi 29 janvier 2026 14-18
Modalités et critères de l’évaluation :
Présences régulière des étudiant·es.
Concevoir un projet final issu des différentes expériences du moulage.
Repères bibliographiques / références :
Une partie du matériel sera fourni par l’école. Pour des projets plus spécifiques, l’étudiant·e se fournira par ses propres moyens.
Atelier Pratique - Point de vue, point de fuite (E.H.)
Méthode d’enseignement :
Cours théoriques à l’ÉSAD et ateliers à l’extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.
Considérer cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et prendre conscience) l’acte photographique. Nous essaierons d’interroger la photographie dans son essentialité, c’est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.
Objectifs du cours :
« Je ne fais pas la photo d’un paysage, je fais une photo d’un paysage. » Eric Hurtado
Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d’une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l’invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfuie, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.
Trouver un chemin dans les herbes, c’est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d’une éclaircie de notre existence au monde.
Contenu du cours :
Comment la photographie nous permet le passage de l’acte de voir à celui de regarder, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d’une vision.
L’enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre « prendre une photo » et « accueillir une image », dépasser le sujet pour sa question.
Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues (argentique ou numérique), à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimenterons lors d’ateliers pratiques, à l’ESAD comme lors de sorties en extérieur.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d’ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).
Repères bibliographiques / références :
Livres
Raymond Depardon, Errance. Points / Seuil
Luc Delahaye, L’autre,Phaidon
Winterreise, Phaïdon
Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl
Lewis Baltz, Texts, Steidl
Garry Winogrand, Catalogue Jeu de Paume, Flammarion
Henri Cartier-Bresson, L’instant décisif, in L’imaginaire d’après nature, Fata Morgana
Voir est un tout, Centre Pompidou
Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
Rodtchenko photographe, Parenthèses
Bernard Plossu, Revue Lisières, 21
Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d’Art et d’Histoire
Le point aveugle, Musée Hébert
Films
Raymond Depardon, Journal de France
Michelangelo Antonioni, Blow-up
Wim Wenders, Palermo shooting
Le sel de la terre
Sasha Waters Freyer, Garry Winogrand
Laurent Roth, Les yeux brûlés
Manoel de Oliveira, L’étrange affaire Angélica
Jean-Luc Godard, Je vous salue Saravejo
Film socialisme
Gilad Baram, Koudelka shooting holy land
Atelier Pratique - Si je ne peux pas danser... (K.S. & S.F.)
Méthode d’enseignement :
- Résidence de recherche de 6 jours à Centrale Fies – Centre de Recherche sur les Pratiques Performatives Contemporaines et workshop avec l’artiste Publik Universal Frxnd (Octobre 2025)
- Organisation et suivi curatorial de la résidence de recherche de l’artiste Ru Kim (Novembre 2025) à Grenoble et participation en tant que performeur.euses à son projet pour le Festival des Gestes de la Recherche (Décembre 2025)
- Rendez-vous hebdomadaires.
Objectifs du cours :
Ce programme conjoint se concentre sur les pratiques performatives et musicales en tant que formes de narrations expérimentales, et explore leur lien avec les récits collectifs traversés par les affects, les passions sociales et les enjeux de la critique politique.
Contenu du cours :
L’atelier pratique « …si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution » est lié à l’unité de recherche “Hospitalité artistique et activisme visuel” (Simone Frangi et Katia Schneller) et à la mention “Holobionte. Pratiques visuelles, exposition, et nouvelles écologies de l’art”. Il est également mené en collaboration avec Melis Tezkan et son ARC lié à la seconde année du programme de recherche “What’s love got to do with it ?” soutenu par le Ministère de la Culture.
Intitulé d’après une affirmation historiquement attribuée à la militante anarchiste Emma Goldman, qui qualifiait la danse ainsi que la joie et le plaisir d’outils révolutionnaires dignes et efficaces, l’AP envisage la performance multimédia et la musique (au sens de production sonore élargie) comme des plateformes militantes puissantes. La collaboration entre S. Frangi, K. Schneller et M. Tezkan construit un parcours pédagogique structuré et centré sur les pratiques critiques joyeuses, exubérantes et non moralistes qui croisent l’expérience performative avec des questions militantes dans l’espace de lutte de la dissidence de genre, de l’anti-colonialisme, de l’anti-capitalisme et de l’écologie.
L’ARC de Melis Tezkan – développé en collaboration avec cet AP – donnera lieu également au cours du premier semestre à des workshops avec différent.es invité.es qui travaillent dans ce sens en lien avec le programme de recherche “What’s love got to do with it ?”. Les participant.es à l’AP qui auront assisté à la résidence à Centrale Fies prendront en charge quelques séances de restitution et de transmission des expériences menées en Italie.
Résidence de recherche collective à Centrale Fies :
Une résidence au centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines Centrale Fies (https://www.centralefies.it) constituera l’activité d’ouverture de ce parcours du lundi 6 au samedi 11 octobre 2025. L’idée de ce voyage est de faire une école de performance de 5 jours dans ce contexte professionnel italien pour suivre un workshop. Situé dans une ancienne centrale hydroélectrique près de la ville de Trento dans le nord de l’Italie (https://www.centralefies.it/building/), Centrale Fies organise un festival de performance depuis plus de 45 ans, et récemment devenue partenaire institutionnel d’écoles supérieures européennes centrées autour de la performance comme le Dutch Art Institute d’Amsterdam/Arnhem et ISAC – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette résidence sera tout d’abord l’occasion de se former aux outils techniques d’un plateau scénique (lumière, son) en travaillant avec le technicien de Centrale Fies.
Un workshop y sera organisé avec l’artiste invité Publik Universal Frxnd (alias Richard John Jones), artiste basé.e à Amsterdam, aux Pays-Bas, dont la pratique queer croise la performance et la musique. Le travail du Publik Universal Frxnd porte sur l’interaction entre les formes visuelles de représentation/abstraction et les formes politiques de reconnaissance et de marginalisation. En mettant l’accent sur les pratiques folkloriques et les histoires locales, son travail le plus récent explore les sentiments de deuil et de perte à travers une perspective critique de l’héritage nécropolitique du colonialisme sur les travailleur.euses. Son travail s’intéresse à la manière dont l’industrialisation a permis à notre interaction avec les machines de façonner nos vies et nos expressions culturelles. Le Frxnd fait référence à un personnage historique. Un.e hérétique, un charlatan.e, une contradiction dans les termes, le Frxnd est l’énonciation d’un pouvoir ou d’un esprit supérieur et n’a pas de sexe malgré la forme de son vaisseau terrestre. Iel est et a peut-être toujours été un instrument permettant d’aller au-delà de l’imagination et de la perspective limitées de la position spécifique d’un sujet. Le Publik Universal Frxnd est un mouvement dans le temps vers une défaite du moi. Vous trouverez des informations sur sa pratique sur son site.
Participer à la performance de Ru Kim : Au cours du mois de novembre, l’artiste coréen·ne Ru Kim fera une résidence de recherche à l’ESAD. Iel donnera un workshop (13-14/11 et 20-21/11) dans le but d’élaborer une performance avec les participant.es de l’AP qui sera présentée lors du Festival des Gestes de la Recherche (2-4 décembre 2025).
Dans sa pratique, Ru Kim associe la performance et le texte à des installations vidéo et sonores. Ses projets questionnent la résistance et la réappropriation des perpétuations de la violence générées par les idéologies patriarcales, impériales et coloniales de la domination. Ils cherchent à développer des formes qui remettent en question les binaires et les identités figées.
S’appuyant sur sa propre fluidité linguistique, culturelle et identitaire, Ru Kim se nourrit des théories féministes hydro-, noires et queer pour mener des analyses déconstructivistes des représentations oppressives, racistes et coloniales. Ses projets récents se concentrent particulièrement sur les histoires racontées depuis le point de vue du témoin plus qu’humain, les stratégies de l’eau abordées dans une perspective hydroféministe, la documentation de la queerness dans l’histoire coréenne, et les archives révélant la construction « asiatique » promulguée par le regard occidental.
Modalités et critères de l’évaluation :
Présence, assiduité, engagement dans le projet et rendu d’un document écrit.
Repères bibliographiques / références :
Projet personnel
Grille d'évaluations Art 5 - Semestre 10 :
UE1 Épreuves du diplôme
Soutenance du mémoire
Soutenance plastique
Dates des examens
ART GRENOBLE - ANNÉE 1
Semestre1 : 4 et 5 février 2026
Une sélection des travaux réalisés au premier semestre sera présentée au jury de professeurs composé des deux coordinateurs de l’année et de deux enseignants de l’année, un pour chaque option de l’établissement, pour une évaluation dont les modalités et critères sont précisés dans chaque fiche de cours.
Une appréciation individuelle définira globalement la situation de chacun, son évolution ainsi que ses manques.
Semestre 2 : 22 et 23 juin 2026
Chaque étudiant, de même, présentera au jury une sélection du travail du semestre 2.
Une appréciation individuelle sera également rédigée.
Les résultats de l’évaluation du semestre 2 déterminent soit la poursuite des études, soit un redoublement, soit une réorientation vers d’autres études.
Pour passer en année 2, il est exigé d’avoir obtenu les 60 crédits annuels de l’année 1 et d’avoir accepté le choix de la commission d’orientation proposant à l’étudiant l’entrée dans l’une des deux options de l’établissement. Cette commission sera composée pour moitié d’enseignants des deux options et des deux coordonateur·trices d’année. Un redoublement sera proposé aux étudiant·es ayant obtenu entre 48 et 59 crédits annuels.
Commission d’orientation : jeudi 25 juin 2026
ART GRENOBLE - ANNÉE 2
Semestre 1 : 28, 29 et 30 janvier 2026
Semestre 2 : 18 et 19 juin 2026
ART GRENOBLE - ANNÉE 3
À la fin de chaque semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs ses travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que l’étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.
Le semestre 6 s’achève par la présentation aux épreuves du DNA. L’entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant une commission d’admission interne, composée des professeurs, non seulement d’un projet que l’étudiant développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de l’esquisse d’une recherche.
Semestre 5 : 19, 20 et 21 janvier 2026
Semestre 6 : Diplômabilité : 1, 2 et 3 avril 2026
DNA – 10, 11 et 12 juin 2026
Commission de mobilité : mars 2026
Commission d’admission au deuxième cycle : mai 2026
ART GRENOBLE - ANNÉE 4
À la fin du semestre 7, l’étudiant présentera ses travaux à l’ensemble des professeurs. Il sera évolué en fonction : de l’évolution de ses recherches plastiques et théoriques, de son avancée sur le mémoire dont il commence la rédaction, de la prise en charge et préparation de son projet de mobilité internationale, de son suivi des cours théoriques et de sa participation aux Ateliers de Recherche et de Création, de même qu’aux workshops organisés par l’équipe pédagogique.
L’évaluation de fin de semestre 8 porte principalement sur la réalisation du projet de mobilité (20 crédits attribués par l’établissement ou la structure d’accueil) et l’avancée du mémoire (10 crédits attribués par l’équipe pédagogique de l’ESAD Valence).
Semestre 7 : 12, 13 et 14 janvier 2026
Semestre 8 : 26, 27, 28 et 29 mai 2026
ART GRENOBLE - ANNÉE 5
À la fin du semestre 9, l’étudiant présentera ses travaux et de son mémoire à l’ensemble des professeurs pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que l’ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des crédits.
Le semestre 10 s’achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.
Semestre 9 : Diplômabilté : 27 et 28 janvier 2026
Semestre 10 : Soutenance mémoire : 30 et 31 mars 2026
DNSEP : 15 et 16 juin 2026